Les propositions du Crédit Social
Expliquées en 10 leçons

Louis Even et Clifford Hugh Douglas
et vues
à la lumière
de la doctrine sociale de l’Église
Étude
préparée par Alain Pilote
à l’occasion de la semaine d’étude
ayant suivi le Congrès des Pèlerins de saint Michel
à Rougemont, du 5 au 11 septembre 2006
Publié par l’Institut Louis Even pour la Justice Sociale
1101 rue Principale, Rougemont, QC, Canada J0L 1M0 — www.versdemain.org
Les propositions du Crédit Social expliquées
en 10 leçons
Leçon
1 : Le but de l’économie: faire les biens joindre ceux qui en ont besoin
Leçon 2 : La pauvreté en face de l’abondance, la naissance
de l’argent
Leçon 3 : Les banques créent l’argent sous forme de
dette
Leçon 4 : La solution: un argent sans dette créé par la
société
Leçon 5 : Le manque chronique de pouvoir d’achat — Le
dividende
Leçon 6 :
L’argent et les prix — l’escompte compensé
Leçon 7 :
L’histoire du contrôle bancaire aux Etats-Unis
Leçon 8 : Le
Crédit Social n’est pas un parti politique
Leçon 9 : Le
Crédit Social et la doctrine sociale de l’Église (1ere partie)
Leçon 10 : Le
Crédit Social et la doctrine sociale de l’Église (2e partie)
Le Crédit Social est une doctrine, un ensemble de
principes énoncés pour la première fois par le major et ingénieur C.-H.
Douglas, en 1918. La mise en application de ces principes ferait l'organisme
économique et social atteindre efficacement sa fin
propre, qui est le service des besoins humains.
Le Crédit Social ne créerait ni les biens ni les
besoins, mais il éliminerait tout obstacle artificiel entre les deux, entre la
production et la consommation, entre le blé dans les silos et le pain sur la
table. L'obstacle aujourd'hui, au moins dans les pays évolués, est purement
d'ordre financier — un obstacle d'argent. Or, le système financier n'émane ni
de Dieu ni de la nature. Établi par des hommes, il peut être ajusté pour servir
les hommes et non plus pour leur créer des difficultés.
A cette fin, le Crédit Social présente des
propositions concrètes. Fort simples, ces propositions impliquent cependant une
véritable révolution. Le Crédit Social ouvre la vision sur une civilisation
d'un aspect nouveau, si par civilisation on peut signifier les relations des
hommes entre eux et des conditions de vie facilitant à chacun l'épanouissement
de sa personnalité.
Sous un régime créditiste, on ne serait plus aux
prises avec les problèmes strictement financiers qui harcèlent constamment les
corps publics, les institutions, les familles, et qui empoisonnent les rapports
entre individus. La finance ne serait plus qu'un système de comptabilité,
exprimant en chiffres les valeurs relatives des produits et services,
facilitant la mobilisation et la coordination des énergies nécessaires aux
différentes phases de la production vers le produit fini, et distribuant à TOUS
les consommateurs le moyen de choisir librement et individuellement ce qui leur
convient parmi les biens offerts ou immédiatement réalisables.
Pour la première fois dans l'histoire, la sécurité
économique absolue, sans conditions restrictives, serait garantie à tous et à
chacun. L'indigence matérielle serait chose du passé. L'inquiétude matérielle
du lendemain disparaîtrait. Le pain serait assuré à tous, tant qu'il y a assez
de blé pour assez de pain pour tous. De même pour les autres produits
nécessaires à la vie.
Cette sécurité économique, chaque citoyen en
serait gratifié comme d'un droit de naissance, à seul titre de membre de la
communauté, usufruitier sa vie durant d'un capital communautaire immense,
devenu facteur prépondérant de la production moderne. Ce capital est fait,
entre autres, des richesses naturelles, bien collectif; de la vie en association,
avec l'incrementum qui en découle; de la somme des découvertes,
inventions, progrès technologiques, héritage toujours croissant des
générations.
Ce capital communautaire, si productif, vaudrait à
chacun de ses copropriétaires, à chaque citoyen, un dividende périodique, du
berceau à la tombe. Et vu le volume de production attribuable au capital
commun, le dividende à chacun devrait être au moins suffisant pour couvrir les
besoins essentiels de l'existence. Cela, sans préjudice au salaire ou autre forme
de récompense, en plus, à ceux qui participent personnellement à la production.
Un revenu ainsi attaché à la personne, et non plus
uniquement à son statut dans l'embauchage, soustrairait les individus à
l'exploitation par d'autres êtres humains. Avec le nécessaire garanti, un homme
se laisse moins bousculer et peut mieux embrasser la carrière de son choix.
Libérés des soucis matériels pressants, les
hommes pourraient s'appliquer à des activités libres, plus créatrices que le
travail commandé, et poursuivre leur développement personnel par l'exercice de
fonctions humaines supérieures à la fonction purement économique. Le pain matériel ne serait plus l'occupation absorbante de leur vie.
Note: Le texte des 12 leçons suivantes
provient pour la plus grande partie de ces trois écrits de Louis Even :
Sous le Signe de l’Abondance, Qu’est-ce que le vrai Crédit Social?, Une finance
saine et efficace
LEÇON 1 — LE BUT DE L’ÉCONOMIE:
FAIRE LES
BIENS JOINDRE CEUX QUI EN ONT BESOIN
Fins et
moyens
Lorsqu’on parle d’économie, il convient de distinguer
entre fins et moyens, et surtout de soumettre les moyens à la fin, et non pas
la fin aux moyens.
La fin, c'est le but visé, l'objectif poursuivi.
Les moyens, ce sont les procédés, les méthodes, les actes
posés pour atteindre la fin.
Je veux fabriquer une table. Ma fin, c'est la fabrication
de la table. Je vais chercher des planches, je les mesure, je les scie, je les
rabote, je les ajuste, je les visse: autant de mouvements, d'actes qui sont des
moyens pour fabriquer la table.
C'est la fin que j'aie en vue, la fabrication de la table
qui me fait décider des mouvements, de l'emploi des outils, etc. La fin
gouverne les moyens. La fin existe dans mon esprit d'abord, même si les moyens
doivent être mis en oeuvre avant d'obtenir la fin. La fin existe avant les
moyens, mais elle n'est atteinte qu'après l'emploi des moyens.
Cela paraît élémentaire. Mais il arrive que souvent, dans
la conduite de la chose publique, on prend les moyens pour la fin, et l'on est
tout surpris d'obtenir le chaos comme résultat. Par exemple, selon vous, quel
est le but, la fin de l’économie:
A. Créer des emplois?
B. Obtenir une balance commerciale favorable?
C. Distribuer de l’argent à la population?
D. Produire les biens dont les gens ont besoin?
La bonne réponse est D. Pourtant, pour pratiquement tous
les politiciens, la fin de l’économie est de créer des emplois: cependant, les
emplois ne sont qu’un moyen de produire les biens, qui sont l’objectif, la
véritable fin de l’économie; aujourd’hui, grâce à l’héritage du progrès, les
biens peuvent être produits avec de moins en moins de labeur humain, ce qui
laisse aux gens de plus en plus de temps libres pour se consacrer à d’autres
activités, comme prendre soin de leur famille, ou accomplir d’autres devoirs
sociaux. D’ailleurs, quel serait l’utilité de
continuer à produire quelque chose lorsque les besoins humains pour ce produit
sont déjà comblés et satisfaits? Cela entraîne un gaspillage inutile des
ressources naturelles. Et si on tient au plein emploi, qu’arrive-t-il à ceux
qui ne peuvent être employés par le système producteur: les handicapés, les
personnes âgées, les enfants, les mères qui restent à la maison — devraient-ils
tous mourir de faim ? Ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont
producteurs, mais tous sont consommateurs.
Si vous pensez en termes de réalités, avoir une balance
commerciale favorable signifie que vous exportez vers d’autres pays plus de
produits que vous en importez de l’étranger, ce qui signifie que vous vous
retrouvez avec moins de produits dans votre pays, donc plus pauvres en
richesses réelles.
Plusieurs seraient tentés de répondre C à la question du
début, car il semble évident que l’argent est nécessaire pour vivre dans la
société actuelle, à moins de produire soi-même tout ce dont on a besoin pour
vivre, ce qui est l’exception aujourd’hui, avec la division du travail où un
individu est le boulanger, l’autre est charpentier, etc., chacun accomplissant
une tâche spécifique et produisant des biens différents.
L’argent est un moyen d’obtenir ce qui est produit par
les autres. Notez bien, c’est un moyen, pas une fin ! On ne se nourrit pas
en mangeant de l’argent, on ne s’habille pas en cousant du papier-monnaie
ensemble : on se sert de l’argent pour acheter de la nourriture et des
vêtements. Les biens doivent tout d’abord être produits, fabriqués, et mis en
vente sur le marché: s’il n’y avait aucun produit à acheter, tout argent ne
vaudrait absolument rien, ne servirait à rien. A quoi servirait par exemple
d’avoir un million de dollars si vous vous retrouvez au Pôle Nord ou dans le
désert du Sahara, sans aucun produit à acheter avec votre million de
dollars ? Comparez maintenant cette situation avec celle d’un homme qui
n’a pas un sou, mais qui vit sur une île où il retrouve toute l’eau potable et
tous les aliments dont il a besoin pour mener une vie confortable ? Lequel
des deux est le plus riche?
Répétons-le encore une fois, et nous l’expliquerons
encore plus loin, l’argent n’est pas la richesse, mais un moyen d’obtenir la
richesse réelle : les produits.
Ne confondons pas fins et moyens. On peut dire la même
chose des systèmes. Les systèmes ont été inventés et établis pour servir
l'homme, non pas l'homme créé pour servir les systèmes. Si donc un système nuit
à la masse des hommes, faut-il laisser souffrir la multitude pour le système,
ou altérer le système pour qu'il serve la multitude?
Une autre question qui fera le
sujet d'une longue étude dans ce volume: puisque l'argent a été établi pour faciliter
la production et la distribution, faut-il limiter la production et la
distribution à l'argent, ou mettre l'argent en rapport avec la production et la
distribution?
D'où l'on voit que l'erreur de
prendre la fin pour les moyens, les moyens pour des fins, ou de soumettre les
fins aux moyens, est une erreur grossière, très répandue, qui cause beaucoup de
désordre.
La fin de l’économique
Le mot économie provient de deux racines grecques: Oikia,
maison; nomos, règle. Il s'agit donc de la bonne réglementation d'une
maison, de l'ordre dans l'emploi des biens de la maison.
Economie domestique: bonne conduite des affaires dans le
foyer domestique. Economie politique: bonne conduite des affaires de la grande
maison commune, de la nation.
Mais pourquoi «bonne conduite»? Quand est-ce que la
conduite des affaires de la petite ou de la grande maison, de la famille ou de
la nation, peut être appelée bonne? Lorsqu'elle atteint sa fin.
Une chose est bonne lorsqu'elle donne les résultats pour
lesquels elle fut instituée.
L'homme se livre à diverses activités et poursuit
diverses fins, dans divers ordres, dans divers domaines.
Il y a, par exemple, les activités normales de l'homme,
qui concernent ses rapports avec sa fin dernière. Les
activités culturelles concernent son développement intellectuel,
l'ornementation de son esprit, la formation de son caractère. Dans ses rapports
avec le bien général de la société, l'homme se livre à des activités sociales.
Les activités économiques ont rapport avec la richesse
temporelle. Dans ses activités économiques, l'homme poursuit la satisfaction de
ses besoins temporels.
Le but, la fin des activités économiques, c'est donc
l'adaptation des biens terrestres à la satisfaction des besoins temporels de
l'homme. Et l'économique atteint sa fin lorsqu'elle place les biens terrestres
au service des besoins humains.
Les besoins temporels de l'homme sont ceux qui
l'accompagnent du berceau à la tombe. Il y en a d'essentiels, il y en a de
moins nécessaires.
La faim, la soif, les intempéries, la lassitude, la
maladie, l'ignorance, créent pour l'homme le besoin de manger, de boire, de se
vêtir, de se loger, de se chauffer, de se rafraîchir, de se reposer, de se
soigner, de s'instruire. Autant de besoins.
La nourriture, les breuvages, les vêtements, les abris,
le bois, le charbon, l'eau, un lit, des remèdes, l'enseignement d'un
professeur, des livres — autant de biens pour venir au secours de ces besoins.
Joindre les biens aux besoins — voilà le but, la fin de
la vie économique.
Si elle fait cela, la vie économique atteint sa fin. Si
elle ne le fait pas ou le fait mal et incomplètement, la vie économique manque
sa fin ou ne l'atteint que très imparfaitement.
Joindre les biens aux besoins. Les joindre. Pas seulement
les placer en face les uns des autres.
En termes crus, on pourrait donc dire que l'économique
est bonne, qu'elle atteint sa fin, lorsqu'elle est assez bien ordonnée pour que
la nourriture entre dans l'estomac qui a faim; pour que les vêtements couvrent
les épaules qui ont froid; pour que les chaussures viennent sur les pieds qui
sont nus; pour qu'un bon feu réchauffe la maison en hiver; pour que les malades
reçoivent la visite du médecin; pour que maîtres et élèves se rencontrent.
Voilà le domaine de l'économique. Domaine bien temporel.
L'économique a une fin bien à elle: satisfaire les besoins des hommes. Que
l'homme puisse manger lorsqu'il a faim: ce n'est pas la fin dernière de
l'homme; non, ce n'est qu'un moyen pour mieux tendre à sa fin dernière.
Mais si la fin de l'économique n'est qu'un moyen par
rapport à la fin dernière; si ce n'est qu'une fin intermédiaire dans l'ordre
général, c'est tout de même une fin propre pour l'économique elle-même.
Et lorsque l'économique atteint cette fin propre,
lorsqu'elle permet aux biens de joindre les besoins, elle est parfaite. Ne lui
demandons pas plus. Mais demandons lui cela. C'est à elle d'accomplir cela.
Morale et économique
Ne demandons pas à l'économique d'atteindre une fin morale, ni à la morale d'atteindre une fin économique.
Ce serait aussi désordonné que de vouloir aller de Montréal à Vancouver dans le
transpacifique, ou de New-York au Havre en chemin de fer.
Un homme affamé ne passera pas sa faim en disant son
chapelet, mais en prenant des aliments. C'est dans l'ordre. C'est le Créateur
qui l'a voulu ainsi et il n'y déroge que par miracle, qu'en déviant de l'ordre
établi. Lui seul a droit de briser cet ordre. Pour assouvir la faim de l'homme,
c'est donc l'économique qui doit intervenir, pas la morale.
Pas plus qu'un homme qui a la conscience souillée ne la
purifiera par un bon repas ou par des copieuses libations. C'est le
confessionnal qu'il lui faut. C'est à la religion d'intervenir ici: activité
morale, non plus activité économique.
Sans doute que la morale doit accompagner tous les actes
de l'homme, même dans le domaine économique. Mais pas pour remplacer
l'économique. Elle guide dans le choix de l'objectif et veille à la légitimité
des moyens; mais elle n'accomplit pas ce que l'économique doit accomplir.
Lors donc que l'économique n'accomplit pas sa fin,
lorsque les choses restent dans les magasins ou dans le néant et les besoins
dans les maisons, cherchons-en la cause dans l'ordre économique.
Blâmons évidemment ceux qui désorganisent l'ordre
économique ou ceux qui, ayant mission de le régir, le laissent dans l'anarchie.
Eux, en n'accomplissant pas leur devoir, engagent certainement leur conscience
et tombent sous la sanction de la morale.
Comme quoi, si les deux choses sont bien distinctes, il
arrive tout de même que les deux concernent le même homme et que, si l'une est
immolée, l'autre en souffre. L'homme a le devoir moral de veiller à ce que
l'ordre économique, le social temporel, atteigne sa
fin propre.
Aussi, bien que l'économique ne soit responsable que de
la satisfaction des besoins temporels des hommes, l'importance du bon ordre
économique a été maintes fois soulignée par ceux qui ont charge d'âmes. C'est
qu'il faut normalement un minimum de biens temporels pour faciliter la pratique
de la vertu, comme le rappelle saint Thomas d’Aquin. Nous avons un corps et une
âme, des besoins matériels et des besoins spirituels. Comme le dit le proverbe,
«ventre affamé n’a point d’oreille» ; même les missionnaires dans les pays
pauvres doivent tenir compte de ce fait, et ils doivent nourrir les affamés
avant de leur prêcher la bonne parole. L’homme a besoin d’un minimum de biens
matériels pour accomplir son court pèlerinage sur la terre et sauver son âme,
mais le manque d’argent peut causer des situations inhumaines et
catastrophiques.
C’est ce qui a amené le Pape Benoît XV à écrire que «c'est
sur le terrain économique que le salut des âmes est en danger».
Et Pie XI: «Il est exact de dire que telles sont,
actuellement, les conditions de la vie économique et sociale qu'un nombre très
considérable d'hommes y trouvent les plus grandes difficultés pour opérer
l'oeuvre, seule nécessaire, de leur salut.» (Encyclique Quadragesimo anno.)
C'est le même Pape qui, dans la même encyclique, résume
dans cette phrase la fin sociale et bien humaine de l'ordre économique: «L'ordre
économique et social sera sainement constitué et atteindra sa fin alors
seulement qu'il procurera à tous et à chacun de ses membres tous les biens que
les ressources de la nature et de l'industrie, ainsi que l'organisation vraiment
sociale de la vie économique, ont le moyen de leur procurer.»
TOUS et CHACUN. TOUS les biens que peuvent procurer la
nature et l'industrie.
La fin de l'économique est donc la satisfaction des besoins
de TOUS les consommateurs. La fin est dans la consommation, la production n'est
qu'un moyen.
Faire arrêter l'économique à la production, c'est
l'estropier. L’économique ne doit pas financer seulement la production, elle
doit financer aussi la consommation. La production est le moyen, la
consommation est la fin.
Dans un ordre où la fin gouverne les moyens, c'est
l'homme, à titre de consommateur, qui préside à toute l'économie. Et comme tout
homme est consommateur, c'est tout homme qui participe à l'orientation de la
production et de la distribution des biens.
C'est pour l'homme consommateur qu'existent toutes les
activités économiques. Il faut donc que l'homme consommateur ordonne lui-même
la production. C'est lui, le consommateur, qui doit passer ses commandes à la
production.
Une économie véritablement humaine est sociale,
avons-nous dit: elle doit satisfaire TOUS les hommes. Il faut donc que tous les
hommes, TOUS et CHACUN, puissent passer leurs commandes à la production, au
moins jusqu'à satisfaction de leurs besoins essentiels, tant que la production
est en mesure de répondre à ces commandes.
La politique d’une philosophie
Le Crédit Social n’est pas une utopie, mais est basé sur
une compréhension juste de la réalité, sur la juste relation entre l’homme et
la société dans laquelle il vit. Comme l’a déclaré Clifford Hugh Douglas, le
Crédit Social est la politique d’une philosophie.
Une politique, c’est les actions que nous prenons pour
atteindre un objectif, et cette politique, ou actes, est basée sur une
conception de la réalité ou, en d’autres mots, sur une philosophie.
Le Crédit Social proclame une philosophie qui existe
depuis que les hommes vivent en société, mais qui est terriblement ignorée dans
la pratique, de nos jours plus que jamais.
Cette philosophie, vieille comme la société, donc vieille
comme le genre humain, c'est la philosophie de l'association. L’enseignement
social de l’Eglise utiliserait le terme: bien commun.
La philosophie de l'association, c'est donc:
L'association pour le bien des associés, de tous les associés, de chaque
associé. Le Crédit Social, c'est la philosophie de l'association appliquée à la
société en général, à la province, à la nation. La société existe pour
l'avantage de tous les membres de la société, de tous et de chacun.
Le Crédit Social, c'est la doctrine de la société à
l'avantage de tous les citoyens. C'est pour cela que le Crédit Social est, par
définition, l'opposé de tout monopole: Monopole économique, monopole politique,
monopole du prestige, monopole de la force brutale.
Définissez Crédit Social: La société au service de tous
et de chacun de ses membres. La politique au service de tous et de chacun des
citoyens. L'économique au service de tous et de chacun des consommateurs.
Définissez maintenant monopole: Exploitation de
l'organisation sociale au service de quelques privilégiés. La politique au
service de clans appelés partis. L'économique au service de quelques
financiers, de quelques entrepreneurs ambitieux et sans scrupules.
Trop souvent, ceux qui condamnent les monopoles
s'arrêtent à des monopoles industriels spécifiés: monopole de l'électricité,
monopole du charbon, monopole des huiles, monopole du sucre, etc. Et ils
ignorent le plus pernicieux de tous les monopoles dans l'ordre économique: le
monopole de l'argent et du crédit; le monopole qui change le progrès du pays en
dettes publiques; le monopole qui, par le contrôle du volume de l'argent, règle
le niveau de vie des humains sans rapport avec les réalités de la production et
les besoins des familles.
Le but du Crédit Social est de «relier à la réalité» ou
«exprimer en termes pratiques» dans le monde actuel — surtout le monde de la
politique et de l'économique — ces croyances sur la nature de Dieu, de l'homme
et de l'univers qui constituent la foi chrétienne — la foi transmise par nos
ancêtres, et non pas celle changée et pervertie pour se conformer à la
politique ou à l'économie d'aujourd'hui.
L’homme vit en société, dans un monde soumis aux lois de
Dieu: les lois de la nature (les lois physiques de la création), et la loi
morale donnée par Dieu et inscrite dans le cœur de chaque homme (les Dix
Commandements). La connaissance et l’acceptance de ces lois implique
de reconnaître quelles sont les conséquences lorsqu’on les enfreint.
Accepter les lois de la nature, c’est reconnaître ce qui
est une réalité à laquelle nous ne pouvons échapper, et que toute personne, en
tant qu’individu ou collectivement en société, est sujette à ces mêmes lois de
la nature. Chaque événement qui se produit sur plan physique est une
illustration de l’existence des lois physiques qui régissent l’univers. Par
exemple, si un homme saute d’une avion en plein vol, il n’enfreint pas la loi
de la gravité… il ne fait que prouver son existence. Cette observation
s’applique à toutes les lois.
Ces lois de la nature, créées par Dieu, ne peuvent être
abrogées par l’homme, on ne peut leur désobéir ou passer outre aux sanctions
qu’entraîne leur violation.
Les chaînes que les individus en société se sont forgés
pour eux-mêmes (accords, associations, lois créées par l’homme) sont
facultatives, optionnelles, tandis qu’on ne peut échapper aux lois de la nature
et à leurs conséquences.
Par exemple, l’argent est un système créé par l’homme, et
non pas un système créé par Dieu ou la nature: il peut donc être changé par
l’homme. L’équilibre qui existe dans la création de tous les êtres vivants, ce
qu’on désigne par le terme «environnement», par contre, ne peut être violé sans
conséquences. Si nous produisons des biens sans respecter l’environnement, si
nous polluons la planète et gaspillons les ressources qui nous ont été données
par Dieu, nous devons obligatoirement en subir les conséquences.
Le crédit social: la confiance qu’on puisse vivre ensemble en société
Dans son pamphlet Qu’est-ce que le Crédit Social?, Geoffrey Dobbs
écrit: «Le terme “crédit social” (sans majuscules) désigne quelque chose qui
existe dans toutes les sociétés, mais à laquelle on n'avait jamais donné de nom
auparavant, parce qu'on prenait cette chose pour acquis. Nous prenons
conscience de l'existence du “crédit social”, du crédit de la société,
seulement lorsque nous le perdons.
 «Le mot “crédit” est synonyme de foi, ou confiance;
ainsi, nous pouvons dire que le crédit est la foi ou confiance qui lie ensemble
les membres d'une société — la confiance ou croyance mutuelle dans chaque autre
membre de la société, sans laquelle c'est la peur, et non la confiance, qui
cimente cette société... Quoique aucune société ne puisse exister sans une
certaine sorte de crédit social, ce crédit social, ou confiance en la vie en
société, atteint son maximum lorsque la religion chrétienne est pratiquée, et
atteint son minimum lorsqu'on nie le christianisme ou qu'on s'en moque.
«Le mot “crédit” est synonyme de foi, ou confiance;
ainsi, nous pouvons dire que le crédit est la foi ou confiance qui lie ensemble
les membres d'une société — la confiance ou croyance mutuelle dans chaque autre
membre de la société, sans laquelle c'est la peur, et non la confiance, qui
cimente cette société... Quoique aucune société ne puisse exister sans une
certaine sorte de crédit social, ce crédit social, ou confiance en la vie en
société, atteint son maximum lorsque la religion chrétienne est pratiquée, et
atteint son minimum lorsqu'on nie le christianisme ou qu'on s'en moque.
«Le crédit social est donc un résultat, ou une expression
en termes concrets, du vrai christianisme dans la société, un de ses fruits les
plus reconnaissables; et c'est le but et la ligne de conduite des créditistes
d'augmenter ce crédit social, et de s'efforcer d'empêcher son déclin. Il y a
des milliers d'exemples de ce crédit social qu'on tient pour acquis dans la vie
de tous les jours. Comment pourrions-nous vivre le moindrement en paix si nous
ne pouvons pas faire confiance à nos voisins? Comment pourrions-nous utiliser
les routes si nous n'avions pas confiance que les autres automobilistes
observent le Code de la route? (Et qu'arrive-t-il lorsqu'ils ne le font pas!)
“A
quoi servirait-il de cultiver des fruits ou des légumes dans des jardins ou des
fermes si d'autres gens viendraient les voler? Comment n'importe quelle
activité économique pourrait-elle exister — que ce soit produire, vendre ou
acheter — si les gens ne peuvent, en général, compter sur l'honnêteté et des
transactions justes? Et qu'arrive-t-il lorsque le concept de mariage chrétien,
de famille chrétienne et d'éducation chrétienne des enfants est abandonné? Nous
réalisons donc que le christianisme est quelque chose de réel avec des
conséquences pratiques terriblement vitales, et que d'aucune manière le
christianisme ne se limite à un ensemble d'opinions qui peuvent être choisies
par ceux qui y sont intéressés.»
 On peut ajouter que sans ce respect du crédit social, des
lois régissant la société, toute vie en société deviendrait alors impossible, même
en mettant un gendarme ou policier à chaque coin de rue, puisqu’on ne pourrait
faire confiance à personne.
On peut ajouter que sans ce respect du crédit social, des
lois régissant la société, toute vie en société deviendrait alors impossible, même
en mettant un gendarme ou policier à chaque coin de rue, puisqu’on ne pourrait
faire confiance à personne.
Le «discrédit» social
M. Dobbs continue: «Tout comme il existe des créditistes
— qui sont conscients de l'être ou qui le sont sans le savoir — essayant de
construire le crédit social (la confiance en la vie en société), de même
existent d'autres personnes qui essaient de détruire ce crédit social, cette
confiance en la vie en société, et qui malheureusement connaissent beaucoup de
succès dans cette destruction. Parmi ceux qui détruisent consciemment, on peut
compter les communistes et autres révolutionnaires, qui cherchent ouvertement à
détruire tous les liens de confiance qui permettent à notre société de
fonctionner, cela dans le but de hâter le jour de la révolution... Mais il y a
aussi ceux qui détruisent inconsciemment le crédit social, et qui sont
responsables, en Occident, des succès de ceux qui détruisent consciemment...
Pourquoi les usines et fabricants nous refilent-ils tant
de produits de pacotille à des prix si exorbitants, et nous amènent à les
acheter avec des emballages et de la publicité conçus de manière astucieuse?...
Et surtout, pourquoi des millions de travailleurs respectables de toutes
classes prennent-ils part dans les grèves, conçues délibérément pour diminuer
ou stopper les services à leurs concitoyens?... Qu'est-ce qui peut donc pousser
des gens respectables à descendre si bas? Nous savons tous la réponse. Il y a
un facteur commun à toutes ces grèves et actes destructeurs: le besoin de plus
d'argent pour faire face au coût de la vie de plus en plus élevé.
«J'en arrive donc enfin à la question de
l'argent. Certaines personnes pensent que le Crédit Social se résume à une
question d'argent. Ils ont tort! Le Crédit Social n'est pas avant tout une
question d'argent, mais essentiellement une tentative d'appliquer le
christianisme dans les questions sociales, dans la vie en société; et si le
système d'argent se trouve être un obstacle à une vie plus chrétienne (et c'est
effectivement le cas), alors nous, et tout chrétien, devons nous soucier de ce
qu'est la nature de l'argent, et pourquoi l'argent est un obstacle.
«Il existe un urgent besoin que
plus de gens examinent de plus près le fonctionnement du système monétaire
actuel, quoiqu'il ne soit pas demandé à tout le monde d'être des experts sur ce
sujet. Mais lorsque les conséquences du système monétaire actuel sont si
abominables, tout le monde doit au moins saisir les grandes lignes de ce qui ne
fonctionne pas et doit être corrigé, afin de leur permettre d'agir en
conséquence...»
LEÇON 2 —
LA PAUVRETÉ EN FACE DE L’ABONDANCE
LA
NAISSANCE ET LA MORT DE L’ARGENT
Les biens existent-ils? Existent-ils en quantité suffisante pour satisfaire
tous les besoins premiers des consommateurs?
Manque-t-il quelque chose dans notre
pays pour satisfaire les besoins temporels des citoyens? Manque-t-il de la
nourriture pour que tout le monde mange à sa faim? Manque-t-il des chaussures? des vêtements? Ne peut-on pas en faire autant qu'il en faut?
Manque-t-il des chemins de fer et d'autres moyens de transport? Manque-t-il du
bois ou de la pierre pour construire de bonnes maisons pour toutes les
familles? Sont-ce les constructeurs, les fabricants et autres ouvriers qui
manquent? Sont-ce les machines qui manquent?
Mais on a de tout cela, et de reste.
Les magasins ne se plaignent jamais de ne pas trouver ce qu'il faut pour mettre
en vente. Les élévateurs sont pleins à craquer. Les hommes valides qui attendent
du travail sont nombreux. Nombreuses aussi les machines arrêtées.
Pourtant, que de monde souffre! Les
choses n'entrent pas dans les maisons.
A quoi sert de dire aux hommes et aux
femmes que leur pays est riche, qu'il exporte beaucoup de produits, qu'il est
le troisième ou quatrième pays au monde pour l'exportation?
Ce qui sort du pays n'entre pas dans
les maisons des citoyens. Ce qui reste dans les magasins ne vient pas sur leur
table.
La femme ne nourrit pas
ses enfants, ne les chausse pas, ne les habille pas, en contemplant les
vitrines, en lisant les annonces de produits dans les journaux, en entendant la
description de beaux produits à la radio, en écoutant les boniments des
innombrables agents de vente de toutes sortes.
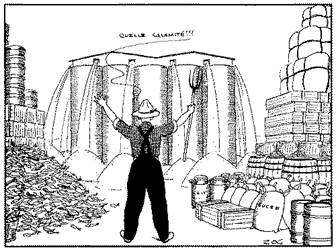 C'est le droit d'avoir ces produits qui manque. On ne
peut pas les voler. Pour les obtenir, il faut payer, il faut avoir de l'argent.
C'est le droit d'avoir ces produits qui manque. On ne
peut pas les voler. Pour les obtenir, il faut payer, il faut avoir de l'argent.
Il y a beaucoup de bonnes choses au pays, mais le droit à
ces choses, la permission de les obtenir manque à bien des personnes et des
familles qui en ont besoin.
Manque-t-il autre chose que l'argent? Qu'estce qui
manque, à part du pouvoir d'achat pour faire les produits passer des magasins
aux maisons?
L'humanité a passé par des périodes de disette; des
famines couvraient de grands pays et l'on manquait des moyens de transport
appropriés pour amener vers ces pays les richesses d'autres sections de la
planète.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'abondance nous
déborde. C'est elle — non plus la rareté — qui crée le problème.
Il n'est nullement besoin d'entrer dans les détails pour
démontrer ce fait. Nullement besoin de citer les cas de destruction volontaire,
sur grande échelle, pour «assainir les marchés» en faisant disparaître les
stocks. Ne donnons ici que quelques exemples :
Le quotidien «La Presse» de Montréal du 7 juin 1986
rapportait le cas des patates du Nouveau-Brunswick: «Le mois dernier... le
gouvernement fédéral décidait de jeter près de 100 000 tonnes de pommes de
terre, après en avoir envoyé 2 500 tonnes déshydratées dans deux pays
africains.
«La mobilisation générale de fermiers du
Nouveau-Brunswick, de compagnies de transport et de bénévoles a permis d'en
sauver près de 180 000 kilos qui ont pris le chemin des soupes populaires et
des petits centres d'hébergement du Nouveau-Brunswick, de Toronto, d'Ottawa, de
Montréal. Mais 90 000 tonnes, l'équivalent d'un sac de 10 livres (4,5 kg) de
patates pour chaque Canadien, se sont retrouvées dans les poubelles... La même
semaine que l'opération des patates avait lieu, 6 000 barils de 200 livres (90
kg) de harengs étalent rejetés dans la rivière Miramichi au Nouveau-Brunswick.»
L'abondance ne se limite pas au Canada, c'est le cas de
l'Europe aussi, tel que rapporté dans les journaux en octobre 1986, sous le
titre «Les affamés du monde pas consultés»:
«L'outrage public a explosé au sujet du projet de la
Communauté Economique Européenne (CEE) de brûler ou jeter dans l'océan l'énorme
surplus de montagnes de beurre, de lait en poudre, de boeuf et de blé
s'accumulant parmi les nations de la CEE. Un rapport des quartiers généraux de
la CEE à Bruxelles par la Commission européenne recommande la destruction de la
nourriture qui est en train de pourrir, et très coûteuse à entreposer. On dit
qu'une économie de 300 millions $ U.S. est possible si les produits laitiers
seulement étaient détruits. La CEE pratique déjà périodiquement des
déversements de nourriture à la mer. L'année dernière, elle a déversé dans
l'océan plusieurs centaines de tonnes de blé qui se détérioraient. Il est proposé
d'éliminer la moitié des surplus actuels. On croit que cela signifierait brûler
750 000 tonnes de beurre et 500 000 tonnes de lait en poudre. Les quotas sur le
lait n'ont pas réussi à assécher le lac de lait de la CEE.»
Pourquoi tout ce gaspillage? Pourquoi les produits ne
joignent-ils pas les besoins? C'est parce que les gens n’ont pas d'argent.
L'argent est important dans le monde actuel non pas parce qu'il est la
richesse, mais parce que la richesse n'est pas distribuée sans argent. La
richesse, les biens utiles, vous rient au nez et vous crevez de faim devant des
greniers pleins à craquer, si vous n'avez pas d'argent. Pas d'argent, pas de
produits: l’homme mourra de faim, et les produits seront jetés.
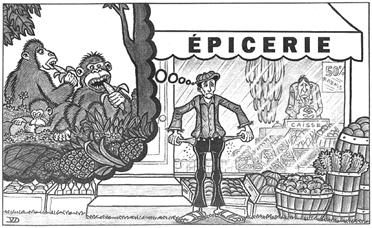 Sommes-nous
plus intelligents que les
singes?
Sommes-nous
plus intelligents que les
singes?
Regardez la caricature ci-contre: Un magasin rempli de
bonnes choses. L'abondance. En face du magasin un homme affamé. La privation.
Les bonnes choses sont faites pour être consommées. Le marchand les étale pour
les vendre. Le consommateur voudrait les acheter. Mais, la permission de les
acheter lui manque. Il n'a pas d'argent. Résultat: les bonnes choses ne seront
pas consommées, mais pourriront à l'étalage. Pourtant, tout le monde serait
content s'il en était autrement. Le marchand serait content de vendre. Le
consommateur serait content d'acheter. Pourquoi donc une chose qui ferait le
bonheur de tous ne se réalise-t-elle pas chez les hommes?
Regardons plutôt les singes. Ils voient l'abondance dans
les arbres. Ils ont besoin de ces choses pour vivre. Ils s'en servent tout
simplement.
Et pourtant les singes n'ont jamais élaboré, dans leurs
universités, de savants systèmes économiques. Dans leurs têtes de singes, ils
n'ont jamais raisonné sur la loi de l'offre et de la demande, ni sur la
différence entre le communisme et le néo-libéralisme. Ils se sont vus en face
de bonnes choses pour eux, et ont trouvé la raison suffisante pour ne pas
crever de faim.
Mais un singe, est un singe, et un homme est un homme. Le
premier n'a pas d'esprit. Le second peut abuser de l'esprit qu'il a. Le singe
se dirige par son instinct, qui ne le trompe pas. L'homme se dirige par son
esprit, souvent désaxé par l'orgueil. Alors, l'homme ergote, fait de la
dialectique, mais oublie le raisonnement pur et simple basé sur le bon sens.
Certes, cette grande sottise de multitudes affamées, au
milieu de l'abondance de richesses, est causée par la cupidité de ceux qui
établissent le pouvoir sur l'esclavage des masses. Mais, on peut dire aussi que
cette sottise est défendue et maintenue en place par des soi-disant savants en
économie qui conduisent les esprits aux conclusions les plus bêtes en ayant
l'air de raisonner avec science et sagesse.
Toute cette situation absurde peut se résumer sous forme
d’histoire, mais qui porte une conclusion très sérieuse : Un groupe de
singes dans la jungle discutaient entre eux pour savoir si les hommes étaient
plus intelligents que les singes. Certains disaient que oui, d’autres non. L’un
des singes s’écria : «Pour en avoir le cœur net, je vais aller faire un
tour en ville chez les humains, et voir s’ils sont vraiment plus intelligents
que nous.» Tous les singes acceptèrent sa proposition. Alors le singe se rendit
en ville, et vit un homme sans le sou crever de faim devant un magasin rempli
de bananes. Le singe retourna dans la jungle, et dit aux autres singes :
«Ne vous inquiétez pas, les hommes ne sont pas plus intelligents que
nous ; ils crèvent de faim devant des bananes qui pourrissent sur les
tablettes, par manque d’argent.»
Conclusion : de grâce,
soyons plus intelligents que les singes, et concevons un système d’argent qui
nous permettra de manger les bananes et tous les autres produits qui sont
donnés en abondance par Dieu à tous ses enfants de la terre. Un tel système
d’argent existe, c’est le Crédit Social.
Argent et richesse
Nous venons de voir que ce qui manque, ce ne sont pas les
produits, mais l’argent. Cela ne veut pas dire que c'est l'argent qui est la
richesse. L'argent n'est pas le bien terrestre capable de satisfaire le besoin
temporel.
On ne se nourrit pas en mangeant de l'argent. Pour
s'habiller, on ne coud pas ensemble des piastres pour s'en faire une robe ou
des bas. On ne se repose pas en s'étendant sur de l'argent. On ne se guérit pas
en plaçant de l'argent sur le siège du mal. On ne s'instruit pas en se
couronnant la tête d'argent.
L'argent n'est pas la richesse. La richesse, ce sont les
choses utiles qui correspondent à des besoins humains.
Le pain, la viande, le poisson, le coton, le bois, le
charbon, une auto sur une bonne route, la visite d'un médecin au malade, la
science du professeur — voilà des richesses.
Mais, dans notre monde moderne, chaque personne ne fait
pas toutes les choses. Il faut acheter les uns des autres. L'argent est le
signe qu'on reçoit en échange d'une chose qu'on vend; c'est le signe qu'il faut
passer en échange d'une chose qu'on veut avoir d'un autre.
La richesse
est la chose; l'argent est le signe. Le signe doit aller d'après la chose.
S'il y a beaucoup de choses à vendre dans un pays, il y faut beaucoup d'argent
pour en disposer. Plus il y a de monde et de choses, plus il faut d'argent en
circulation, ou bien tout arrête.
C'est cet équilibre-là qui fait défaut aujourd'hui. Les
choses, on en a à peu près autant qu'on veut en faire, grâce à la science appliquée,
aux découvertes, aux machines perfectionnées. On a même un tas de monde à ne
rien faire, ce qui représente des choses possibles. On
a un tas d'occupations inutiles, nuisibles même. On a des activités employées à
la destruction.
Pourquoi l'argent, établi pour écouler les produits, ne
se trouve-t-il pas dans les mains du monde en rapport avec les produits?
 L’argent naît quelque part
L’argent naît quelque part
Tout a un commencement, excepté Dieu. L'argent n'est pas le
bon Dieu, il a donc un commencement. L'argent commence quelque part. On sait où
commencent les choses utiles, la nourriture, les habits, les chaussures, les
livres. Les travailleurs, les machines, plus les ressources naturelles du pays,
font naître la richesse, les biens dont nous avons besoin et qui ne manquent
pas.
Mais où commence l'argent, l'argent qui nous manque pour
avoir les biens qui ne manquent pas ?
La première idée qu'on entretient, sans trop s'en rendre
compte, c'est qu'il y a une quantité stable d'argent, et qu'on ne peut pas
changer ça: comme si c'était le soleil ou la pluie, ou la température. Idée
fausse: s'il y a de l'argent, c'est qu'il est fait quelque part. S'il n'y en a
pas plus, c'est que ceux qui le font n'en font pas plus.
Deuxième idée: quand on se pose la question, on pense que
c'est le gouvernement qui fait l'argent. C'est encore faux. Le gouvernement
aujourd'hui ne fait pas d'argent et se plaint continuellement de n'en avoir
pas. S'il en faisait, il ne se croiserait pas les bras dix ans en face du
manque d'argent. (Et le Canada n’aurait pas une dette de 500 milliards de
dollars.) Le gouvernement taxe et emprunte, mais ne fait pas l'argent.
Nous allons expliquer où commence et où finit l'argent.
Ceux qui tiennent le contrôle de la naissance et le contrôle de la mort de
l'argent règlent son volume. S'ils en font beaucoup et en détruisent peu, il y
en a davantage. Si la destruction va plus vite que la fabrication, sa quantité
diminue.
Notre niveau de vie, dans un pays où l'argent manque, est
réglé non pas par les choses, mais par l'argent dont on dispose pour acheter
les choses. Ceux qui règlent le niveau de l'argent règlent donc notre niveau
de vie.
«Ceux qui contrôlent l'argent et le crédit sont devenus les maîtres de nos
vies... sans leur permission nul ne peut plus respirer.» (Pie XI, encyclique Quadragesimo anno).
L’argent,
c'est tout ce qui sert à payer, à acheter; ce qui est accepté par tout le monde
dans un pays en échange de choses ou de services. La matière dont l'argent est
fait n'a pas d'importance. L'argent a déjà été des coquillages, du cuir, du
bois, du fer, de l'argent blanc, de l'or, du cuivre, du papier, etc.
Exemples d’argent dans le passé

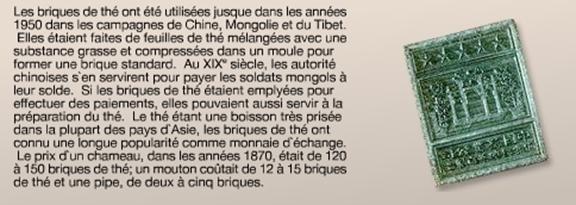
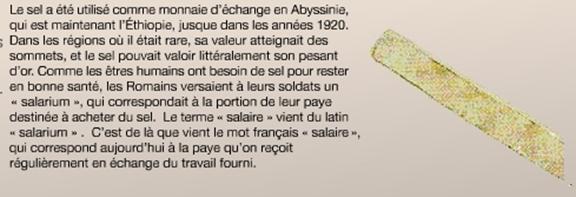
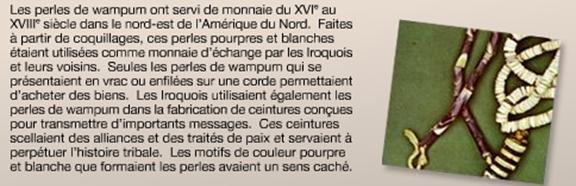
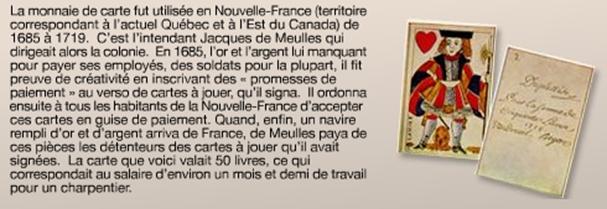

Actuellement, on a deux sortes d'argent au Canada: de
l'argent de poche, fait en métal et en papier; de l'argent de livre, fait en
chiffres. L'argent de poche est le moins important; l'argent de livre est le
plus important (plus de 95%).
 L'argent de livre, c'est le compte de banque. Toutes les
affaires marchent par des comptes de banque. L'argent de poche circule ou
s'arrête selon la marche des affaires. Mais les affaires ne dépendent pas de
l'argent de poche; elles sont activées par les comptes de banque des hommes
d'affaires.
L'argent de livre, c'est le compte de banque. Toutes les
affaires marchent par des comptes de banque. L'argent de poche circule ou
s'arrête selon la marche des affaires. Mais les affaires ne dépendent pas de
l'argent de poche; elles sont activées par les comptes de banque des hommes
d'affaires.
Avec un compte de banque, on paie et on achète sans se
servir d'argent de métal ou de papier. On achète avec des chiffres.
J'ai un compte de banque de 40 000 $. J'achète une auto
de 10 000 $. Je paie par un chèque. Le marchand endosse et dépose le chèque à
sa banque.
Le banquier touche deux comptes: d'abord celui du
marchand, qu'il augmente de 10 000 $; puis le mien, qu'il diminue de 10 000 $.
Le marchand avait 500 000 $; il a maintenant 510 000 $ écrit dans son compte de
banque. Moi, j'avais 40 000 $, il y a maintenant 30 000 $ écrit dans mon compte
de banque.
L'argent de papier n'a pas bougé pour cela dans le pays.
J'ai passé des chiffres au marchand. J'ai payé avec des chiffres. Plus des neuf
dixièmes des affaires se règlent comme cela. C'est l'argent de chiffres qui est
l'argent moderne; c'est le plus abondant, dix fois autant que l'autre; le plus
noble, celui qui donne des ailes à l'autre; le plus sûr, celui que personne ne
peut voler.
 Epargne et emprunt
Epargne et emprunt
L'argent de chiffres, comme l'autre, a un commencement.
Puisque l'argent de chiffres est un compte de banque, il commence lorsqu'un
compte de banque commence sans que l'argent diminue nulle part, ni dans un
autre compte de banque ni dans aucune poche.
On fait, ou on grossit, un compte de banque de deux
manières: l'épargne et l'emprunt. II y a d'autres sous-manières, elles peuvent
se classer sous l'emprunt.
Le compte d'épargne est une transformation d'argent. Je
porte de l'argent de poche au banquier; il augmente mon compte d'autant. Je
n'ai plus l'argent de poche, j'ai de l'argent de chiffres à ma disposition. Je
puis réobtenir de l'argent de poche, mais en diminuant mon argent de chiffres
d'autant. Simple transformation.
Mais nous cherchons ici à savoir où commence l'argent. Le
compte d'épargne, simple transformation, ne nous intéresse donc pas pour le
moment.
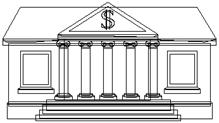 L’argent commence dans les
banques
L’argent commence dans les
banques
Le compte d'emprunt est le compte avancé par le banquier
à un emprunteur. Je suis un homme d'affaires. Je veux établir une manufacture
nouvelle. Il ne me manque que de l'argent. Je vais à une banque et j'emprunte
100 000 $ sur garantie. Le banquier me fait signer les garanties, la promesse
de rembourser avec intérêt. Puis il me prête 100 000 $.
Va-t-il me passer 100 000 $ en papier? Je ne veux pas.
Trop dangereux d'abord. Puis je suis un homme d'affaires qui achète en bien des
places différentes et éloignées, au moyen de chèques. C'est un compte de banque
de 100 000 $ que je veux et qui fera mieux mon affaire.
Le banquier va donc m'avancer un compte de 100 000 $. Il
va placer dans mon compte 100 000 $, comme si je les avais apportés à la
banque. Mais je ne les ai pas apportés, je suis venu les chercher.
Est-ce un compte d'épargne, fait par moi? Non, c'est un
compte d'emprunt bâti par le banquier lui-même, pour moi.
Le fabricant d'argent
Ce compte de 100 000 $ n'est pas fait par moi, mais par
le banquier. Comment l'a-t-il fait? L'argent de la banque a-t-il diminué
lorsque le banquier m'a prêté 100 000 $? Questionnons le banquier:
— Monsieur le banquier, avez-vous moins d'argent dans
votre tiroir après m'avoir prêté 100 000 $?
— Mon tiroir n'est pas touché.
— Les comptes des autres ont-ils diminué?
— Ils sont exactement les mêmes.
— Qu'est-ce qui a diminué dans la banque?
 — Rien n'a diminué.
— Rien n'a diminué.
— Pourtant mon compte de banque a augmenté. D'où vient
cet argent que vous me prêtez?
— Il vient de nulle part.
— Où était-il quand je suis entré à la banque?
— Il n'existait pas.
— Et maintenant qu'il est dans mon compte, il existe. Alors,
il vient de venir au monde?
— Certainement.
— Qui l'a mis au monde, et comment?
— C'est moi, avec ma plume et une goutte d'encre, lorsque
j'ai écrit 100 000 $ à votre crédit, à votre demande.
— Alors, vous faites l'argent?
— La banque fait l'argent de
chiffres, l'argent moderne, qui fait marcher l'autre en faisant marcher les
affaires.
Le banquier fabrique l'argent, l'argent de chiffres,
lorsqu'il prête des comptes aux emprunteurs, particuliers ou gouvernements.
Lorsque je sors de la banque, il y a dans le pays une nouvelle base à chèques
qui n'y était pas auparavant. Le total des comptes de banque du pays y est
augmenté de 100 000 $. Avec cet argent nouveau, je paie des ouvriers, du
matériel, des machines, j'érige ma manufacture. Qui donc fait l'argent nouveau?
– Le banquier.
LEÇON 3 —
LES BANQUES CRÉENT L’ARGENT SOUS FORME DE DETTE
Les banques à couvertures fractionnaires – L’orfèvre devenu banquier
Revenons à l’exemple du prêt de 100 000 $ de la leçon
précédente. aucun autre compte n'a été diminué dans la
banque pour cela. Pas un sou n'a été déplacé, soit d'un tiroir, soit d'une
poche, soit d'un compte. J'ai 100 000 $ de plus, mais personne n'a un sou de
moins. Ces 100 000 $ n'étaient nulle part il y a une heure, et les voici
maintenant à mon crédit, dans mon compte de banque.
D'où vient donc cet argent? C'est de l'argent nouveau,
qui n'existait pas quand je suis entré dans la banque, qui n'était dans la
poche ni dans le compte de personne, mais qui existe maintenant dans mon
compte. Le banquier a bel et bien créé 100 000 $ d'argent nouveau, sous forme
de crédit, sous forme d'argent de comptabilité: argent scriptural, aussi bon
que l'autre.
Le banquier n'est pas effrayé de cela. Mes chèques vont
donner à ceux pour qui je les fais le droit de tirer de l'argent de la banque.
Mais le banquier sait bien que les neuf-dixièmes de ces chèques auront
simplement pour effet de faire diminuer mon compte et augmenter le compte
d'autres personnes. Il sait bien qu'il lui suffit d'une piastre sur dix pour
répondre aux demandes de ceux qui veulent de l'argent en poche. Il sait bien
que s'il a 10 000 $ en réserves liquides, il peut prêter 100 000 $ (dix fois
autant) en argent de comptabilité.
En termes techniques, le pouvoir des banques de prêter 10
fois le montant de papier-monnaie qu’elles ont dans leurs coffres-forts est
appelé système de couvertures fractionnaires des banques. L’origine de ce
système remonte au Moyen-Age, lorsque les orfèvres devinrent banquiers, une
histoire vraie racontée par Louis Even :
Si vous avez un peu d'imagination, transportez-vous
quelques siècles en arrière, dans une Europe déjà vieille mais peu progressive
encore. En ce temps-là, la monnaie ne comptait pas pour beaucoup dans les
transactions commerciales courantes. La plupart de celles-ci étaient de simples
échanges directs, du troc. Cependant, les rois, les seigneurs, les riches et
les gros négociants possédaient de l'or et s'en servaient pour financer les
dépenses de leurs armées ou pour acquérir des produits étrangers .
.
Mais les guerres entre les seigneurs ou les nations et
les brigandages exposaient l'or et les bijoux des riches à tomber entre les
mains des pilleurs. Aussi les possesseurs d'or devenus trop nerveux prirent-ils
de plus l'habitude de confier la garde de leurs trésors aux orfèvres qui, à
cause du matériel précieux sur lequel ils travaillent, disposaient de voûtes
bien protégées. L'orfèvre recevait l'or, donnait un reçu au dépositaire et
conservait le métal pour celui-ci, moyennant une prime pour le service.
Naturellement, le propriétaire réclamait son bien, en tout ou en partie, quand
bon lui semblait.
Le négociant qui partait de Paris pour Marseille, ou de
Troyes pour Amsterdam, pouvait se munir d'or pour faire ses achats. Mais là
encore, il y avait danger d'attaque en cours de route; aussi s'appliqua-t-il à
persuader son vendeur de Marseille ou d'Amsterdam d'accepter, au lieu de métal,
un droit signé sur une partie du trésor en dépôt chez l'orfèvre de Paris ou de
Troyes. Le reçu de l'orfèvre témoignait de la réalité des fonds.
Il arriva aussi que le fournisseur d'Amsterdam, ou
d'ailleurs, réussit à faire accepter par son propre correspondant de Londres ou
de Gênes, en retour de services de transport, le droit qu'il avait reçu de son
acheteur français. Bref, peu à peu, les commerçants en vinrent à se passer
entre eux ces reçus au lieu de l'or lui-même, pour ne pas déplacer inutilement
celui-ci et risquer des attaques des mains des bandits. C'est-à-dire qu'un
acheteur, au lieu d'aller chercher un lingot d'or chez l'orfèvre pour payer son
créancier, donnait à ce dernier le reçu de l'orfèvre lui conférant un titre à
l'or conservé dans la voûte.
Au lieu de l'or, ce sont les reçus de l'orfèvre qui
changeaient de main. Tant qu'il n'y eut qu'un nombre limité de vendeurs et
d'acheteurs, ce n'était pas un mauvais système. Il restait facile de suivre les
pérégrinations des reçus.
Prêteur d’or
 Mais, l'orfèvre fit bientôt une découverte qui devait
affecter l'humanité beaucoup plus que le voyage mémorable de Christophe Colomb
lui-même. Il apprit, par expérience, que presque tout l'or qu'on lui avait
confié demeurait intact dans sa voûte. Les propriétaires de cet or se servant
de ses reçus dans leurs échanges commerciaux, c'est à peine si un sur dix
venait quérir du métal précieux.
Mais, l'orfèvre fit bientôt une découverte qui devait
affecter l'humanité beaucoup plus que le voyage mémorable de Christophe Colomb
lui-même. Il apprit, par expérience, que presque tout l'or qu'on lui avait
confié demeurait intact dans sa voûte. Les propriétaires de cet or se servant
de ses reçus dans leurs échanges commerciaux, c'est à peine si un sur dix
venait quérir du métal précieux.
La soif du gain, l'envie de devenir riche plus vite qu'en
maniant ses outils de bijoutier, aiguisèrent l'esprit de notre homme et lui
inspirèrent de l'audace. «Pourquoi, se dit-il, ne me ferais-je pas prêteur
d'or!» Prêteur, remarquez bien, d'or qui ne lui appartenait pas. Et comme il
n'avait pas l'âme droite de saint Eloi, il couva et mûrit cette idée. Il la
raffina encore davantage: «Prêteur d'or qui ne m'appartient pas, et avec
intérêt, va sans dire! Mieux que cela, mon cher maître (parlait-il à Satan?) —
au lieu d'or, je vais prêter des reçus et en exiger l'intérêt en or: cet or-là
sera bien a moi, et celui de mes clients restera dans mes voûtes pour couvrir de
nouveaux prêts.»
Il garda bien le secret de cette découverte, n'en parlant
même pas à sa femme qui s'étonnait de le voir souvent se frotter les mains de
joie. L'occasion de mettre ses desseins à exécution ne tarda pas, bien qu'il
n'eût pour s'annoncer ni «La Presse» ni «Le Star».
Un bon matin, en effet, un ami de l'orfèvre se présenta
chez lui pour réclamer une faveur. Cet homme n'était pas sans biens — une
maison ou une propriété en culture — mais il avait besoin d'or pour régler une
transaction. S'il pouvait seulement en emprunter, il le rendrait avec un
surplus en compensation; s'il y manquait, l'orfèvre saisirait sa propriété,
d'une valeur bien supérieure au prêt.
L'orfèvre ne se fit prier que pour la forme, puis
expliqua à son ami, d'un air désintéressé, qu'il serait dangereux pour lui de
sortir avec une forte somme d'argent dans sa poche: «Je vais vous donner un
reçu; c'est comme si je vous prêtais de l'or que je tiens en réserve dans ma
voûte; vous passerez ce reçu à votre créancier et s'il se présente, je lui
remettrai l'or; vous me devrez tant d'intérêt.»
Le créancier ne se présenta pas généralement. Il passa
lui-même le reçu à un autre. Entre temps, la réputation du prêteur d'or se
répandit. On vint à lui. Grâce à d'autres avances semblables par l'orfèvre, il
y eut bientôt plusieurs fois autant de reçus en circulation que d'or réel dans
les voûtes.
L'orfèvre lui-même avait bel et bien créé de la
circulation monétaire, à grand profit pour lui-même. Il triompha vite de sa
nervosité du début qui lui avait fait craindre une demande simultanée d'or par
un grand nombre de détenteurs de reçus. Il pouvait jouer dans une certaine
limite en toute sécurité. Quelle aubaine, de prêter ce qu'il n'avait pas et d'en
tirer intérêt — grâce à la confiance qu'on avait en lui et qu'il eut soin de
cultiver! Il ne risquait rien tant qu'il avait pour couvrir ses prêts une
réserve que son expérience jugeait suffisante. Si, d'autre part, un emprunteur
manquait à ses obligations et ne remettait pas le prêt l'échéance venue,
l'orfèvre acquérait la propriété gagée. Sa conscience s'émoussa vite et les
scrupules du début ne le tourmentèrent plus.
Création de crédit
D'ailleurs, il crut sage de changer la formule et quand
il prêta, au lieu d'écrire: «Reçu de Jacques Lespérance...» il écrivit: «Je
promets de payer au porteur...» Cette promesse circula comme de la monnaie
d'or. Incroyable, direz-vous. Allez donc, regardez vos billets de banque
d'aujourd'hui. Lisez le texte qu'ils portent. Sont-ils si différents et ne
circulent-ils pas comme monnaie?
Un figuier fertile, le système bancaire privé, créateur
et maître de la monnaie, avait donc poussé sur les voûtes de l'orfèvre. Les
prêts de celui-ci, sans déplacement d'or, étaient devenus les créations de
crédit du banquier. Les reçus primitifs avaient changé de forme, prenant celles
de simples promesses de payer sur demande. Les crédits payés par le banquier
s'appelèrent dépôts, ce qui fit croire au public que le banquier ne prêtait que
les sommes venues de déposants. Ces crédits entraient dans la circulation au
moyen de chèques négociables. Ils y déplacèrent en volume et en importance la
monnaie légale du souverain qui n'eut plus qu'un rôle secondaire. Le banquier
créait dix fois plus de circulation fiduciaire que l'Etat.
L’orfèvre devenu banquier
L'orfèvre mué en banquier fit une autre découverte: il
s'aperçut qu'une abondante mise de reçus (crédits) en circulation accélérait le
commerce, l'industrie, la construction; tandis que la restriction, la
compression des crédits, qu'il pratiqua d'abord dans les cas où il craignait
une course à l'or vers son établissement, paralysait l'essor commercial. Il
semblait, dans ce dernier cas, y avoir surproduction alors que les privations
étaient grandes; c'est parce que les produits ne se vendaient pas, faute de
pouvoir d'achat. Les prix baissaient, les banqueroutes se multipliaient, les
emprunteurs du banquier faisaient défaut à leurs obligations et le prêteur
saisissait les propriétés gagées.
Le banquier, très perspicace et très habile au gain, vit
ses chances, des chances magnifiques. Il pouvait monétiser la richesse des
autres à son profit: le faire libéralement, causant une hausse des prix, ou
parcimonieusement, causant une baisse des prix. Il pouvait donc manipuler la
richesse des autres à son gré, exploitant l'acheteur en temps d'inflation et
exploitant le vendeur en temps de dépression.
Le banquier, maître universel
Le banquier devenait ainsi le maître universel, il tenait
le monde à sa merci. Des alternances de prospérité et de dépression se
succédèrent. L'humanité s'inclina sous ce qu'elle prenait pour des cycles
naturels inévitables.
Pendant ce temps, savants et techniciens s'acharnaient à
triompher des forces de la nature et à développer les moyens de production. Et
l'on vit paraître l'imprimerie, se répandre l'instruction, surgir des villes et
des habitations meilleures, se multiplier et se perfectionner les sources de la
nourriture, du vêtement, des agréments de la vie. L'homme maîtrisa les forces
de la nature, attela la vapeur et l'électricité. Transformation et
développements partout — excepté dans le système monétaire.
Et le banquier s'enveloppa de mystère, entretint la
confiance que le monde soumis avait en lui, eut même l'audace de faire
proclamer par la presse, dont il contrôlait la finance, que les banques avaient
sorti le monde de la barbarie, ouvert et civilisé des continents. Savants et
travailleurs n'étaient plus considérés que secondaires dans la marche du
progrès. Aux masses, la misère et le mépris; au financier exploiteur, les
richesses et les honneurs!

Dans les années 1940, les banques prêtaient en moyenne 10
fois plus d’argent qu’elles en avaient en réserve. Cette proportion a changé
depuis. En 1967, la Loi canadienne des Banques permettait aux banques à charte
de créer seize fois le montant de leurs réserves en numéraire (billets de
banque et pièces de monnaie). Depuis 1980, les banques devaient détenir une
réserve minimale de 5% en argent liquide, ce qui leur donnaient
le droit de créer vingt fois ce montant.
En pratique, les banques peuvent prêter beaucoup plus que
cela, car elles peuvent augmenter leurs réserves en numéraire (billets de
banque) à volonté en achetant ces réserves de la banque centrale (Banque du
Canada) avec l'argent de comptabilité qu'elles ont créé. Ainsi, il a été établi
en 1982, devant un Comité d'enquête de la Chambre des Communes sur les profits
des banques, qu'en 1981, les banques à charte canadiennes dans leur ensemble
avaient prêté 32 fois leur capital. En 1990, aux Etats-Unis, le total des
dépôts dans les banques commerciales s'élevait à 3 000 milliards $, tandis que
leurs réserves en argent liquide s'élevait à 60 milliards $ seulement, soit
cinquante fois moins.
En décembre 1991, le Parlement canadien adoptait la plus
récente version de la Loi sur les banques (qui est renouvelée environ tous les
dix ans), qui stipulait qu'à partir de janvier 1994, le pourcentage d'argent
liquide que les banques doivent posséder passait à zéro pour cent! Ainsi, pour
le troisième trimestre de 1995, les banques canadiennes avaient prêté plus de
soixante-dix fois leurs réserves: pour 3,1 milliards de dollars en billets de
banque et pièces de monnaie, le total des prêts non-hypothécaires, pour la même
période, était de 216 milliards $, soit soixante-dix fois le montant d'argent
liquide existant dans le pays! Et en 1997, ce chiffre monte à 100 fois.
En d'autres mots, il n'y a plus aucune limite prescrite
par la loi. La seule limite à la création d'argent par les banques, c'est le
fait que des individus désirent encore être payés avec du papier-monnaie.
Alors, on comprend que les banques vont faire tout leur possible pour éliminer
tout simplement l'usage de papier-monnaie, en encourageant l'utilisation des
cartes de débit, paiement direct, etc., pour en venir finalement à
l'élimination complète de l'argent liquide. Elles prêcheront l'existence d'une
seule forme d'argent, l'argent électronique: l'argent ne sera plus du papier-monnaie,
mais un simple signal, ou unité d'information, dans un ordinateur.
Le destructeur d’argent
Nous venons donc de voir que les banques créent l’argent lorsqu’elle accordent un prêt. Le banquier crée l’argent,
non pas l’argent de papier-monnaie, mais l’argent fiduciaire (ou d’écriture),
lorsqu’il accorde un prêt aux individus ou gouvernements. Lorsque je quitte la
banque avec mon emprunt, il existe dans le pays une nouvelle source de chèque
qui n’existait pas avant. Avec le prêt de 100 000 $ qui m’a été accordé, le
montant total de tous les comptes bancaires dans le pays a augmenté de 100 000
$. Avec ce nouvel argent, je pourrai payer mes employés, acheter du matériel et
des machines, bref, construire ma nouvelle usine. Qui crée l’argent ? Le
banquier !
Le banquier, et le banquier seul, fait cette sorte
d'argent: l'argent d'écriture, l'argent dont dépend la marche des affaires.
Mais il ne donne pas l'argent qu'il fait. Il le prête. Il le prête pour un
certain temps, après quoi il faut le lui rapporter. Il faut rembourser.
Le banquier réclame de l'intérêt sur cet argent qu'il
fait. Dans mon cas, il est probable qu'il va me demander immédiatement 10 000 $
d'intérêt. Il va les retenir sur le prêt, et je sortirai de la banque avec un
compte net de 90 000 $, ayant signé la promesse de rapporter 100 000 $ dans un
an.
En construisant mon usine, je vais payer des hommes et
des choses, et vider sur le pays mon compte de banque de 90 000 $. Mais d'ici
un an, il faut que je fasse des profits, que je vende plue cher que je paie, de
façon à pouvoir, avec mes ventes, me bâtir un autre compte de banque d'au moins
100 000 $.
 Au bout de l'année, je vais rembourser, en tirant un
chèque sur mon compte accumulé de 100 000 $. Le banquier va me débiter de 100
000 $, donc m'enlever ce 100 000 $ que j'ai retiré du pays, et il ne le mettra
au compte de personne. Personne ne pourra plus tirer de chèque sur ce 100 000
$. C'est de l'argent mort.
Au bout de l'année, je vais rembourser, en tirant un
chèque sur mon compte accumulé de 100 000 $. Le banquier va me débiter de 100
000 $, donc m'enlever ce 100 000 $ que j'ai retiré du pays, et il ne le mettra
au compte de personne. Personne ne pourra plus tirer de chèque sur ce 100 000
$. C'est de l'argent mort.
L'emprunt fait naître l'argent.
Le remboursement fait mourir l'argent. Le banquier met l'argent au monde
lorsqu'il prête. Le banquier met l'argent dans le cercueil lorsqu'on lui
rembourse. Le banquier est donc aussi un destructeur d'argent.
Un banquier anglais distingué, Reginald McKenna,
qui fut un temps ministre des Finances de son pays (Chancelier de l'Echiquier),
puis plusieurs années chairman de la Midland Bank, une des cinq grosses banques
d'Angleterre, disait, en 1934, à une assemblée annuelle des actionnaires de
cette banque: «Le peuple ignore généralement que le volume de l'argent en
circulation dépend de l'action des banques. Tout prêt bancaire, direct ou par
découvert (overdraft), augmente le flot de crédit en circulation, et tout
remboursement d'un prêt bancaire diminue ce flot d'un montant égal au
remboursement.»
Et le système est tel que le remboursement doit dépasser
l'emprunt; le chiffre des décès doit dépasser le chiffre des naissances; la
destruction doit dépasser la fabrication.
Cela paraît impossible, et c'est collectivement
impossible. Si je réussis, un autre fait banqueroute; parce que, tous ensemble,
nous ne sommes pas capables de rapporter plus d'argent qu'il en a été fait. Le
banquier fait le capital, rien que le capital. Personne ne fait l'intérêt,
puisque personne autre ne fait l'argent. Mais le banquier demande quand même
capital et intérêt. Un tel système ne peut tenir que moyennant un flot
continuel et croissant d'emprunts. D'où un régime de dettes et la consolidation
du pouvoir dominateur de la banque.
La dette publique
Le gouvernement ne fait pas d'argent. Lorsqu'il ne peut
plus taxer ni emprunter des particuliers, par rareté d'argent, il emprunte des
banques. L'opération se passe exactement comme avec moi. La garantie, c'est
tout le pays. La promesse de rembourser, c'est la débenture. Le prêt d'argent,
c'est un compte fait par une plume et de l'encre.
L'opération se passe exactement comme avec moi. La
garantie, c'est tout le pays. La promesse de rembourser, c'est la débenture. Le
prêt d'argent, c'est un compte fait par une plume et de l'encre.
Ainsi, en octobre 1939, le gouvernement fédéral, pour
faire face aux premières dépenses de la guerre, demandait aux banques 80 000
000 $. Les banques ont avancé un compte de 80 millions sans rien enlever à
personne, donnant au gouvernement une base à chèques nouvelle de 80 millions.
Mais, en octobre 1941, le gouvernement devait rapporter aux banques 83 200 000
$. C'est l'intérêt en plus du capital.
Par les taxes, le gouvernement doit retirer du pays
autant d'argent qu'il y en a mis, 80 millions. Il faut qu'en plus il retire 3
millions qui n'y ont pas été mis, que ni le banquier ni personne n'a faits.
Passe encore que le gouvernement retrouve l'argent qui
existe, mais comment trouver de l'argent qui n'est jamais venu en existence? Le
fait est que le gouvernement ne le trouve pas et ajoute simplement à la dette
publique. Ainsi s'explique la dette publique croissant au rythme où le
développement du pays demande de l'argent nouveau. Tout argent nouveau vient
par le banquier sous forme de dette, réclamant plus d'argent qu'il en est émis.
Et la population du pays se trouve collectivement
endettée pour de la production que, collectivement, elle a faite elle-même!
C'est le cas pour la production de guerre. C'est le cas aussi pour la
production de paix: routes, ponts, aqueducs, écoles, églises, etc.
Le vice monétaire
La
situation se résume à cette chose inconcevable. Tout l'argent qui est en
circulation n'y est venu que par la banque. Même l'argent de métal ou de papier
ne vient en circulation que s'il est libéré par la banque.
Or la banque ne met l'argent en circulation qu'en le
prêtant et en le grevant d'un intérêt. Ce qui veut dire que tout l'argent en
circulation est venu de la banque et doit retourner à la banque quelque jour, mais
y retourner grossi d'un intérêt.
La banque reste propriétaire de l'argent. Nous n'en
sommes que les locataires. S'il yen a qui gardent l'argent plus longtemps, ou
même toujours, d'autres sont nécessairement incapables de remplir leurs
engagements de remboursements.
Multiplicité des banqueroutes de particuliers et de
compagnies, hypothèques sur hypothèques, et croissance continuelle des dettes
publiques, sont le fruit naturel d'un tel système.
L'intérêt sur l'argent à sa naissance est à la fois
illégitime et absurde, anti-social et antiarithmétique. Le vice monétaire est
donc un vice technique autant qu'un vice social.
A mesure que le pays se développe, en production comme en
population, il faut plus d'argent. Or on ne peut avoir d'argent nouveau qu'en s'endettant
d'une dette collectivement impayable.
Il reste donc le choix entre arrêter le développement ou
s'endetter; entre chômer ou contracter des emprunts impayables. C'est entre ces
deux choses-là qu'on se débat justement dans tous les pays.
Aristote, et après lui saint Thomas d'Aquin, écrivent que
l'argent ne fait pas de petits. Or le banquier ne met l'argent au monde qu'à
condition qu'il fasse des petits. Comme ni le gouvernement ni les particuliers
ne font d'argent, personne ne fait les petits réclamés par le banquier. Même
légalisé, ce mode d'émission reste vicieux et insultant.
Déchéance et abjection
Cette manière de faire l'argent du pays, en endettant
gouvernements et particuliers, établit une véritable dictature sur les
gouvernements comme sur les particuliers.
Le gouvernement souverain est devenu un signataire de
dettes envers un petit groupe de profiteurs. Le ministre, qui représente des
millions d'hommes, de femmes et d'enfants, signe des dettes impayables. Le
banquier, qui représente une clique intéressée à profiter et à dominer,
manufacture l'argent du pays.
 En l’absence de sang, les humains ne peuvent
survivre : alors il est approprié de comparer l’argent au sang économique
de la nation. Le Pape Pie XI écrivait en 1931 dans son encyclique Quadragesimo
anno (n. 106) : «Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui,
détenteurs et maîtres absolus de l'argent et du crédit, gouvernent le crédit et
le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent le sang à
l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que,
sans leur consentement, nul ne peut plus respirer.»
En l’absence de sang, les humains ne peuvent
survivre : alors il est approprié de comparer l’argent au sang économique
de la nation. Le Pape Pie XI écrivait en 1931 dans son encyclique Quadragesimo
anno (n. 106) : «Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui,
détenteurs et maîtres absolus de l'argent et du crédit, gouvernent le crédit et
le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent le sang à
l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que,
sans leur consentement, nul ne peut plus respirer.»
Quelques lignes plus loin, dans la même encyclique, le
Pape parle de la déchéance du pouvoir : les gouvernements sont déchus de
leurs nobles fonctions et sont devenus les valets des intérêts privés.
Le gouvernement, au lieu de piloter le pays, s'est
transformé en percepteur d'impôts; et une grosse tranche du revenu des taxes,
la tranche la plus sacrée, soustraite à toute discussion, est justement
l'intérêt sur la dette publique.
Aussi la législation consiste-t-elle surtout à taxer le
monde et à placer partout des restrictions à la liberté.
On a des lois pour protéger les remboursements aux
faiseurs d'argent. On n'en a pas pour empêcher un être humain de mourir de
misère.
Quant aux individus, l'argent rare développe chez eux la
mentalité de loups. En face de l'abondance, c'est à qui obtiendra le signe trop
rare qui donne droit à l'abondance. D'où, concurrence, dictatures patronales,
chicanes domestiques, etc. Un petit nombre mange les autres; le grand nombre
gémit, plusieurs dans une abjection déshonorante.
Des malades restent sans soin; des enfants reçoivent une
nourriture inférieure ou insuffisante; des talents ne peuvent se développer;
des jeunes gens ne peuvent se placer ni fonder un foyer; des cultivateurs
perdent leur ferme; des industriels font banqueroute; des familles vivotent
péniblement — le tout sans autre justification que le manque d'argent. La plume
du banquier impose au public les privations, aux gouvernements la servitude.
Soulignons aussi un point frappant: C'est la production
qui donne de la valeur à l'argent. Une pile d'argent, sans produits pour y
répondre, ne fait pas vivre. Or, ce sont les cultivateurs, les industriels, les
ouvriers, les professionnels, le pays organisé, qui font les produits,
marchandises ou services. Mais ce sont les banquiers qui font l'argent basé sur
ces produits. Et cet argent, qui tire sa valeur des produits, les banquiers se
l'approprient et le prêtent à ceux qui font les produits. C'est un vol
légalisé.
 Un
système d’argent-dette - L’Ile des naufragés
Un
système d’argent-dette - L’Ile des naufragés
La façon dont l’argent est créé sous forme de dette par
les banques privées est bien expliquée dans la parabole de L'Ile des
Naufragés, de Louis Even, dans laquelle, comme dans toute société, le
système économique peut être divisé en deux: système producteur et système
financier. D'un côté, se trouvent cinq naufragés sur une île, qui produisent
les différentes choses nécessaires à la vie; et de l'autre, un banquier qui
leur prête de l'argent. Pour simplifier notre exemple, disons qu'il y a un
seul; emprunteur au nom de toute la communauté, que nous appellerons Paul.
Paul décide, au nom de la communauté, d'emprunter du
banquier un montant suffisant pour faire marcher l'économie sur l'île, disons
100 $, à 6% d'intérêt. A la fin de l'année, Paul doit rembourser l'intérêt de
6% à la banque, soit 6 $. $100 moins 6 $ = 94 $, il reste donc 94 $ en
circulation sur l'île. Mais la dette de 100 $ demeure. Le prêt de 100 $ est
donc renouvelé, et un autre 6 $ doit être payé à la fin de la deuxième année.
94 $ moins 6 $, il reste 88 $ en circulation. Si Paul continue ainsi à payer 6
$ d'intérêt à chaque année, au bout de 17 ans, il ne restera plus d'argent sur
l'île. Mais la dette de 100 $ demeurera, et le banquier sera autorisé à saisir
toutes les propriétés des habitants de l'île.
La production de l'île avait augmenté, mais pas l'argent.
Ce ne sont pas des produits que le banquier exige, mais de l'argent. Les
habitants de l'île fabriquaient des produits, mais pas d'argent. Quand bien
même les cinq habitants de l'île travailleraient jour et nuit, cela ne fera pas
apparaître un sou de plus en circulation. Seul le banquier a le droit de créer
l'argent. Il semblerait donc que pour la communauté, il n'est pas sage de payer
l'intérêt annuellement.
Reprenons donc notre exemple au début. A la fin de la
première année, Paul choisit donc de ne pas payer l'intérêt, mais de
l'emprunter de la banque, augmentant ainsi le prêt à 106 $. (C'est ce que nos
gouvernements font, puisqu'ils doivent emprunter pour payer seulement l'intérêt
sur la dette.) «Pas de problème, dit le
banquier, cela ne représente que 36¢ de plus d'intérêt, c'est une goutte sur le
prêt de 106 $!» La dette à la fin de la deuxième année est donc: 106 $ plus
l'intérêt à 6% de 106 $ — 6,36 $ — pour une dette totale de 112,36 $. Au bout
de 5 ans, la dette est de 133,82 $, et l'intérêt est de 7,57 $. «Pas si mal, se
dit Paul, l'intérêt n'a grossi que de 1,57 $ en 5 ans.» Mais quelle sera la
situation au bout de 50 ans?
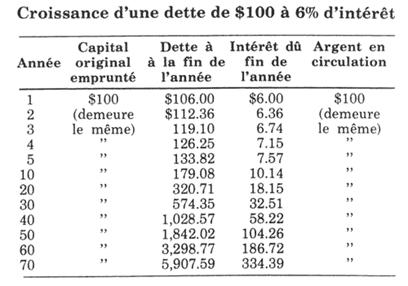 La dette augmente relativement peu les premières années, mais augmente
ensuite très rapidement. A remarquer, la dette augmente à chaque année, mais le
montant original emprunté (argent en circulation) demeure toujours le même: 100
$. En aucun temps la dette ne peut être payée, pas même à la fin de la première
année: seulement 100 $ en circulation et une dette de 106 $. Et à la fin de la
cinquantième année, tout l'argent en circulation (100 $), n'est même pas suffisant
pour payer l'intérêt sur la dette: 104,26 $.
La dette augmente relativement peu les premières années, mais augmente
ensuite très rapidement. A remarquer, la dette augmente à chaque année, mais le
montant original emprunté (argent en circulation) demeure toujours le même: 100
$. En aucun temps la dette ne peut être payée, pas même à la fin de la première
année: seulement 100 $ en circulation et une dette de 106 $. Et à la fin de la
cinquantième année, tout l'argent en circulation (100 $), n'est même pas suffisant
pour payer l'intérêt sur la dette: 104,26 $.
Tout l'argent en circulation est un prêt, et doit
retourner à la banque grossi d'un intérêt. Le banquier
crée l'argent et le prête, mais il se fait promettre de se faire rapporter tout
cet argent, plus d'autre qu'il ne crée pas. Seul le banquier crée l'argent: il
crée le capital, mais pas l'intérêt (Dans l'exemple plus haut, il crée 100 $,
mais demande 106 $). Le banquier demande de lui rapporter, en plus du capital
qu'il a créé, l'intérêt qu'il n'a pas créé, et que personne n'a créé.
La
dette publique est faite d'argent qui n'existe pas, qui n'a jamais été mis au
monde, mais que le gouvernement s'est tout de même engagé à rembourser. C'est
un contrat impossible, que les financiers représentant comme un «contrat saint»
à respecter, même si les humains dussent en crever.
L’intérêt composé
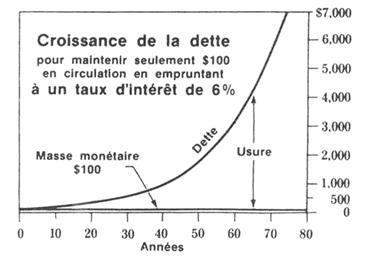 L'augmentation
soudaine de la dette après un certain nombre d'années s'explique par l'effet de
l'intérêt composé. A la différence de l'intérêt simple, qui est payé seulement
sur le capital original emprunté, l'intérêt composé est l'intérêt payé à la
fois sur le capital et sur l'intérêt non payé, qui s'additionne au capital.
L'augmentation
soudaine de la dette après un certain nombre d'années s'explique par l'effet de
l'intérêt composé. A la différence de l'intérêt simple, qui est payé seulement
sur le capital original emprunté, l'intérêt composé est l'intérêt payé à la
fois sur le capital et sur l'intérêt non payé, qui s'additionne au capital.
En mettant sur un graphique la dette cumulative des cinq
habitants de l'île, où la ligne horizontale est graduée en années, et la ligne
verticale graduée en dollars, et en joignant tous les points obtenus pour
chaque année par une ligne, nous obtenons une courbe qui permet de mieux voir
l'effet de l'intérêt composé et la croissance de la dette: La pente de la
courbe augmente peu durant les premières années, mais s'accentue rapidement
après 30 ou 40 ans. Les dettes de tous les pays du monde suivent le même
principe et augmentent de la même manière. Etudions par exemple la dette du
Canada.
La dette du Canada
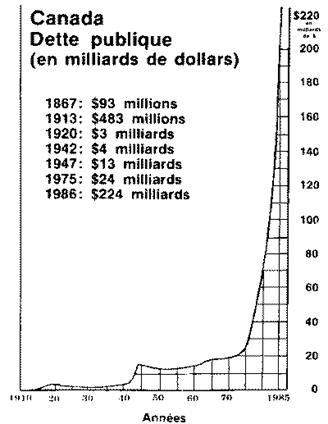 Chaque année, le gouvernement
canadien établit un budget où il prévoit les dépenses et les recettes pour
l’année. Si le gouvernement reçoit plus d’argent qu’il n’en dépense, il y aura
un surplus ; s’il en dépense plus qu’il en reçoit, il y aura un déficit.
Ainsi, pour l’année financière 1985-86, le gouvernement fédéral a eu des
dépenses de 105 milliards $ et des recettes de 71,2 milliards $, ce qui donne
un déficit de 33,8 milliards $. La dette fédérale est la somme de tous les
déficits budgétaires depuis que le Canada existe (Confédération de 1867).
Chaque année, le gouvernement
canadien établit un budget où il prévoit les dépenses et les recettes pour
l’année. Si le gouvernement reçoit plus d’argent qu’il n’en dépense, il y aura
un surplus ; s’il en dépense plus qu’il en reçoit, il y aura un déficit.
Ainsi, pour l’année financière 1985-86, le gouvernement fédéral a eu des
dépenses de 105 milliards $ et des recettes de 71,2 milliards $, ce qui donne
un déficit de 33,8 milliards $. La dette fédérale est la somme de tous les
déficits budgétaires depuis que le Canada existe (Confédération de 1867).
Ainsi, le déficit pour l'année 1986, 33,8 milliards $,
s'ajoute à la dette de 1985, 190,3 milliards $, pour une dette totale de 224
milliards $ en 1986. En janvier 1994, la dette du gouvernement canadien
atteignait le cap des 500 milliards $. (Si le gouvernement canadien a réussi à
équilibrer son budget depuis quelques années, c’est parce qu’il a transféré son
déficit aux provinces et municipalités, les obligeant à couper dans les soins
de santé et autres services essentiels. Cela n’empêche pas la dette totale de
continuer d’augmenter inexorablement.)
Lors de la formation du Canada en 1867 (l’union de quatre
provinces : Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Ecosse), la
dette du pays était de 93 millions $. La première grande augmentation est
survenue durant la Première Guerre mondiale (1914-1918), où la dette publique
du Canada est passée de 483 millions $ en 1913 à 3 milliards en 1920. La
seconde grande hausse est intervenue durant la Deuxième Guerre mondiale
(1939-1945), où la dette est passée de 4 milliards $ en 1942 à $13 milliards en
1947. Ces deux hausses peuvent s'expliquer par le fait que le gouvernement dut
emprunter de grandes sommes d'argent pour sa participation à ces deux guerres.
Mais comment expliquer la hausse phénoménale des vingt
dernières années, alors que la dette passait de 24 milliards $ en 1975 à 224
milliards $ en 1986, puis à 575 milliards $ en 1996, alors que le Canada était
en temps de paix et n'a pas eu à emprunter pour la guerre ?
C'est l'effet de l'intérêt composé, comme dans
l'exemple de l'Ile des Naufragés. Dans cet exemple, le taux d'intérêt demeurait
à 6%; si ce taux augmente, la dette augmentera encore plus rapidement (on se
souviendra qu'en 1981, les taux d'intérêts avaient atteint un sommet de 22%).
Il existe une grande différence entre des taux de 6%,
10%, ou 20%, quand on parle d'intérêt composé. Ainsi, si vous empruntez un
dollar à intérêt composé, voici ce que vous aurez à payer au bout de 100 ans:
à 1%.............................2,75 $
à 2%...........................19,25 $
à 3%.........................340,00 $
à 10%...................13 809,00 $
à 12%..............1 174 405,00 $
à 18%.............15 145 207,00 $
à 24%...........251 799 494,00 $
A 50%, il n'y aurait pas assez d'argent dans le monde
entier pour payer votre emprunt d'un dollar! Un autre exemple de l'intérêt
composé: un sou (1¢) emprunté à 1% au temps du Christ (1er janvier de l'an 1)
aurait donné en 1986 une dette de 3,8 millions $. A 2%, on devrait, non pas le
double seulement, mais 314 millions de fois ce montant: 1,2 suivi de 12 zéros
(un milliard de millions!).
Il existe une formule pour savoir dans combien de temps
un montant double à intérêt composé, c'est la «Règle de 72»: Vous divisez 72
par le taux d'intérêt choisi, et cela vous donne le nombre d'années. Par
exemple, à 10%, ça prend 7,2 ans pour que le montant double (72 divisé par 10).
Tout cela pour démontrer que tout intérêt demandé sur de
l'argent créé, même à un taux de 1%, est de l'usure, un vol, une injustice. Dans
son rapport de novembre 1993, le vérificateur général du Canada disait que sur
la dette nette de 423 milliards $ accumulée par le gouvernement canadien de
1867 à 1992, seulement 37 milliards $ avaient été dépensés pour des biens et
services, alors que le reste (386 milliards $, ou 91% de la dette) consistait
en frais d'intérêt, ce qu'il a coûté au gouvernement pour emprunter ce 37
milliards $ (c'est comme si le gouvernement avait emprunté ce 37 milliards $ à
un taux de 1043%, et les avait ainsi remboursé plus de dix fois !).
La dette des Etats-Unis
 La dette
des Etats-Unis suit la même courbe que celle du Canada, mais avec des nombres
dix fois plus gros. Comme c'était le cas pour le Canada, les premières hausses
significatives de la dette publique des Etats-Unis ont eu lieu durant les
périodes de guerre: Guerre Civile américain (1861-65), Première et Deuxième
Guerres mondiales. De 1975 à 1986, la dette est passée de 533 milliards $ à
2073 milliards $. En date du 5 septembre 2006, cette dette était de 8500
milliards $ (28 490 $ pour chaque citoyen américain), et continue de croître de
façon exponentielle. Pour l’année fiscale 2004, les frais d’intérêt ont été de
321 milliards.)
La dette
des Etats-Unis suit la même courbe que celle du Canada, mais avec des nombres
dix fois plus gros. Comme c'était le cas pour le Canada, les premières hausses
significatives de la dette publique des Etats-Unis ont eu lieu durant les
périodes de guerre: Guerre Civile américain (1861-65), Première et Deuxième
Guerres mondiales. De 1975 à 1986, la dette est passée de 533 milliards $ à
2073 milliards $. En date du 5 septembre 2006, cette dette était de 8500
milliards $ (28 490 $ pour chaque citoyen américain), et continue de croître de
façon exponentielle. Pour l’année fiscale 2004, les frais d’intérêt ont été de
321 milliards.)
Et ce
n’est que la pointe de l’iceberg : s’il y a les dettes publiques, il
existe aussi les dettes privées! Le gouvernement fédéral est le plus gros
emprunteur au pays, mais il n’est pas le seul : il y a aussi les individus
et les compagnies. Aux Etats-Unis, en 1992, la dette publique était de $4000
milliards, et la dette totale de 16 000 milliards, avec une masse monétaire de
seulement 950 millions $. En 2006, la dette totale (Etats, compagnies et
individus) dépassent les 41 000 milliards!
LEÇON 4 —
LA SOLUTION: UN ARGENT SANS DETTE CRÉÉ PAR LA SOCIÉTÉ
L’intérêt à
payer sur la dette augmente dans la même proportion que la dette, puisque c’est
un pourcentage de cette dette. Pour financer sa dette, le gouvernement émet des
bons du Trésor et autres obligations, la plupart achetés par les banques à
charte privées.
Concernant la vente de ces
obligations aux banques, le gouvernement est un vendeur imbécile: il ne vend
pas ses obligations aux banques, il en fait cadeau, puisque ces obligations ne
coûtent absolument rien aux banques, car elles créent l'argent pour les
acheter. Non seulement les banques obtiennent ces obligations pour rien, mais
elles en retirent de l'intérêt (payé par les taxes des contribuables).

 Est révélateur sur ce sujet l'échange qui eut lieu entre
M. Wright Patman (photo de gauche), Président du Comité de la Chambre des
Représentants des Etats-Unis sur la Banque et le Numéraire, et M. Marriner
Eccles (photo de droite), Président de la «Federal Reserve Board» (Banque
centrale des Etats-Unis), le 30 septembre 1941, au sujet de la création de 2
milliards $ par la «Réserve Fédérale»:
Est révélateur sur ce sujet l'échange qui eut lieu entre
M. Wright Patman (photo de gauche), Président du Comité de la Chambre des
Représentants des Etats-Unis sur la Banque et le Numéraire, et M. Marriner
Eccles (photo de droite), Président de la «Federal Reserve Board» (Banque
centrale des Etats-Unis), le 30 septembre 1941, au sujet de la création de 2
milliards $ par la «Réserve Fédérale»:
Patman: «Où avez-vous pris l'argent pour acheter ces 2
milliards $ d'obligations du gouvernement?»
Eccles: «Nous les avons créés.»
Patman: «Avec quoi?»
Eccles: «Avec le droit d'émettre du crédit, de l'argent.»
Patman: «Et il n'y a rien d'autre en arrière, sauf le
crédit du gouvernement.»
Eccles: «Nous avons les obligations du gouvernement.»
Patman: «C'est exact, le crédit du gouvernement.»
Cela nous met sur la piste de la solution au problème de
la dette: si les obligations sont basées sur le crédit du gouvernement,
pourquoi le gouvernement a-t-il besoin de passer par les banques pour faire
usage de son propre crédit?
Ce n'est pas le banquier qui donne la valeur à l'argent,
mais le crédit du gouvernement, de la société. La seule chose que fait le
banquier dans cette transaction, c'est d'apporter une écriture, des chiffres,
qui permettent au pays d'utiliser sa propre capacité de production, de faire
usage de ses propres richesses.
L'argent n'est pas autre chose que cela: un chiffre. Un
chiffre qui donne droit aux produits. L'argent n'est qu'un signe, une création
de la loi (Aristote). L'argent n'est pas la richesse, mais le signe qui donne
droit à la richesse. Sans produits, l'argent n'a aucune valeur. Alors, pourquoi
payer pour des chiffres? Pourquoi payer pour ce qui ne coûte rien à fabriquer?
Et puisque cet argent est basé
sur la capacité de production de la société, cet argent appartient aussi à la
société. Alors, pourquoi la société devrait-elle payer les banquiers pour
l'usage de son propre argent? Pourquoi payer pour l'usage d'un bien qui nous
appartient? Pourquoi le gouvernement n'émet-il pas directement son argent, sans
passer par les  banques?
banques?
Même le premier gouverneur de la Banque du Canada a admis
que le gouvernement fédéral avait le droit d’émettre sa propre monnaie. On posa
la question suivante à Graham Towers, qui fut gouverneur de la Banque du Canada
de 1935 à 1951, lors de sa comparution devant le Comité parlementaire canadien
de la Banque et du Commerce, en avril 1939:
Question : «Pourquoi un
gouvernement ayant le pouvoir de créer l'argent devrait-il céder ce pouvoir à
un monopole privé, et ensuite emprunter ce que le gouvernement pourrait créer
lui-même, et payer intérêt jusqu'au point d'une faillite nationale?»
Réponse de Towers: «Si le gouvernement veut changer la
forme d'opération du système bancaire, cela est certainement dans le pouvoir du
parlement.»
 L’inventeur américain Thomas Edison déclarait : «Si
notre nation peut émettre une obligation d'une valeur d'un dollar, elle peut émettre
un billet d'un dollar. L'élément qui fait que l'obligation est bonne est le
même qui fait que le dollar est bon. La différence entre l'obligation et le
dollar est que l'obligation permet aux prêteurs d'argent de ramasser 2 fois le
montant de l'obligation plus un 20 pour cent additionnel, alors que l'argent
mis en circulation ne paye que ceux qui ont directement contribué à la
construction du barrage de quelque manière utile...
L’inventeur américain Thomas Edison déclarait : «Si
notre nation peut émettre une obligation d'une valeur d'un dollar, elle peut émettre
un billet d'un dollar. L'élément qui fait que l'obligation est bonne est le
même qui fait que le dollar est bon. La différence entre l'obligation et le
dollar est que l'obligation permet aux prêteurs d'argent de ramasser 2 fois le
montant de l'obligation plus un 20 pour cent additionnel, alors que l'argent
mis en circulation ne paye que ceux qui ont directement contribué à la
construction du barrage de quelque manière utile...
«Il est
absurde de dire que notre pays peut émettre 30 millions $ en obligations, et
pas 30 millions $ en monnaie. Les deux sont des promesses de payer, mais l'un
engraisse les usuriers, et l'autre aiderait le peuple. Si l'argent émis par le
gouvernement n'était pas bon, alors, les obligations ne seraient pas bonnes non
plus. C'est une situation terrible lorsque le gouvernement, pour augmenter la
richesse nationale, doit s'endetter et se soumettre à payer des intérêts
ruineux à des hommes qui contrôlent la valeur fictive de l'or.»
Puis voici quelques questions qui sont souvent posées aux
créditistes:
Question: Le gouvernement a-t-il le droit de créer son
argent? Cet argent serait-il aussi bon que celui des banques?
Réponse:
Bien sûr que le gouvernement a le droit, puisque c'est
lui-même qui a donné ce droit aux banques. Que le gouvernement se refuse un
privilège qu'il accorde lui-même aux banques, c'est le comble de l'imbécillité!
C'est d'ailleurs le premier devoir de chaque pays souverain d'émettre sa propre
monnaie, mais tous les pays aujourd'hui ont injustement cédé ce droit à des
compagnies privées, les banques à charte. Le premier pays à avoir ainsi cédé à
des compagnies privées son pouvoir de créer la monnaie fut la Grande-Bretagne,
en 1694. Au Canada et aux Etats-Unis, ce droit fut abandonné en 1913.
Question: N'y a-t-il pas danger que le gouvernement abuse
de ce pouvoir et émette trop d'argent, et que cela fasse de l'inflation?
N'est-il pas préférable de laisser ce pouvoir aux banquiers, afin de laisser ce
pouvoir à l'abri des caprices des politiciens?
Réponse:
L'argent émis par le gouvernement ne serait pas plus inflationniste que celui
émis par les banques: ce seraient les mêmes chiffres, basés sur la même
production du pays. La seule différence, c'est que le gouvernement n'aurait pas
à s'endetter ni à payer de l'intérêt pour obtenir ces chiffres.
Au
contraire, la première cause de l'inflation, c'est justement l'argent créé sous
forme de dette par les banques: l'inflation, ça veut dire les prix qui
augmentent. Or, l'obligation pour les compagnies et gouvernements qui
empruntent de ramener à la banque plus d'argent qu'il en est sorti oblige
justement les compagnies à gonfler leurs prix, et les gouvernements à gonfler
leurs taxes.
Quel est le
moyen qu'utilise actuellement le gouverneur de la Banque du Canada pour
combattre l'inflation? Précisément ce qui la fait augmenter en pratique, soit
hausser les taux d'intérêts! Comme l'ont dit certains premiers ministres
provinciaux, «c'est comme essayer d'éteindre un feu en l'arrosant d'essence.»
Mais il est
bien évident que si le gouvernement canadien se mettait à créer ou imprimer de
l'argent n'importe comment, sans aucune limite, selon les caprices des hommes
au pouvoir, et sans relation avec la production existante, on aurait de
l'inflation, et l'argent perdrait sa valeur. Mais ce n'est pas du tout cela que
les créditistes proposent.
Ce que les
créditistes de Vers Demain proposent, lorsqu'ils parlent d'argent fait par le
gouvernement, c'est que l'argent soit ramené à son rôle propre, qui est d'être
un chiffre qui représente les produits, ce qui en fait est une simple
comptabilité. Et puisque l'argent n'est qu'un système de comptabilité, il
suffirait d'établir une comptabilité exacte.
Le gouvernement
nommerait une commission de comptables, un organisme indépendant, qui serait
appelé «Office National de Crédit» (au Canada, la Banque du Canada pourrait
très bien accomplir cette fonction, si le gouvernement lui en donnait l'ordre).
Cet Office National de Crédit serait chargé d'établir une comptabilité juste,
où l'argent ne serait que le reflet, l'expression financière exacte des
réalités économiques: la production serait exprimée par un actif, et la
destruction par un passif. Et comme on ne peut consommer plus que ce qui est
produit, le passif ne pourrait jamais dépasser l'actif, et tout endettement
serait impossible.
En pratique,
voici comment cela fonctionnerait: l'argent nouveau serait émis par l'Office
National de Crédit au rythme de la production nouvelle, et retiré de la
circulation au rythme de la consommation de cette production (La brochure de
Louis Even, Une finance saine et efficace, explique ce mécanisme en
détail). Il n'y aurait donc aucun danger d'avoir plus d'argent que de produits:
on aurait un équilibre constant entre l'argent et les produits, l'argent
garderait toujours sa même valeur, et toute inflation serait impossible.
L'argent ne serait pas émis selon les caprices du gouvernement, puisque la
commission de comptables de l'Office National de Crédit ne ferait qu'agir selon
les faits, selon ce que les Canadiens produisent et consomment.
La meilleure façon d'empêcher les prix de monter, c'est
de les faire baisser. Le Crédit Social propose de plus un mécanisme pour
abaisser les prix, appelé «escompte compensé», qui permettrait aux
consommateurs de pouvoir se procurer toute la production mise en vente avec le
pouvoir d'achat dont ils disposent, en abaissant le prix de vente des produits
(un escompte) d'un certain pourcentage, pour que le prix total de tous les prix
soit équivalent au pouvoir d'achat total disponible des consommateurs. Cet
escompte est ensuite remboursé au marchand par l'Office National de Crédit. (Cela
sera expliqué dans une autre leçon.)
Si le
gouvernement créait son propre argent selon les besoins de la société, il
serait automatiquement capable de payer tout ce qu'il est capable de produire,
et n'aurait plus besoin d'emprunter des institutions financières de l'étranger
ou d'ici. Les seules taxes que les gens paieraient, seraient pour les services
qu'ils consomment. On n'aurait plus à payer trois ou quatre fois le prix de développements
publics à cause des intérêts.
Ainsi, quand
il serait question d'un nouveau projet, le gouvernement se demanderait pas:
«A-t-on l'argent?», mais «A-t-on les matériaux, les travailleurs pour le
réaliser?» Si oui, l'argent viendrait automatiquement financier cette
production nouvelle. La population canadienne pourrait réellement vivre selon
ses véritables moyens, les moyens physiques, les possibilités de production. En
d'autres mots, tout ce qui est physiquement possible serait rendu
financièrement possible. Il n'y aurait plus à proprement parler de problèmes
financiers, la seule limite serait la capacité de production du pays. Le
gouvernement pourrait financer tous les développements et programmes sociaux
que la population réclamerait et qui seraient physiquement réalisables.
Certains diront que si on ne veut pas s'endetter, on n'a
qu'à ne pas emprunter. Mais comme on l'a vu précédemment, si personne
n'empruntait d'argent de la banque, il n'y aurait tout simplement pas un sou en
circulation, puisque tout l'argent est créé par les banques sous forme de prêt.
Seulement pour maintenir le même niveau d'argent en circulation, il faut
s'endetter à perpétuité. D'ailleurs, il n'existe même pas assez d'argent dans la pays pour payer la dette fédérale... sans tenir comptes
des dettes des provinces, des compagnies, et des consommateurs!
Dans le système actuel, faire des coupures pour réduire
le déficit et tenter de rembourser la dette, c'est absurde et même criminel,
puisque cela ne fait que rendre l'argent plus rare. Loin d'apporter la
prospérité, cela amènerait une crise économique sans précédent. L'argent
pouvant être considéré comme étant la sang de la vie économique, ça serait
comme vider l'organisme économique de son sang, et entraîner la mort à brève
échéance.
Citons encore l'échange entre MM. Patman et Eccles, au
Comité de la Chambre des Représentants des Etats-Unis sur la Banque et le
Numéraire, le 30 septembre 1941:
Patman: «Vous avez déclaré que les gens devraient payer
leurs dettes au lieu de dépenser leur argent. Vous vous rappelez de cette
déclaration, je suppose?»
Eccles: «C'était en rapport avec les achats à crédit.»
Patman: «Croyez-vous que les gens devraient payer leurs
dettes quand ils le peuvent, généralement?»
Eccles: «Je pense que cela dépend en grande partie de
l'individu; mais, bien sûr, s'il n'y avait pas de dette dans notre système
monétaire...»
Patman: «C'est la question que je voulais vous demander.»
Eccles: «Il n'y aurait plus du tout d'argent.»
Patman: “Supposons que tout le monde paie ses dettes, il
n'y aurait plus d'argent pour faire marcher les affaires?»
Eccles: «C'est exact.»
Patman: «En d'autres mots, notre système est basé
entièrement sur la dette.»
Comment espérer se sortir de dette lorsque tout l'argent
pour payer la dette est créé en créant une dette? Dans le système actuel,
l’équilibre du budget est une camisole absurde. Ce qu’il faut équilibrer, c’est
la capacité de payer à la capacité de produire, et non pas à la capacité de
taxer. Puisque c’est la capacité de produire qui est la réalité, c’est la
capacité de payer qu’il faut modeler sur la capacité de produire : rendre
financièrement possible ce qui est physiquement réalisable.
Rembourser la dette?
S'acquitter d'une dette est simple justice si la dette
est juste. Dans le cas de la dette publique, la justice est de ne point faire
de dette, tout en développant le pays. Premièrement, cesser de bâtir des
dettes, et pour la dette existante, les seules obligations à reconnaître
seraient celles des épargnants, de ceux qui n'ont pas le pouvoir de créer
l'argent. La dette diminuerait au cours des années, au fur et à mesure que les
obligations viendraient à échéance.
Le gouvernement honorerait intégralement les seules
dettes dont l'origine représente un déboursé réel de la part du créancier:
obligations acquises par les individus, et non pas les obligations acquises par
l'argent créé par les banquiers, qui ne sont que des dettes fictives, créées
d'un trait de plume. Ces dettes dues aux banquiers, le gouvernement n'aurait
qu'à les effacer, ce qui signifierait l'effacement immédiat de la plus grande
partie des dettes du Canada et des autres pays développés, et pratiquement la
totalité des dettes des pays du Tiers-Monde). Les banques ne perdraient
absolument rien, puisque c'est elles-mêmes qui avaient créé cet argent, qui
n'existait pas avant.
On voit donc que le Pape Jean-Paul II a tout à fait
raison de demander l'abolition des dettes publiques pour le Jubilé de l'an
2000. Dans sa lettre apostolique sur la préparation de ce Jubilé, le Saint-Père
dit que, dans l'esprit du Livre du Lévitique (25, 8-28), il faut penser à «une
réduction importante, sinon à un effacement total, de la dette internationale
qui pèse sur le destin de nombreuses nations.» Dans ce livre de l'Ancien
Testament, il est fait mention de l'année du jubilé qui était célébrée par les
Israélites à tous les cinquante ans, et où toutes les dettes étaient effacées.
Contrôle social de l’argent
C'est saint Louis, roi de France, qui disait: Le premier
devoir d'un roi est de frapper l'argent lorsqu'il en manque pour la bonne vie
économique de ses sujets.
Il n'est pas du tout nécessaire ni recommandable de
supprimer les banques, ni de les nationaliser. Le banquier est un expert en
comptabilité et en placements: qu'il continue à recevoir et faire fructifier
les épargnes, prenant sa part de profit. Mais manufacturer l'argent est un acte
de souveraineté qui ne doit pas être lié à la banque. Il faut sortir la
souveraineté de la banque et la replacer entre les mains de la nation.
L'argent de chiffres est une bonne invention moderne, qu'il
faut garder. Mais au lieu d'avoir leur origine sous une plume privée, à l'état
de dette, les chiffres qui servent d'argent doivent naître sous la plume d'un
organisme national, à l'état d'argent serviteur.
Rien donc à bouleverser dans la propriété ni dans les
expertises. Pas besoin de supprimer l'argent actuel pour en mettre d'autre à sa
place. Il faut seulement qu'un organisme monétaire social ajoute à l'argent
qu'il y a déjà d'autre argent de même nature, à mesure des possibilités du pays
et des besoins de la population.
On doit cesser de souffrir de privations lorsqu'il y a
tout ce qu'il faut dans le pays pour placer l'aisance dans chaque foyer.
L'argent doit venir d'après la capacité de produire du pays et d'après les
désirs des consommateurs vis-à-vis de biens utiles possibles.
C'est donc l'ensemble des producteurs et l'ensemble des
consommateurs, toute la société, qui, en produisant les biens en face des
besoins, détermine la quantité d'argent nouveau qu'un organisme agissant au nom
de la société doit ajouter de temps en temps, à mesure des développements du
pays. Le peuple retrouverait ainsi son droit de vivre, sa pleine vie humaine,
en rapport avec les ressources du pays et les grandes possibilités modernes de
production.
Le peuple retrouverait ainsi son droit de vivre, sa
pleine vie humaine, en rapport avec les ressources du pays et les grandes
possibilités modernes de production.
A qui l’argent neuf?
L'argent
doit donc être mis au monde à mesure que le rythme de la production et les
besoins de la distribution l'exigent. Mais à qui appartient cet argent neuf en
venant au monde? — Cet argent appartient aux citoyens eux-mêmes. Pas au
gouvernement, qui n'est pas le propriétaire du pays, mais seulement le gardien
du bien commun. Pas non plus aux comptables de l'organisme monétaire national:
comme les juges, ils remplissent une fonction sociale et sont payés
statutairement par la société pour leurs services.
A quels
citoyens? — A tous. Ce n'est pas un salaire. C'est une injection d'argent
nouveau dans le public, pour permettre au public consommateur de se procurer
des produits faits ou facilement réalisables, qui n'attendent qu'un pouvoir
d'achat suffisant pour les mettre en mouvement.
On ne peut
une minute se représenter que l'argent nouveau, sorti gratuitement d'un
organisme social, appartienne seulement à un ou quelques individus en
particulier. Il n'y a pas d'autre moyen, en toute justice, de mettre cet argent
nouveau en circulation qu'en le distribuant également entre tous les citoyens
sans exception. C'est en même temps le meilleur moyen de rendre l'argent
effectif, puisque cette distribution le répartit dans tout le pays.
Supposons
que le comptable qui agit au nom de la nation, constatant qu'il manque 1
milliard de dollars pour répondre aux réalités, en décide l'émission. Cette
émission peut être de l'argent de chiffres, simple inscription dans un livre,
comme celui du banquier aujourd'hui.
Mais,
puisqu'il y a 31 millions de Canadiens et 1 milliard à distribuer, cela fait
32,25 $ pour chacun. Le comptable va donc faire inscrire 32,25 $ dans le compte
de chaque citoyen. Ces comptes individuels peuvent très bien être tenus par les
bureaux de poste locaux. Ou bien encore par des succursales d'une banque,
propriété de la nation.
Ce serait
un dividende national. Chaque citoyen aurait 32,25 $ de plus, à son propre
crédit, dans un compte de naissance d'argent. Argent créé par un organisme
monétaire national, institution établie spécialement à cette fin par une loi du
Parlement.
Le dividende à chacun
Chaque
fois qu'il faut augmenter l'argent du pays, chaque homme, femme, enfant,
vieillard, bébé, aurait ainsi sa part de la nouvelle étape de progrès qui rend
de l'argent neuf nécessaire.
Ce n'est
pas un salaire pour du travail accompli, c'est un dividende à chacun, pour sa
part d'un capital commun. S'il y a des propriétés privées, il y a aussi des
biens communs, que tous possèdent au même titre.
Voici un
homme qui n'a rien que les guenilles dont il est couvert. Pas un repas devant
lui, pas un sou dans sa poche. Je puis lui dire:
«Mon cher,
tu crois être pauvre, mais tu es un capitaliste qui possède bien des choses au
même titre que moi et que le premier ministre. Les chutes d'eau de la province,
les forêts de la couronne, c'est à toi comme à moi, et ça peut bien te
rapporter quelque chose chaque année.
«L'organisation
sociale, qui fait qu'on produit cent fois plus et mieux que si on vivait
isolément, c'est à toi comme à moi, et ça doit te valoir quelque chose à toi
comme à moi.
«La
science qui fait se multiplier la production avec presque pas de travail, c'est
un héritage transmis et grossi avec les générations; et toi, de ma génération,
tu dois en avoir ton bénéfice au même titre que moi.
«Si tu es
pauvre et dénué, mon cher, c'est qu'on t'a volé ta part. Surtout on l'a mise
sous clé. Quand tu manques de pain, ce n'est pas du tout parce que les riches
consomment tout le blé du pays; c'est parce que ta part reste dans l'élévateur,
on te prive du moyen de l'obtenir.
«C'est le
dividende du Crédit Social qui va te rendre ta part, au moins le principal
morceau. Une administration dégagée des liens du financier, mieux capable de
mettre les exploiteurs d'hommes à la raison, te rendra le reste.
C'est cela aussi qui va reconnaître
ton titre de membre de l'espèce humaine, en vertu duquel tu as droit à une part
des biens de ce monde, au moins à la part nécessaire pour exercer ton droit de
vivre.
L’argent doit-il réclamer de l’intérêt?
 Nous
croyons qu'il n'est pas une chose au monde qui ait prêté à autant d'abus que l'argent.
Pas parce que l'argent est une chose mauvaise en soi. Bien au contraire, c'est
probablement une des plus géniales inventions de l'homme pour assouplir les
échanges, favoriser l'écoulement des biens à la demande des besoins, et
faciliter la vie en société.
Nous
croyons qu'il n'est pas une chose au monde qui ait prêté à autant d'abus que l'argent.
Pas parce que l'argent est une chose mauvaise en soi. Bien au contraire, c'est
probablement une des plus géniales inventions de l'homme pour assouplir les
échanges, favoriser l'écoulement des biens à la demande des besoins, et
faciliter la vie en société.
Mais,
mettre l'argent sur un autel, c'est de l'idolâtrie. Faire de l'argent une chose
vivante qui donne naissance à d'autre argent, c'est anti-naturel.
L'argent
ne fait pas de petits, selon l'expression du grand philosophe Aristote. Et
pourtant, qui saura compter les contrats, contrats entre individus, contrats
entre gouvernements et créanciers, aux termes desquels l'argent doit faire des
petits, sous peine de confiscation de propriété ou de liberté?
Peu à peu,
tous se sont rangés derrière la théorie, et derrière la pratique surtout, que
l'argent doit produire de l'intérêt. Et malgré tout l'enseignement chrétien
dans le sens contraire, la pratique a fait tellement de chemin que, pour ne pas
perdre dans la concurrence endiablée autour de la fécondité de l'argent, tout
le monde aujourd'hui doit se conduire comme s'il était naturel pour l'argent de
faire des petits. L'Eglise n'a pas rescindé ses vieilles lois, mais il lui est
devenu impossible d'en exiger l'application.
Les
méthodes employées pour financer la croisade actuelle (la guerre mondiale No
2), dans laquelle nous sommes les acolytes de Churchill, Roosevelt et Staline
pour défendre la chrétienté, consacrent solennellement la règle que l'argent,
même l'argent jeté à la mer ou dans les flammes d'incendies de villes, doit
porter de l'intérêt. Nous faisons ici allusion aux emprunts de la Victoire, qui
financent la destruction, ne produisent rien et doivent quand même porter
intérêt.
Intérêt et dividende
Pour que
nos lecteurs ne perdent pas connaissance en pensant à leurs économies placées
dans l'industrie ou dans des institutions de prêts, hâtons-nous de faire
quelques distinctions.
Si
l'argent ne peut pas grossir par lui-même, il y a des choses que l'argent achète
et qui produisent logiquement des développements. Ainsi, je consacre 5000 $ à
l'achat d'une ferme, ou d'animaux, ou de semence, ou d'arbres, ou de
machinerie. Avec du travail intelligent, je ferai ces choses en produire
d'autres.
Le 5000 $
a été un placement. De lui-même il n'a rien produit; mais grâce à ce 5000 $,
j'ai pu me procurer des choses qui ont produit.
Supposons
que je n'avais pas ce 5000 $. Mais mon voisin l'avait et n'en avait pas besoin
pour d'ici quelques semaines. Il me l'a prêté. Je crois qu'il sera convenable
pour moi de lui marquer ma reconnaissance en lui passant une petite partie des
produits que j'obtiens grâce au capital producteur que j'ai ainsi pu me
procurer.
C'est mon
travail qui a rendu son capital profitable, oui. Mais ce capital lui-même
représente du travail accumulé. Nous sommes donc deux, dont les activités,
passées pour lui, présentes pour moi, font surgir de la production. Le fait
pour lui d'avoir attendu à tirer sur la production du pays en récompense de son
travail, m'a permis à moi d'obtenir des moyens de production que je n'aurais
pas eus sans cela.
Nous
pouvons donc nous diviser les fruits de cette collaboration. La production due
au capital est à déterminer, par entente et par l'équité.
Ce que mon
prêteur va retirer dans ce cas est, à proprement parler, un dividende (nous
avons divisé les fruits).
Le
dividende est parfaitement justifiable, lorsqu'il y a production fructueuse.
* *
*
Ce n'est
pas tout à fait l'idée qu'on attache généralement au mot «intérêt». L'intérêt
est une réclamation faite par l'argent, en fonction du temps seulement, et
indépendamment des résultats du prêt.
Voici 1000
$. Je les place dans des obligations fédérales, provinciales ou municipales.
S'il s'agit d'obligations à 10%, je devrai toucher 100 $ d'intérêt tous les
ans, aussi vrai que la terre a fait une fois le tour du soleil pendant ce
temps-là. Même si le capital est engouffré sans aucun profit, il me faut mon
100 $. Cela, c'est l'intérêt.
Nous ne
voyons rien qui justifie cette réclamation, sauf l'habitude reçue. Elle ne
repose sur aucun principe. Donc: dividende, oui, parce que c'est subordonné à
une croissance de la production. Intérêt, en soi, non, parce que c'est dissocié
des réalités, c'est basé sur la fausse idée d'une gestation naturelle et
périodique de l'argent.
Placements indirects
Dans la
pratique, celui qui apporte son argent à la banque le place indirectement dans
l'industrie productive. Les banquiers sont des prêteurs de profession, et le
déposant leur passe son argent, parce qu'ils sont mieux que lui capables de le
faire fructifier, sans qu'il ait à s'en occuper.
Le petit
intérêt que le banquier inscrit au crédit du déposant de temps en temps, même à
taux fixe, est en réalité un dividende, une partie des revenus que le banquier,
avec le concours d'emprunteurs, a obtenus d'activités productrices.
Placements anonymes
En
passant, disons un mot de la moralité des placements. Bien des gens ne se
préoccupent aucunement de l'utilité ou de la nocivité des activités que leur
argent va financer. Dès lors que ça rapporte, disent-ils, c'est bon. Et plus ça
rapporte, meilleur est le placement. Un païen ne raisonnerait pas autrement.
Si le
propriétaire d'une maison n'a pas le droit de la louer pour un bordel, alors
que ce serait bien payant, le propriétaire d'épargnes n'a pas plus le droit de
les placer dans des entreprises qui ruinent les âmes, même si elles remplissent
des poches.
Il serait
d'ailleurs bien préférable que le bailleur de fonds et l'entrepreneur fussent
moins dissociés. L'industrie moins grosse d'autrefois était beaucoup plus
saine: le financier et l'entrepreneur étaient la même personne. Le marchand du
coin est encore dans le même cas. Pas le magasin à chaînes. La coopérative,
l'association de personnes, gardent la relation entre l'usage de l'argent et
son propriétaire, et ont l'avantage de permettre des entreprises qui dépassent
les ressources d'une seule personne.
L'accroissement de l'argent
A la
question du début: L'argent doit-il réclamer de l'intérêt? nous
sommes donc portés à répondre: L'argent peut réclamer des dividendes lorsqu'il
y a fruits. Autrement, non.
Si les
contrats sont faits autrement, si le cultivateur doit rembourser des intérêts
même quand ses récoltes sont manquées, si les fermiers de l'Ouest doivent
honorer des engagements à 7% alors que les financiers qui mènent le monde
causent la baisse des prix au tiers de ce qu'ils étaient, cela ne change rien
au principe. Cela prouve tout simplement qu'on a substitué l'artifice à la
réalité.
Mais si
l'argent a droit à des dividendes, lorsqu'il y a augmentation de la production,
encore est-il que cette augmentation de la production doit créer
automatiquement une augmentation d'argent. Sinon, le dividende, tout en étant
parfaitement dans l'ordre, devient impossible à satisfaire sans porter atteinte au public d'où on l'extrait.
Je disais
tantôt: Si, grâce aux 5000 $ qui m'ont permis d'acheter des instruments
aratoires j'ai augmenté ma production, le prêteur a droit à une partie de ces
bons résultats. Très bien, et rien de plus facile si je lui passe une partie de
ces produits accrus. Mais si c'est de l'argent qu'il faut lui passer, c'est une
autre affaire. S'il n'y a pas dans le public accroissement d'argent, ma
production accrue crée un problème: plus de biens offerts, pas plus d'argent en
face. Je puis réussir à déplacer un autre vendeur, mais lui sera la victime.
On me dira
que le 5000 $ a dû contribuer à augmenter l'argent en circulation. Oui, mais je
dois repomper le 5000 $ plus ce que j'appelle dividende, ce que d'autres
appellent intérêt.
Le
problème n'est donc point réglé. Et dans notre système économique, il ne peut
pas l'être. Pour que l'argent augmente, il faut que la banque, seule place où
se crée l'augmentation, en prête quelque part; et en le prêtant, elle en exige
un remboursement également accrû. Le problème fait boule de neige.
Le système
du Crédit Social réglerait le cas, comme bien d'autres cas d'ailleurs. Le
dividende est une chose légitime, normale, logique. Mais le système actuel ne
permet pas de le servir sans que ça fasse mal quelque part. .
Notre-Seigneur chasse les changeurs d’argent du Temple
 La seule fois dans l'Evangile où il est mentionné que
Jésus fit usage de violence, c'est justement pour condamner cet intérêt exigé
sur l'argent créé, lorsqu'il chassa les changeurs d'argent du Temple avec un
fouet, et renversa leur table (tel que rapporté dans saint Matthieu 21, 12-13,
et saint Marc 11, 15-19):
La seule fois dans l'Evangile où il est mentionné que
Jésus fit usage de violence, c'est justement pour condamner cet intérêt exigé
sur l'argent créé, lorsqu'il chassa les changeurs d'argent du Temple avec un
fouet, et renversa leur table (tel que rapporté dans saint Matthieu 21, 12-13,
et saint Marc 11, 15-19):
Il existait en ce temps-là une loi qui stipulait que la
dîme ou taxe au temple de Jérusalem devait être payée par une pièce de monnaie
spéciale, appelée «demi-shekel du sanctuaire», dont les changeurs d'argent
s'étaient justement arrangés pour obtenir le monopole. Il y avait plusieurs
sortes de pièces en ce temps-là, mais les gens devaient obtenir cette pièce
spécifique pour payer leur dîme. De plus, les colombes et les animaux que les
gens devaient acheter pour offrir en sacrifice ne pouvaient être achetés
autrement que par cette monnaie, que les changeurs d'argent échangeaient aux
pèlerins, mais moyennant de deux à trois fois sa valeur réelle en temps normal.
Jésus renversa leur table et leur dit: «Ma maison est une maison de prière, et
vous en avez fait une caverne de voleurs.»
La Bible contient plusieurs textes qui condamnent
clairement le prêt à intérêt. Par ailleurs, plus de 300 ans avant Jésus-Christ,
le grand philosophe grec Aristote condamnait lui aussi le prêt à intérêt,
faisant remarquer que l'argent, n'étant pas une chose vivante, ne pouvait
donner naissance à d'autre argent: «L'argent ne fait pas de petits», dit-il. De
plus, les Pères de l'Eglise, depuis les temps les plus anciens, ont toujours
dénoncé sans équivoque l'usure. Saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme Théologique
(2-2, question 78), résume l'enseignement de l'Eglise sur le prêt à intérêt:
 «Il est écrit
dans le livre de l'Exode (22, 24): “Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon
peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un
créancier, tu ne l'accableras pas
d'intérêts.” Recevoir un intérêt pour l'usage de l'argent prêté est de
soi injuste, car c'est faire payer ce qui n'existe pas; ce qui constitue
évidemment une inégalité contraire à la justice... c'est en quoi consiste
l'usure. Et comme l'on est tenu de restituer les biens acquis injustement, de
même l'on est tenu de restituer l'argent reçu à titre d'intérêt.»
«Il est écrit
dans le livre de l'Exode (22, 24): “Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon
peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un
créancier, tu ne l'accableras pas
d'intérêts.” Recevoir un intérêt pour l'usage de l'argent prêté est de
soi injuste, car c'est faire payer ce qui n'existe pas; ce qui constitue
évidemment une inégalité contraire à la justice... c'est en quoi consiste
l'usure. Et comme l'on est tenu de restituer les biens acquis injustement, de
même l'on est tenu de restituer l'argent reçu à titre d'intérêt.»
En réponse au texte de l'Evangile sur la parabole des
talents (Matthieu 25, 14-30 et Luc 19, 12-27), qui, à première vue, semble
justifier l'intérêt («Serviteur mauvais... tu aurais dû placer mon argent à la
banque, et à mon retour, j'aurais retiré mon argent avec les intérêts»), saint
Thomas d'Aquin écrit:
«Les intérêts dont parle l'Evangile doivent s'entendre
dans un sens métaphorique; ils désignent le surcroît de biens spirituels exigé
par Dieu, qui veut que nous fassions toujours un meilleur usage des biens qu'il
nous a confiés, mais c'est pour notre avantage et non pour le sien.»
Ce texte de l'Evangile ne peut donc pas justifier
l'intérêt puisque, dit saint Thomas, «on ne peut fonder un argument sur des
expressions métaphoriques».
Un autre texte causant difficulté est celui de
Deutéronome 23, 20-21: «Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour un
prêt d'argent, ni pour du grain, ni pour autre chose. Tu ne pourras recevoir
d'intérêt que d'un étranger». Saint Thomas explique:
«Il était interdit aux Juifs de toucher un intérêt de la
part de “leurs frères”, c'est-à-dire des autres Juifs; ce qui donne à entendre
que percevoir l'intérêt d'un prêt, de quelque homme qu'on le reçoive, est mal,
absolument parlant. Nous devons, en effet, regarder tout homme “comme notre
prochain et notre frère” surtout d'après la loi évangélique qui doit régir
l'humanité. Aussi le Psalmiste, parlant du juste, dit-il sans restriction: “Il
ne prête pas son argent à intérêt” (14, 4), et Ezéchiel (18, 17): “Il ne
pratique pas l'usure, et ne prend pas d'intérêts”.»
Si les Juifs étaient autorisés à recevoir un intérêt de
la part des étrangers, dit saint Thomas, c'était une tolérance pour éviter un
plus grand mal, de peur qu'ils ne perçussent des intérêts sur les Juifs
eux-mêmes, adorateurs du vrai Dieu. Saint Ambroise, commentant le même texte
(«tu pourras prêter à intérêt aux étrangers»), voit dans le mot «étrangers» le
sens d'«ennemis» et conclut: «A celui auquel tu désires légitimement nuire, à
celui contre lequel tu prends justement les armes, à celui-là tu peux à bon
droit prendre des intérêts.»
Saint Ambroise dit aussi: «Qu'est-ce que le prêt à
intérêt, sinon tuer un homme?»
Saint Jean Chrysostome: «Rien n'est plus honteux, ni plus
cruel que l'usure.»
Saint Léon: «C'est une avarice injuste et insolente que
celle qui se flatte de rendre service au prochain alors qu'elle le trompe...
Celui-là jouira du repos éternel qui entre autres règles d'une conduite
pieuse n'aura pas prêté son argent à usure... tandis que celui qui s'enrichit
au détriment d'autrui, mérite en retour la peine éternelle.»
En 1311, au
Concile de Vienne, le pape Clément V déclarait nulle et vaine toute la
législation civile en faveur de l'usure, et «si quelqu'un tombe dans cette
erreur d'oser audacieusement affirmer que ce n'est pas un péché que de faire
l'usure, nous décrétons qu'il sera puni comme hérétique et nous ordonnons à
tous les ordinaires et inquisiteurs de procéder vigoureusement contre tous ceux
qui seront soupçonnés de cette hérésie.»
Le 1er novembre 1745, le pape Benoît XIV publiait
l'encyclique Vix Pervenit, adressée aux évêques italiens, au sujet des
contrats, où l'usure, ou prêt à intérêt, est clairement condamnée. Le 29
juillet 1836, le pape Grégoire XVI étendait cette encyclique à l'Eglise universelle.
Il y est écrit:
«L'espèce de péché qu'on appelle usure, et qui réside
dans le contrat de prêt, consiste en ce qu'une personne, s'autorisant du prêt
même, qui par sa nature demande qu'on rende seulement autant qu'on a reçu,
exige qu'on lui rende plus qu'on a reçu et soutient conséquemment qu'il lui est
dû, en plus du capital, quelque profit, en considération du prêt même. C'est
pour cette raison que tout profit de cette sorte qui excède le capital est
illicite et usuraire.
«Et certes, pour ne pas encourir cette note infamante, il
ne servirait à rien de dire que ce profit n'est pas excessif, mais modéré;
qu'il n'est pas grand, mais petit... En effet, la loi du prêt a nécessairement
pour objet l'égalité entre ce qui a été donné et ce qui a été rendu... Par
conséquent, si une personne quelconque reçoit plus qu'elle n'a donné, elle sera
tenue à restituer pour satisfaire au devoir que lui impose la justice dite
commutative...»
En 1891, le pape Léon XIII écrivait dans son encyclique
Rerum Novarum:
«Une usure dévorante est venue ajouter encore au mal.
Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Eglise, elle n'a cessé
d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gain, et d'une
insatiable cupidité...»
L'enseignement de l'Eglise sur le sujet est donc très
clair, mais, comme le disait Louis Even précédemment, «malgré tout
l'enseignement chrétien dans le sens contraire (que l'argent doit produire de
l'intérêt), la pratique a fait tellement de chemin que, pour ne pas perdre dans
la concurrence endiablée autour de la fécondité de l'argent, tout le monde
aujourd'hui doit se conduire comme s'il était naturel pour l'argent de faire
des petits. L'Eglise n'a pas rescindé ses vieilles lois, mais il lui est devenu
impossible d'en exiger l'application.»
A ce sujet, il est intéressant de considérer l'expérience
récente des banques islamiques: le Coran — le livre saint des musulmans —
condamne l'usure, tout comme la Bible des chrétiens. Mais les musulmans ont
pris ces paroles au sérieux, et ont établi, depuis 1979, un système bancaire en
accord avec les règles du Coran: les banques prêtent sans intérêt, et au lieu
de payer des intérêts aux déposants, elles les associent aux projets dans
lesquels elles investissent: si ces projets font des profits, les banques
partagent ces profits avec leurs déposants. Ce n'est pas encore tout à fait le
Crédit Social, mais au moins, c'est une tentative plus qu'honorable de mettre
le système bancaire en accord avec les lois morales.
LEÇON 5 —
LE MANQUE CHRONIQUE DE POUVOIR D’ACHAT
— LE DIVIDENDE
Il ne suffit pas de financer la production. Il faut aussi que les
produits aillent à ceux qui en ont besoin. C'est même la seule vraie raison
d'être des produits: combler des besoins.
Il faut donc que les produits soient distribués. Comment le sont-ils
aujourd'hui, et comment le seraient-ils sous un régime de Crédit Social?
Aujourd'hui, les produits sont offerts à un certain prix. Les personnes
qui ont de l'argent achètent ces produits en y mettant le prix. Cela permet aux
personnes qui ont de l'argent de choisir les produits qui leur conviennent.
Le Crédit Social ne bouleverserait point cette méthode de distribuer les
produits. La méthode est souple et bonne — à condition, évidemment, que les
individus qui ont des besoins aient en même temps du pouvoir d'achat pour
choisir les produits qui conviennent à leurs besoins.
Du pouvoir d'achat entre les mains de ceux qui ont des besoins: c'est
justement là que le système actuel a des défauts, et que le Crédit Social
corrigerait ces défauts.
Quand la production est financée, elle fonctionne. Quand elle
fonctionne, elle distribue l'argent qui sert à la financer.
L'argent ainsi distribué, sous forme de salaires, profits, dividendes
industriels, constitue du pouvoir d'achat pour ceux qui le reçoivent. Mais:
1.
Premièrement, l'industrie
ne distribue jamais le pouvoir d'achat au même régime qu'elle bâtit ses prix.
2.
Deuxièmement,
la production ne distribue pas de pouvoir d'achat à tout le monde. Elle n'en
distribue qu'à ceux qui sont employés par elle.
Même si les banques ne chargeaient aucun intérêt sur l'argent qu'elles
prêtent, il existerait toujours un manque de pouvoir d'achat, car jamais
l'argent distribué en salaires ne peut acheter toute la production, qui
comprend d'autres éléments dans ses prix.
Les économistes prétendent que la production finance automatiquement la
consommation, que les salaires distribués suffisent pour acheter tous les biens
mis en vente, mais les faits prouvent le contraire. L'ingénieur écossais
Clifford Hugh Douglas fut le premier à démontrer ce manque chronique de pouvoir
d'achat, et à y apporter une solution scientifique, connue sous le nom de
«Crédit Social». Douglas explique ainsi ce manque de pouvoir d'achat:
A ne peut acheter A + B
Le producteur doit inclure dans ses prix tous ses coûts de production
s'il désire rester en affaires. Les salaires distribués à ses employés —
appelés «paiements A» — ne sont qu'une partie du coût
de production du produit. Le producteur a aussi d'autres coûts de production
qui ne sont pas distribués en salaires, mais qu'il doit inclure dans ses prix:
les paiements pour les matériaux, les taxes, les frais bancaires, l'entretien
et le remplacement des machines, etc. Douglas appelle ces paiements faits à
d'autres organisations les «paiements B».
Le prix de vente du produit doit inclure tous les coûts: les salaires
(A) et les autres paiements (B). Le prix de vente du produit sera donc A + B.
Alors, il est évident que les salaires (A) ne peuvent acheter la somme de tous
les coûts (A + B). Il y a donc un manque chronique de pouvoir d'achat dans le
système.
Quand le produit fini est offert au public, il est accompagné de son
prix. Mais une partie de l'argent figurant dans ce prix fut distribuée,
peut-être, il y a six mois, un an, ou plus. Une autre partie le sera seulement
après que le produit aura été vendu et que le marchand se sera servi de son profit. Une autre partie, dans dix ans
peut-être, quand la machine, dont l'usure est inscrite en frais dans les prix,
sera remplacée par une machine neuve. Etc.
Puis, il y a des personnes qui reçoivent de l'argent et ne s'en servent pas.
Cet argent est dans les prix; il n'est pas dans le pouvoir d'achat de ceux qui
ont besoin des produits.
Le remboursement des prêts bancaires à terme fixé et le système fiscal
actuel accentuent encore la discordance entre les prix et le pouvoir d'achat.
D'où l'accumulation des produits. D'où le chômage, et le reste.
Certains peuvent répliquer que les entreprises payées par les paiements
«B» (celles ayant fourni la matière première, la machinerie, etc.) paient des
salaires à leurs propres employés, et qu'une partie des paiements «B» devient
ainsi des paiements «A» (salaires). Cela ne change rien à la vérité de ce qui a
été dit précédemment: c'est tout simplement un salaire distribué à une autre
étape de la production, et ce salaire (A) ne se distribue pas sans entrer dans
un prix, qui ne peut être moindre que A + B; l'écart existe toujours.
Même si on essaie d'augmenter les salaires pour rattraper les prix, la
hausse des salaires sera incluse automatiquement dans les prix, et rien ne sera
réglé. (C'est comme un chien qui court après sa queue.) Pour pouvoir acheter
toute la production, il faut donc un revenu supplémentaire en dehors des
salaires, au moins égal à B. C'est ce que ferait le dividende du Crédit Social,
accordé à chaque mois à chaque citoyen du pays. (Ce dividende serait financé
par de l'argent nouveau créé par la nation, et non pas par les taxes des
contribuables, car ce serait alors de l'argent provenant des salaires.)
Ce qui maintient le système actuel
Sans cette autre source de revenu (le dividende), il devrait y avoir
théoriquement, dans le système actuel, une montagne de produits invendus. Si
les produits se vendent tant bien que mal malgré tout, c'est qu'on a à la place
une montagne de dettes! En effet, puisque les gens n'ont pas assez d'argent,
les marchands doivent encourager les ventes à crédit pour écouler leur
marchandise. Mais cela ne suffit pas pour combler le manque de pouvoir d'achat.
Alors on insistera sur le besoin de travaux qui distribueront des
salaires sans augmenter la quantité de biens consommables mis en vente: les
travaux publics (construction ou réparation de ponts ou de routes), la
production d'armements de guerre (sous-marins, frégates, avions, etc.). Mais
tout cela ne suffit pas non plus.
Alors chaque pays cherchera à avoir une «balance commerciale favorable»,
c'est-à-dire exporter, vendre à l'étranger plus de produits
qu'on en reçoit, pour obtenir ainsi de l'étranger de l'argent qui servira à
combler notre pouvoir d'achat déficient et acheter nos propres produits. Or il
est impossible pour tous les pays d'avoir une «balance commerciale favorable»:
si certains pays réussissent à exporter plus de produits qu'ils en importent,
ça prend nécessairement aussi, en contrepartie, des pays qui reçoivent plus de
produits qu'ils en envoient. Mais comme tous les pays veulent vendre à
l'étranger plus de produits qu'ils en reçoivent, cela
cause entre ces pays des conflits commerciaux, qui peuvent même dégénérer en
conflits armés.
Alors, comme dernière trouvaille, les économistes ont découvert un
endroit où envoyer nos produits sans rien risquer de recevoir en retour, un
endroit où il n'y a aucun habitant: la lune, l'espace. En effet, on dépensera
des milliards pour construire des fusées pour aller sur la lune ou d'autres
planètes; tout cet énorme gaspillage de ressources simplement dans le but de
générer des salaires qui serviront à acheter la production qui reste invendue
dans notre pays. C'est le cas de le dire, les économistes sont vraiment dans la
lune!
Le progrès remplace le besoin de labeur humain
Le deuxième défaut du système actuel est que la production ne distribue
pas de pouvoir d'achat à tout le monde. Elle n'en distribue qu'à ceux qui sont
employés par elle. Et plus la production provient des machines, moins elle
provient du travail humain. Elle augmente alors même que l'emploi nécessaire
diminue. Il y a donc conflit entre le progrès qui supprime le besoin de labeur,
et le règlement qui ne distribue de pouvoir d'achat qu'à l'emploi.
Pourtant, tout le monde a le droit de vivre. Et tout le monde a droit
aux nécessités de la vie. Les biens de la terre ont été créés pour tous les
hommes, pas seulement pour les employables.
C'est pourquoi le Crédit Social ferait ce que le système actuel ne fait
pas. Sans supprimer la récompense au travail, il distribuerait à tous un revenu périodique, appelé dividende social — revenu
lié à la personne et non pas à l'emploi.
Les biens de la terre créés pour tous
 C'est le
moyen le plus direct, le plus concret pour garantir à tout être humain
l'exercice de son droit fondamental à une part des biens de la terre. Toute personne possède ce droit — non pas à titre d'embauché dans la production, mais à seul titre d'être
humain.
C'est le
moyen le plus direct, le plus concret pour garantir à tout être humain
l'exercice de son droit fondamental à une part des biens de la terre. Toute personne possède ce droit — non pas à titre d'embauché dans la production, mais à seul titre d'être
humain.
Le Pape Pie XII déclarait dans son radio-message du 1er juin 1941:
«Les biens créés par Dieu l'ont été pour tous les hommes et doivent
être à la disposition de tous, selon les principes de la justice et de la
charité.
«Tout homme, en tant qu'être doué de raison, tient en fait de la nature
le droit fondamental d'user des biens matériels de la terre, quoiqu'il soit
laissé à la volonté humaine et aux formes juridiques des peuples de régler plus
en détail la réalisation pratique de ce droit.
«Un tel droit individuel ne saurait en aucune manière être supprimé, pas
même par l'exercice d'autres droits certains et reconnus sur des biens
matériels.
«La richesse économique d'un peuple ne consiste pas proprement dans
l'abondance des biens, mesurée selon un calcul matériel pur et simple de leur
valeur, mais bien dans ce qu'une telle abondance représente et fournit
réellement et efficacement comme base matérielle suffisante pour le
développement personnel convenable de ses membres.
«Si une telle juste distribution des biens
n'était pas réalisée ou n'était qu'imparfaitement assurée, le vrai but de
l'économie nationale ne serait pas atteint étant donné que, quelle que fût
l'opulente abondance des biens disponibles, le peuple, n'étant pas appelé à y
participer, ne serait pas riche, mais pauvre.
«Faites, au contraire, que cette juste distribution soit efficacement
réalisée et de manière durable, et vous verrez un peuple, bien que disposant de
biens moins considérables, devenir et être économiquement sain.»
Le Pape dit qu'il appartient aux peuples eux-mêmes, par leurs lois et
leurs règlements, de choisir les méthodes capables de permettre à chaque homme
d'exercer son droit à une part des biens terrestres. Le dividende à tous le
ferait. Aucune autre formule proposée n'a été, de loin, aussi effective, pas
même nos actuelles lois de sécurité sociale.
Pourquoi un dividende à tous?
— Un dividende social à tous?
Mais un dividende suppose un capital placé et productif!
Justement. C'est parce que tous les membres de la société sont
co-capitalistes — d'un capital réel et immensément productif. Nous avons dit
plus haut, et nous ne saurions trop le répéter, que le crédit financier est, à
sa naissance, propriété de toute la société. Il l'est, parce qu'il est basé sur
le crédit réel, sur la capacité de production du pays. Cette capacité de
production est faite, certes, en partie, du travail, de la compétence de ceux
qui participent à la production. Mais elle est faite surtout, et de plus en
plus, d'autres éléments qui sont propriété de tous.
Il y a d'abord les richesses naturelles, qui ne sont la production
d'aucun homme; elles sont un don de Dieu, une gratuité qui doit être au service
de tous. Il y a aussi toutes les inventions faites, développées et transmises
d'une génération à l'autre. C'est le plus gros facteur de production
aujourd'hui. Et nul homme ne peut prétendre, plus qu'un autre, à la propriété
de ce progrès, qui est fruit de générations.
Sans doute il faut des hommes actuels pour le mettre à contribution — et
ceux-là ont droit à une récompense: ils la reçoivent en rémunérations:
salaires, traitements, etc. Mais un capitaliste qui ne participe pas
personnellement à l'industrie où il a glacé son capital a droit quand même à
une part du résultat, à cause de son capital.
Eh bien! le plus gros capital réel de la production moderne, c'est bien
la somme des découvertes, des inventions progressives, qui font qu'aujourd'hui,
on obtient plus de produits avec moins de travail. Et puisque tous les vivants
sont, à titre égal, cohéritiers de cet immense capital qui s'accroît toujours,
tous ont droit à une part des fruits de la production.
L'employé a droit à ce dividende et à son salaire. Le non-employé n'a
pas de salaire, mais a droit à ce dividende, que nous appelons social, parce
qu'il est le revenu d'un capital social.
Le dividende du Crédit Social est basé sur deux choses: l'héritage des
richesses naturelles et des inventions des générations précédentes:
Nous venons tout juste de démontrer que le dividende du Crédit Social
est basé sur deux choses : l’héritage des ressources naturelles, et les
inventions des générations passées. C’est exactement ce que le Pape Jean-Paul
II écrivait en 1981 dans son Encyclique Laborem exercens, sur le travail
humain (n. 13) :
«L'homme, par son travail, hérite d'un double
patrimoine: il hérite d'une part de ce qui est donné à tous les hommes, sous
forme de ressources naturelles et, d'autre part, de ce que tous les autres ont
déjà élaboré à partir de ces ressources, en réalisant un ensemble d'instruments
de travail toujours plus parfaits. Tout en travaillant, l'homme hérite du
travail d'autrui.»
La folie du plein-emploi
Parler d'embauchage intégral, de plein emploi, est en contradiction avec
la poursuite du progrès dans les techniques et procédés de production. On
n'introduit pas une machine perfectionnée, on n'exploite pas une nouvelle
source d'énergie pour atteler l'homme à la production, mais bien plutôt pour le
libérer.
Mais on a perdu le sens des fins et des moyens. On prend des moyens pour
des fins. C'est une perversion qui contamine toute la vie économique et empêche
l'homme de bénéficier des fruits logiques du progrès.
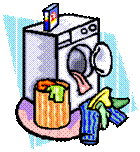 L'industrie
n'existe pas pour donner de l'emploi, mais pour fournir des produits. Si elle
fournit les produits, elle accomplit son rôle. Et plus elle accomplit son rôle
en requérant moins de temps, moins de bras moins de labeur, plus elle est
parfaite.
L'industrie
n'existe pas pour donner de l'emploi, mais pour fournir des produits. Si elle
fournit les produits, elle accomplit son rôle. Et plus elle accomplit son rôle
en requérant moins de temps, moins de bras moins de labeur, plus elle est
parfaite.
M. Laflamme procure à sa femme une machine à laver automatique. Le
lavage hebdomadaire ne prend plus qu'un quart de journée au lieu d'une journée
entière. Et quand madame a placé le linge dans le moulin, le savon dans le
compartiment à cette fin, et qu'elle a ouvert les deux robinets, l'amenée d'eau
chaude et celle d'eau froide, elle n'a plus qu'à laisser faire: la machine
passera d'elle-même du trempage au lavage, du lavage au rinçage, du rinçage à
l'essorage, pour s'arrêter automatiquement lorsque le ligne sera prêt à retirer
du baquet.
Est-ce que madame va se désoler parce qu'elle a du temps à elle pour en
disposer à son gré? Ou bien, son mari va-t-il lui chercher d'autre ouvrage pour
remplacer celui dont elle est libérée? Non, n'est-ce pas? Ni l'un ni l'autre ne
peut être sot à ce point.
Si la sottise règne dans l'organisme social et économique jusqu'à faire
le progrès punir l'homme qu'il devrait soulager, c'est parce que l'on s'obstine
à lier le pouvoir d'achat, la distribution d'argent, uniquement à l'emploi dans
la production. On ne veut voir dans l'argent que la récompense à l'effort.
C'est encore là une perversion du rôle de l'argent. L'argent n'est qu'un
«ticket» à présenter pour obtenir des produits ou des services. C'est un bon
polyvalent, permettant au consommateur de choisir ce qui lui convient dans les
biens que lui offre la capacité de production du pays.
Si l'on veut que l'économie atteigne sa fin, qui est de satisfaire les
besoins humains dans l'ordre de leur importance, il faut que les individus
aient assez de ces bons pour leur permettre d'obtenir assez de produits, tant
que la capacité de production peut y répondre. Le volume de l'argent pour
acheter doit être réglé par la somme de biens offerts, et non pas par la somme
de travail nécessaire pour les produire.
Il est vrai que la production distribue de l'argent à ceux qu'elle
emploie. Mais c'est pour elle un moyen, non pas une fin. Son but n'est pas du
tout de distribuer de l'argent, mais de fournir des produits. Et si elle
remplace vingt salariés par une machine, tout en fournissant la même quantité
de produits, elle ne dévie pas du tout de sa fonction. Si elle pouvait fournir
tous les produits nécessaires pour répondre aux besoins humains sans être
obligée de distribuer un seul sou, elle aurait encore atteint sa fin propre:
fournir des biens.
En libérant des hommes, l'industrie devrait recevoir les mêmes
remerciements que M. Laflamme a certainement reçus de sa femme, lorsqu'il l'a
libérée de plusieurs heures d'ouvrage par l'introduction d'une machine à laver
perfectionnée.
Quand le pouvoir d’achat disparaît
Mais comment dire merci quand, mis au repos par la machine, on n'a plus
d'argent pour acheter les produits de la machine! Voilà où le système
économique pêche, par manque d'adaptation de sa partie financière à sa partie
productrice.
Dans la mesure où la production peut se passer d'emploi humain, le
pouvoir d'achat exprimé par l'argent doit atteindre les consommateurs par un
autre canal que la récompense à l'emploi. Autrement dit, le système financier
doit être accordé au système producteur, non seulement en volume, mais aussi en
comportement. A production abondante, pouvoir d'achat abondant. A production se
dispensant d'embauchage, pouvoir d'achat dissocié de l'emploi.
L'argent est partie intégrante du système
financier, non pas du système producteur proprement dit. Quand le système
producteur parvient à entretenir le flot de produits par d'autres moyens que
l'emploi de salariés, le système financier doit parvenir à distribuer du
pouvoir d'achat par une autre voie que celle des salaires.
S'il n'en est pas ainsi, c'est parce que, à la différence du système
producteur, le système financier n'est pas adapté au progrès. Et c'est
uniquement cette inadaptation qui crée des problèmes alors que le progrès
devrait les faire disparaître.
Le
remplacement de l'homme par la machine dans la production devrait être un
enrichissement, délivrant l'homme de soucis purement matériels et lui
permettant de se livrer à d'autres fonctions humaines que la seule fonction
économique. Si c'est au contraire une cause de soucis et de privations, c'est simplement
parce qu'on refuse d'adapter le système financier à ce progrès.
La technologie devrait servir tout homme
La technologie est-elle un mal? Doit-on se révolter et détruire toutes
les machines parce qu’elles nous enlèvent nos emplois? Non, si le travail peut
être accompli par la machine, tant mieux : cela permettra à l’homme de
consacrer ses temps libres à d’autres activités, à des activités libres, des
activités de son choix. Mais cela, à condition qu’il reçoive un revenu pour
remplacer le salaire qu’il a perdu avec l’introduction de la machine, du robot;
autrement, la machine, qui devrait être l’allié de l’homme, devient son ennemi,
car elle le prive de revenu, et l’empêche de vivre :
«La technologie a tant contribué au bien-être de l'humanité; elle a tant
fait pour améliorer la condition humaine, servir l'humanité et faciliter son
labeur. Pourtant, à certains moments, la technologie ne sait plus vraiment où
se situe son allégeance: elle est pour l'humanité ou contre elle... Pour cette
raison, mon appel s'adresse à tous les intéressés... à quiconque peut apporter
une contribution pour que la technologie qui a tant fait pour édifier Toronto
et tout le Canada serve véritablement tout homme, toute femme et tout enfant de
ce pays.» (Jean-Paul II, Toronto, Canada, 17 septembre 1984.)
En 1850, alors que les manufactures venaient à peine d'apparaître, au
tout début de la Révolution industrielle, l'homme faisait 20% du travail,
l'animal 50%, et la machine 30%. En 1900, l'homme accomplissait seulement 15%
du travail, l'animal 30%, et la machine 55%. En 1950, l'homme ne faisait que 6%
du travail, et les machines accomplissaient le reste — 94%. (Les animaux ont
été libérés!)
Et nous n'avons encore rien vu, puisque nous entrons maintenant dans
l'ère de l'ordinateur. Une «troisième révolution industrielle» a commencé avec
l'apparition des transistors et de la puce de silicone, ou microprocesseur (qui
peut effectuer jusqu'à un million d'opérations à la seconde). «Cette puce peut
être programmée de manière à retenir de nouvelles informations et s'ajuster, et
ainsi remplacer les travailleurs sur les lignes d'assemblage... De telles
usines entièrement automatisées existent déjà, comme l'usine de moteurs de la
compagnie Fiat en Italie, qui est contrôlée par une vingtaine de robots, et
l'usine d'automobiles de la compagnie Nissan à Zama, au Japon, qui produit
1,300 automobiles par jour avec l'aide de seulement 67 personnes — ce qui
représente plus de 13 autos par jour par travailleur.
En 1964, était présenté au Président des Etats-Unis, un rapport intitulé
«Le chaos social dans l’automation», signé par 32 sommités, dont M. Gunnar
Myrdal, économiste né en Suède, et le Dr. Linus Pauling, détenteur d’un Prix
Nobel. Ce rapport disait en résumé que «les Etats-Unis, et éventuellement le
reste du monde, seraient bientôt impliqués dans une “révolution” qui promet une
production illimitée… par des systèmes de machines qui nécessiteront peu de
coopération des êtres humains. Par conséquent, on doit agir pour garantir un
revenu à tous les hommes, qu’ils soient ou non engagés dans ce qui est
communément appelé travail.»
Dans son livre intitulé «La fin du travail» et publié en 1995, l’auteur
américain Jeremy Rifkin cite une étude suisse selon laquelle «d'ici 30 ans,
moins de 2% de la main-d'oeuvre suffira à produire la totalité des biens dont
le monde a besoin.» Rifkin affirme que trois travailleurs sur quatre — des
commis jusqu'aux chirurgiens — seront éventuellement replacés par des machines
guidées par ordinateurs.
Si le règlement qui limite la distribution d'un revenu à ceux qui sont
employés n'est pas changé, la société se dirige tout droit vers le chaos. Il
serait tout simplement absurde et ridicule de taxer 2% des travailleurs pour
faire vivre 98% de chômeurs! Il faut absolument une source de revenu non liée à
l'emploi. Il n'y a pas à sortir de là, il faut un dividende, ou revenu annuel
garanti.
Le plein emploi est du matérialisme
Si on veut persister à tenir tout le monde, hommes et femmes, employés
dans la production, même si la production pour satisfaire les besoins de base
est déjà toute faite, et cela, avec de moins en moins de labeur humain, alors
il faut créer de nouveaux emplois complètement inutiles, et dans le but de
justifier ces emplois, créer de nouveaux besoins artificiels, par une avalanche
de publicité, pour que les gens achètent des produits dont ils n'ont pas
réellement besoin. C'est ce qu'on appelle «la société de consommation».
De même, on fabriquera des produits dans le but qu'ils durent le moins
longtemps possible, dans le but d'en vendre plus, et faire plus d'argent, ce
qui entraîne un gaspillage non nécessaire des ressources naturelles, et la
destruction de l'environnement. Aussi, on persistera à maintenir des travaux
qui ne nécessitent aucun effort de créativité, qui ne demandent que des efforts
mécaniques, qui pourrait facilement être faits uniquement par des machines, des
travaux où l'employé n'a aucune chance de développer sa personnalité. Mais pour
cet employé, ce travail, si déshumanisant soit-il, est la condition d'obtenir
l'argent, le permis de vivre.
Ainsi, pour lui et pour une multitude de salariés, la signification de
leur emploi se résume à ceci: aller travailler pour obtenir l'argent qui
servira à acheter le pain, qui leur donnera la force d'aller travailler pour
gagner l'argent... et ainsi de suite, jusqu'à l'âge de la retraite, s'ils ne
meurent pas avant. Voilà une vie vide de sens, où rien ne différencie l'homme
de l'animal.
Activités libres
Justement, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'homme n'a
pas seulement que des besoins matériels, il a aussi des besoins culturels,
spirituels. Comme dit Jésus dans l'Evangile: «L'homme ne vit pas seulement que
de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu.» (Matthieu 4,4.)
Vouloir occuper tout le temps de l'homme à l'entretien de sa vie matérielle,
c'est du matérialisme, car c'est nier que l'homme a
aussi une dimension et des besoins spirituels.
Mais alors, si l'homme n'est pas employé dans un travail salarié, que
va-t-il faire de ses temps libres? Il l'occupera à faire des activités libres,
des activités de son choix. C'est justement dans ses temps libres que l'homme
peut vraiment développer sa personnalité, développer les talents que Dieu lui a
donnés et les utiliser à bon escient.
De plus, c'est durant leurs temps libres que l'homme et la femme peuvent
s'occuper de leurs devoirs familiaux, religieux et sociaux: élever leur
famille, pratiquer leur religion (connaître, aimer et servir Dieu), venir en
aide à leur prochain. Elever des enfants est le travail le plus important au
monde, mais parce que la femme qui reste au foyer pour élever ses enfants ne
reçoit pas de salaire, on considère qu'elle ne fait rien, qu'elle ne travaille
pas!
Etre libéré de la nécessité de travailler pour produire les biens
essentiels à la vie ne signifie aucunement paresse. Cela signifie tout
simplement que l'individu est alors en position de choisir l'activité qui
l'intéresse. Sous un système de Crédit Social, il y aura une floraison
d'activités créatrices. Par exemple, les grandes inventions, les plus grands
chefs-d'oeuvre de l'art, ont été accompli dans des temps libres. Comme le
disait C. H. Douglas:
«La majorité des gens préfèrent être employés —
mais dans des choses qu'ils aiment plutôt que dans des choses qu'ils n'aiment
pas. Les propositions du Crédit Social ne visent
aucunement à produire une nation de paresseux... Le Crédit Social permettrait
aux gens de s'adonner aux travaux pour lesquels ils sont qualifiés. Un travail
que vous faites bien est un travail que vous aimez, et un travail que vous
aimez est un travail que vous faites bien.»
Le plein emploi est dépassé et inutile
C’est exactement ce que le Pape Jean-Paul II déclarait le 18 novembre
1983, alors qu’il recevait en audience les participants à la Conférence
épiscopale italienne sur les problèmes du travail. Voici des extraits de son
discours :
«Le premier fondement du travail, c’est l’homme lui-même… le travail est
pour l’homme, et non l’homme pour le travail… Nous ne saurions, en outre, ne
pas nous préoccuper des opinions de ceux qui, à notre époque, considèrent comme
désormais dépassé et inutile le discours sur une plus intense participation et
demandent, à ce qu’on appelle le “temps libre”, la réalisation de la
subjectivité humaine. Il ne semble pas juste, en effet, d’opposer le temps
consacré au travail au temps libre de travail, du fait qu’il faut considérer
tout le temps de l’homme comme un merveilleux don de Dieu en vue de sa globale
et intégrale humanisation. Je suis tout de fois convaincu que le temps libre
mérite une particulière attention parce qu’il est le temps durant lequel les
personnes peuvent et doivent s’occuper de leurs devoirs familiaux, religieux,
sociaux. Mieux, pour être vraiment un moment de liberté et être socialement
utile, ce temps libre doit être vécu avec mûre conscience éthique dans une
perspective de solidarité qui s’exprime également sous des formes adéquates de
généreux volontariat.»
LEÇON 6 — L’ARGENT ET LES
PRIX —
L’ESCOMPTE COMPENSÉ
La
distribution d'argent nouveau par le dividende national est donc un moyen
d'augmenter le niveau de l'argent du pays, quand c'est nécessaire, et de placer
directement cet argent entre les mains des consommateurs.
Mais, pour être bienfaisante
au consommateur, cette distribution d'argent doit constituer pour le
consommateur une véritable augmentation de son pouvoir d'achat.
Or, le pouvoir d'achat dépend de deux facteurs:
la quantité d'argent entre les mains de l'acheteur et le prix du produit à
vendre.
Si le prix
d'un produit diminue, le pouvoir d'achat du consommateur augmente, même sans
augmentation d'argent. Ainsi, j'ai 10,00 $ que je veux affecter à l'achat de
beurre; si le prix du beurre est de 2,50 $ la livre, j'ai en main un pouvoir
d'acheter 4 livres de beurre; si le prix du beurre est abaissé à 2,00 $ la
livre, mon pouvoir d'achat monte et équivaut à 5 livres de beurre.
D'autre
part, si le prix monte, cela affecte désavantageusement le pouvoir d'achat du
consommateur; et dans ce cas-là, même une augmentation d'argent peut perdre son
effet. Ainsi, l'ouvrier qui gagnait 200 $ en 1967 et qui en gagnerait 400 en
1987 serait le perdant, parce que le coût de la vie a plus que doublé en ces
vingt années. Il faut au moins 772 $ en 1987 pour se procurer ce qu'on achetait
avec 200 $ en 1967.
C'est pourquoi les augmentations de salaires,
tant réclamées par les ouvriers, ne réussissent pas à produire d'amélioration durable,
parce que les prix des produite sont augmentés en conséquence. Les employeurs
ne fabriquent pas d'argent; et s'ils doivent dépenser davantage pour payer
leurs ouvriers, ils sont obligés de vendre leurs produits plus cher pour ne pas
tomber en faillite.
Le
dividende national, lui, n'entre pas dans les prix, lorsqu'il est fait d'argent
nouveau, distribué par le gouvernement indépendamment du travail.
Cependant,
en face de plus d'argent dans le public, il pourrait y avoir tendance chez les
marchands à augmenter les prix des produits, même si ces produits ne leur ont
pas coûté plus cher.
Aussi, une réforme monétaire qui ne voit pas en
même temps à freiner les hausses injustifiables de prix, serait une réforme
incomplète. Elle pourrait devenir une catastrophe en laissant libre cours à
l'inflation.
La
fixation arbitraire des prix, un plafonnement général, peut aussi obtenir un
effet préjudiciable en décourageant la production. Or la diminution de la
production est le moyen le plus sûr de pousser les prix à monter. Le
législateur obtient alors le contraire de ce qu'il cherchait: il provoque
l'inflation en la combattant maladroitement; pour échapper aux sanctions,
l'inflation se produit par l'entremise du marché noir.
Le Crédit Social propose une technique pour
combattre automatiquement l'inflation: c'est la technique dite du «Prix
ajusté», ou de l'escompte compensé, qui ferait partie du mode d'émission
d'argent pour établir le pouvoir d'achat global au niveau de la production
globale offerte.
Le juste prix
Puisque
les produits sont faits pour le consommateur, il est clair que, pour atteindre
leur fin, les produits doivent être offerts au consommateur à un prix qui
permette au consommateur de les acquérir.
Autrement dit, en tout temps, il doit y avoir
équilibre entre les prix, dans leur ensemble, et le pouvoir d'achat des
consommateurs, dans son ensemble.
Pour
compter le prix de vente, les producteurs, ou les marchands, calculent ce que
la fabrication du produit a coûté, et ajoutent les frais de manipulation, de
transport, d'emmagasinage, de vente et les profits nécessaires aux différents
intermédiaires. Mais rien n'assure que ce prix marqué correspond avec le
pouvoir d'achat du consommateur.
Le prix
marqué doit être exigé par le marchand pour ne mettre personne en faillite
entre le producteur et le marchand détaillant; mais d'autre part le prix à
payer par l'acheteur doit être tel qu'il corresponde au pouvoir d'achat entre
les mains des consommateurs. Sinon, les produits restent invendus en face de
besoins réels.
D'où un
ajustement nécessaire des prix.
La
technique monétaire du Crédit Social y pourvoit.
Dans le
vocabulaire créditiste, on appelle juste prix le prix qui correspond exactement
à la consommation. On le comprendra mieux tout à l'heure.
Lorsqu'on
dit «juste prix», on ne veut donc pas du tout dire «prix honnête, prix
équitable». Le prix marqué par le marchand peut être tout à fait honnête, tout
à fait équitable, et cependant n'être pas du tout le prix exact.
Ainsi,
pendant la crise, les prix marqués pouvaient être honnêtes, équitables, mais
ils n'étaient pas exacts, ils ne correspondaient pas à la consommation. Quand
la production totale de choses demandées dépasse la consommation totale, ces
prix ne sont certainement pas exacts, puisque la consommation sur une période
quelconque marque, en définitive, les véritables dépenses faites pour la
production pendant cette même période.
Le prix
honnête est une question de morale; le prix exact est une question de
mathématiques.
Le prix
exact, le «juste prix», du système créditiste est obtenu par une règle
d'arithmétique. Il n'est donc question ni de fixation arbitraire des prix, ni
de plafonnements, ni de restrictions, ni de récompenses, ni de châtiments —
mais simplement d'arithmétique.
La technique créditiste prend deux nombres qui
sont faits par les gens du pays eux-mêmes, et non pas arbitrairement fixés par
des hommes qui ont la manie d'imposer leur volonté aux autres. Deux nombres: 1°
le nombre exprimant la somme des prix (c'est le fait des producteurs eux-mêmes);
2° le nombre exprimant le pouvoir d'achat des consommateurs (c'est le fait de
la volonté des consommateurs jointe à l'argent dont ils disposent). Puis, pour
pouvoir mettre le signe égal (=) entre ces deux nombres, le crédit social
abaisse le premier au niveau du second.
Expliquons,
en présentant d'abord quelques notions peu familières et pourtant de grande
portée.
Le véritable prix de la
production
Le prix
exact d'une chose est la somme des dépenses encourues pour la production de
cette chose. Et cela est vrai, que l'on compte en piastres, en ergs, en
heures-hommes, ou en ce qu'on voudra.
Tel
ouvrage réclame quatre heures de temps, dix onces de sueurs, un repas de
travailleur, une usure d'outil. Si l'énumération est complète, le prix exact de
cet ouvrage, c'est quatre heures de temps, dix onces de sueurs, un repas de
travailleur et une usure d'outil. Ni plus ni moins.
Comme on a
coutume d'évaluer le prix en dollars, au Canada, et comme on a aussi coutume
d'évaluer en dollars le travail, l'usure et tous les autres éléments qui
forment les dépenses, il est possible d'établir une relation entre les deux, en
termes de dollars.
Si, en
tout et partout, les dépenses de matériel, de travail, d'énergie, d'usure, se
chiffrent à 100 $, le prix exact du produit est de cent dollars.
Mais il y
a le prix comptable. Au cours de la production d'un article dans une usine,
compte est tenu de la matière première achetée, des frais de transformation,
des salaires, des frais de capital, etc., etc. Tout cela constitue le coût financier
de production de l'article.
Ce prix
comptable et le prix exact sont-ils les mêmes? S'ils le sont accidentellement
dans certains cas, il est facile de constater que, dans l'ensemble, ils ne le
sont certainement pas.
Prenez un
petit pays qui fournit, en une année, tant en biens de capital qu'en biens de
consommation, une production totale évaluée à 100 millions de dollars. Si, dans
le même temps, les dépenses totales des habitants du pays sont évaluées à 80
millions, il faudra bien admettre que la production du pays cette année-là a
coûté exactement 80 millions, puisqu'il a été consommé en tout 80 millions par
la population auteur de la production. La production a été évaluée, par la
comptabilité des prix de revient, à 100 millions, mais elle n'a coûté que 80
millions de dépenses réelles. C'est un fait inéluctable: les deux totaux sont
là.
Donc, le
prix exact de la production des 100 millions, ç'a été 80 millions.
Autrement dit, dans le même temps où la
richesse produite a été de 100 millions, la richesse consommée a été de 80
millions. La consommation de 80 millions est le véritable prix de la production
de 100 millions.
Le
véritable prix de la production, c'est la consommation.
Par
ailleurs, comme on l'a dit plus haut, si la production existe pour la consommation,
il faut que la consommation puisse payer la production.
Dans
l'exemple précédent, le pays mérite sa production. Si, en dépensant 80
millions, il produit 100 millions, il devrait pouvoir obtenir ces 100 millions,
en dépensant les 80 millions. Autrement dit, en payant 80 millions, les
consommateurs devraient obtenir les 100 millions. Sinon, il restera 20 millions
pour la contemplation, en attendant que ce soit pour le sacrifice, pour la
destruction devant un peuple privé et exaspéré.
Augmentation et diminution de
richesse
Un pays
s'enrichit de biens lorsqu'il développe ses moyens de production: ses machines,
ses usines, ses voies de transport, etc. Ce qu'on appelle biens de capital.
Un pays
s'enrichit de biens, aussi, lorsqu'il produit des choses pour la consommation:
blé, viande, meubles, habits, etc. Ce qu'on appelle biens de consommation.
Un pays
s'enrichit de biens encore, lorsqu'il reçoit de la richesse de l'extérieur.
Ainsi, le Canada s'enrichit de fruits lorsqu'il reçoit des bananes, des oranges,
des ananas. Ce qu'on appelle importations.
D'autre
part, les biens d'un pays diminuent lorsqu'il y a destruction ou usure de
moyens de production: usines brûlées, machines usées, etc. C'est ce qu'on
appelle dépréciation.
Les biens
d'un pays diminuent aussi, lorsqu'ils sont consommés. Les aliments mangés, les
habits usés, etc., ne sont plus disponibles. C'est la destruction par
consommation.
Les biens
d'un pays diminuent encore, lorsqu'ils sortent de ce pays: les pommes, le
beurre, le bacon, envoyés en Angleterre, ne sont plus au Canada. C'est ce qu'on
appelle exportations.
Calcul du juste
prix
Supposons maintenant que les relevés d'une année donnent:
Production de biens de capital..............3 000 millions
Production de biens consommables.....7 000 millions
Importations............................. ........….2 000 millions
_____
Acquisitions
totales........................…..12 000 millions (actif)
D'autre part:
Dépréciation de biens de capital...........1 800 millions
Consommation..….................................5 200
millions
Exportations.........…..............................2 000 millions
_____
Diminution
totale.....…...........................9 000 millions (passif)
On va conclure:
Pendant
que le pays s'enrichissait de 12 000 millions, il usait, ou consommait, ou
devait céder 9 000 millions.
Le coût
réel de la production des 12 000 millions, c'est 9 000 millions. S'il en a
réellement coûté au pays 9 000 millions pour produire 12 000 millions, le pays
doit pouvoir jouir de ses 12 000 millions tout en ne dépensant que 9 000
millions.
Avec 9 000 millions, il faut pouvoir en payer
12 000. Payer 12 avec 9. Cela demande un ajustement du prix: abaisser le prix
comptable 12 au niveau du prix réel 9. Et le faire sans violenter personne,
sans nuire à personne.
En face de
ce relevé, la conclusion suivante est logique, dans une économie où la production
existe pour la consommation:
Puisque la
consommation de 9 milliards, usure des machines y comprise, a permis la
production de 12 milliards, améliorations y comprises, 9 milliards est le vrai
prix de la production. Pour que le pays puisse utiliser cette production, en
autant qu'elle est désirée, il doit pouvoir l'obtenir à son véritable prix, 9
milliards; ce qui n'empêche pas les marchands d'être obligés d'en exiger 12
milliards.
D'un côté,
les consommateurs du pays doivent pouvoir acheter 12 avec 9. Ils doivent
pouvoir tirer sur la production de leur pays en la payant aux
9/12 du prix marqué.
D'autre
part, le marchand doit retirer le plein montant: 12; sinon, il ne peut
rencontrer ses charges et le profit qui est le salaire de ses services.
Escompte compensé ou boni
d'achat
L'acheteur
ne paiera que 9/12 du prix marqué, si on lui accorde un escompte de 3 sur 12,
ou de 25 pour cent.
Une table
coûte 120 $; elle sera laissée à l'acheteur pour 90 $. Une paire de bas coûte
4,00 $; elle sera laissée à l'acheteur pour 3,00 $.
De même
pour tous les articles du pays, parce que ce sera un escompte national décrété
par l'Office National, pour atteindre le but pour lequel l'Office National a
été institué.
Si tous
les articles de production du pays sont payés ainsi aux 75 pour cent de leur
prix marqué, les consommateurs du pays pourront obtenir toute leur production
de 12 milliards avec les 9 milliards qu'ils dépensent pour leur consommation.
Si les
produits ne leur conviennent pas, ils ne les achèteront pas, et les producteurs
cesseront simplement d'en faire parce que ce n'est pas une richesse réelle, ces
produits ne répondant pas à des besoins des consommateurs.
Les
marchands ne reçoivent ainsi des acheteurs que les 75 pour cent de leurs prix.
Ils ne pourront tenir, à moins de recevoir d'une autre source les 25 pour cent
que l'acheteur ne paie pas.
Cette
autre source ne peut être que l'Office de Crédit National, qui est chargé de
mettre l'argent en rapport avec les faits. Sur présentation de papiers
appropriés, attestant la vente et l'escompte national accordé, le marchand
recevra de l'Office National le crédit-argent représentant les 25 pour cent qui
manquent.
Le but
sera atteint. L'ensemble des consommateurs du pays aura pu obtenir le total de
la production du pays répondant à des besoins. Les marchands, et par eux les
producteurs, auront reçu le montant qui couvre les frais de la production et de
la distribution.
Il n'y
aura pas d'inflation, puisqu'il n'y a pas absence de produits en face de la demande.
Cet argent nouveau, en effet, n'est créé que moyennant la présence d'un produit
désiré et acheté.
Cette
émission n'entre d'ailleurs pas dans la facture du prix, puisqu'elle n'est ni
un salaire, ni un placement; elle vient après que le produit est fabriqué, coté
et vendu.
Une
manière d'arriver au même résultat serait de faire payer à l'acheteur le plein
prix. Le marchand livrerait à l'acheteur un récépissé attestant le montant de
l'achat. Sur présentation de ce récépissé à la succursale de l'Office National
du Crédit, l'acheteur recevrait un crédit-argent égal aux 25 pour cent du
montant de l'achat.
La
première méthode est un escompte compensé. Escompte accordé par le marchand et
compensé au marchand par l'Office National du Crédit.
La
deuxième méthode est un boni d'achat, ou ristourne faite à l'acheteur. Le
résultat est exactement le même.
Dans tous
les cas, le prix payé par le consommateur doit être la fraction du prix marqué
exprimée par le rapport de la consommation totale à la production totale. Autrement,
la production n'est que partiellement accessible aux consommateurs pour
lesquels elle est pourtant faite.
Juste prix = Prix marqué X consommation
Production
En résumé, pour que les chiffres-prix sur les produits et les
chiffres-argent dans les mains des consommateurs se correspondent, il y a deux
manières : abaisser les prix ou grossir les porte-monnaie. Le Crédit
Social ferait les deux, sans nuire à personne, en accommodant tout le monde.
Les deux méthodes combinées ensemble, l’abaissement des prix par l’escompte et
le dividende, seraient calculées de façon à mettre l’équilibre entre les chiffres-argent et les chiffres-prix.
Il faut
les deux méthodes. S’il n’y avait que le dividende, les prix pourraient tendre
à monter, alors même que le coût de revient des produits serait le même. Et
s’il n’y avait que l’abaissement des prix, sans le dividende, cet abaissement
des prix ne servirait pas à grand’chose aux personnes qui n’ont aucun revenu
d’aucune sorte.
La formule
du dividende, étudiée dans la leçon précédente, serait infiniment préférable au
bien-être social, l'assurance-chômage et autres lois actuelles de sécurité
sociale car, répétons-le, ce dividende ne serait pas pris dans les taxes de
ceux qui travaillent, mais serait financé par de l'argent nouveau, créé par
l'Office National de Crédit. Personne ne se ferait donc vivre par les taxes des
contribuables; ce serait un héritage dû à tous les citoyens du pays, qui sont
pour ainsi dire tous actionnaires de la compagnie Canada Limitée.
Et
contrairement au bien-être social, ce dividende serait sans enquête, il ne
pénaliserait donc pas ceux qui veulent travailler. Loin d'être une incitation à
la paresse, il permettrait aux gens de s'occuper dans l'activité de leur choix,
celle où ils ont des talents. D'ailleurs, si les gens arrêtaient de travailler,
le dividende baisserait automatiquement, puisqu'il est basé sur la production
existante. Sans ce revenu non lié à l'emploi, le progrès devient non plus un
allié de l'homme, mais une malédiction, puisqu'en éliminant le besoin de labeur
humain, il fait perdre aux travailleurs leur seul source de revenu.
Et grâce
au ce mécanisme de l'escompte sur les prix, toute inflation serait impossible:
en effet, l'escompte fait baisser les prix. Et l'inflation, ce sont les prix
qui montent. La meilleure manière d'empêcher les prix de monter, c'est de les
faire baisser! De plus, l'escompte sur les prix est exactement le contraire de
la taxe de vente: au lieu de payer les produits plus cher par des taxes, les
consommateurs les paient moins cher grâce à cet escompte. Qui pourrait s'en
plaindre?
Finance
des travaux publics
Comment se ferait le
financement des services et travaux publics avec un tel système d'argent
social? Chaque fois que la population désirerait un nouveau projet public, le
gouvernement ne se demanderait pas: «A-t-on l'argent?», mais: «A-t-on les
matériaux, les travailleurs pour le réaliser?» Si oui, l'Office National de
Crédit créerait automatiquement l'argent nécessaire pour financer cette
production nouvelle.
Supposons,
par exemple, que la population désire un nouveau pont, dont la construction
coûte 50 millions $. L'Office National de Crédit crée donc 50 millions $ pour
financer la construction de ce pont. Et puisque tout argent nouveau doit être
retiré de la circulation lors de la consommation, ainsi l'argent créé pour la
construction du pont devra être retiré de la circulation lors de la
consommation de ce pont.
De quelle
manière un pont peut-il être «consommé»? Par usure ou dépréciation. Supposons
que les ingénieurs qui ont construit ce pont prévoient qu'il durera 50 ans; ce
pont perdra donc un cinquantième de sa valeur à chaque année. Puisqu'il a coûté
50 millions $ à construire, il subira donc une dépréciation d'un million $ par
année. C'est donc un million de dollars qui devront être retirés de la
circulation à chaque année, pendant 50 ans. Au bout de 50 ans, le pont sera
complètement payé, sans un sou d'intérêt ni de dette.
Est-ce que
ce retrait d'argent se fera par les taxes? Non, cela n'est nullement
nécessaire, dit Douglas, le concepteur du système du Crédit Social. Il existe
une autre méthode bien plus simple pour retirer cet argent de la circulation,
celle de l'ajustement des prix (appelé aussi escompte compensé).
D'ailleurs,
sous un système de crédit social, les taxes diminueraient de façon drastique,
et la plupart disparaîtraient tout simplement. Le juste principe à observer,
c'est que les gens ne paient que pour ce qu'ils consomment. Par contre, il
serait injuste de faire payer à la population de tout le pays des services qui
ne sont offerts que dans une rue ou une municipalité, comme le service d'eau,
d'égout ou de vidange; ce sont ceux qui bénéficient de ces services qui
auraient à payer la municipalité qui les fournit.
De quelle manière cet ajustement des prix fonctionnerait-il? L'Office
National de Crédit serait chargé de tenir une comptabilité exacte de l'actif et
du passif de la nation, ce qui ne nécessiterait que deux colonnes: d'un côté,
on inscrirait tout ce qui est produit dans le pays durant la période en
question (l'actif), et de l'autre, tout ce qui est consommé (le passif). Le 1
million $ de dépréciation annuelle du pont, de l'exemple mentionné plus haut,
serait donc inscrit dans la colonne «passif» ou «consommation», et ajouté à
toutes les autres formes de consommation ou disparition de richesse durant
l'année.
Trois principes
Il existe
trois principes de base dans le Crédit Social: 1. l'argent émis sans dette par
le gouvernement, représentant de la société, selon la production, et retiré de
la circulation selon la consommation; 2. le dividende mensuel à tous les
citoyens; 3. l'escompte compensé. Les trois sont nécessaires; c'est comme un
trépied: enlevez un de ces trois principes, et le reste ne tient plus.
Toute
cette technique du Crédit Social, telle qu'expliquée très brièvement ci-haut,
n'a qu'un but: financer la production des biens qui répondent aux besoins; et
financer la distribution de ces biens pour qu'ils atteignent les besoins. En
examinant la circulation du crédit sur le schéma ci-dessous, on s'apercevra que
l'argent ne s'accumule en aucun temps, qu'il ne fait que suivre le mouvement de
la richesse, entrant en circulation au rythme de la production, et prenant la
voie du retour vers sa source (l'Office National de Crédit) au rythme de la
consommation (lorsque les produits sont achetés chez le marchand). En tout
temps, l'argent demeure un reflet exact de la réalité: de l'argent apparaît
lorsqu'un nouveau produit apparaît, et cet argent disparaît lorsque le produit
disparaît (est consommé). Où est l'inflation là-dedans, messieurs les
soi-disant instruits?
La
circulation de l'argent
Dans un système de Crédit Social
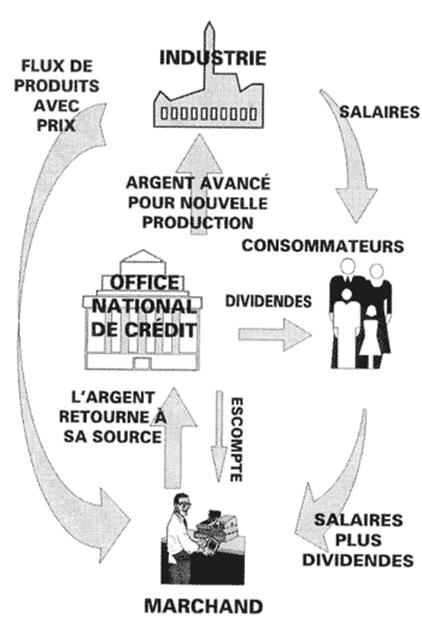
De l'argent
est avancé au producteur (industrie) par l'Office National de Crédit, pour la
production de nouveaux biens, ce qui amène (flèche de gauche) un flux de
produits étiquetés avec des prix et (flèche de droite), des salaires distribués
aux employés. Puisque les salaires ne suffisent pas pour acheter toute la
production, l'Office de Crédit comble la différence par l'émission d'un
dividende périodique à tous les citoyens. La rencontre des consommateurs et des
produits se fait chez le marchand, et lorsqu'un produit est acheté (consommé),
l'argent qui avait été avancé au début de la production de ce produit retourne
à sa source, l'Office National de Crédit, ayant ainsi accompli sa fonction et
terminé sa course dans le circuit financier, puisque le produit a atteint le
consommateur. En tout temps, il y a une égalité entre les moyens d'achat entre
les mains de la population, et les prix à payer pour les biens consommables mis
en vente sur le marché.
* *
*
Tout cela
ouvre des horizons et possibilités insoupçonnés. Pour que ces possibilités
deviennent réalités, il faut que tous connaissent le Crédit Social. Et pour
cela, il faut que tous reçoivent Vers Demain. C'est là que votre responsabilité
entre en jeu: vous qui avez compris le Crédit Social, c'est votre devoir de le
faire connaître aux autres, en sollicitant autour de vous l'abonnement à Vers
Demain. Bon succès!
LEÇON 7 — L’HISTOIRE DU CONTRÔLE BANCAIRE AUX ÉTATS-UNIS
La dictature des banquiers et leur système d'argent-dette
ne se limite pas seulement au Canada, mais s'étend dans tous les pays du monde.
En effet, il suffirait qu'un seul pays se libère de cette dictature et donne
l'exemple de ce que pourrait être un système d'argent honnête, émis sans
intérêt et sans dette par le gouvernement souverain de la nation, pour que le
système d'argent-dette des banquiers s'écroule dans le monde entier.
Cette lutte des Financiers internationaux pour installer
leur système frauduleux d'argent-dette a été particulièrement virulente aux
Etats-Unis depuis le tout début de leur existence, où les faits montrent que
plusieurs hommes d'Etat américains étaient bien au courant du système d'argent
malhonnête que les Financiers voulaient imposer et de tous les malheurs qu'il
entraînerait pour l'Amérique. Ces hommes d'Etat étaient de véritables
patriotes, qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour conserver aux
Etats-Unis un système d'argent honnête, libre du contrôle des Financiers. Les
Financiers font tout pour tenir cachée cette facette de l'histoire des
Etats-Unis, de peur que l'exemple de ces patriotes ne soit suivi encore
aujourd'hui. Voici ces faits que les Financiers voudraient que la population
ignore:
 La population la plus heureuse
La population la plus heureuse
Nous sommes en 1750. Les
Etats-Unis d'Amérique n'existent pas encore; ce sont les 13 colonies sur le
continent américain qui forment la «Nouvelle-Angleterre», possession de la
mère-patrie, l'Angleterre. Benjamin Franklin écrivait de la population de ce
temps: «Impossible de trouver de population plus heureuse et plus prospère
sur toute la surface du globe.» Faisant rapport en Angleterre, on lui
demanda le secret de cette prospérité dans les colonies, alors que la misère
régnait dans la mère-patrie:
«C'est bien simple, répondit
Franklin. Dans les colonies, nous émettons notre propre papier-monnaie, nous
l'appelons Colonial Script, et nous en émettons assez pour faire passer
facilement tous les produits des producteurs aux consommateurs. Créant ainsi
notre propre papier-monnaie, nous contrôlons notre pouvoir d'achat et nous
n'avons aucun intérêt à payer à personne.»
Les banquiers anglais, mis au
courant, firent adopter par le Parlement anglais une loi défendant aux colonies
de se servir de leur monnaie script et leur ordonnant de se servir uniquement
de la monnaie-dette d'or et d'argent des banquiers qui était fournie en
quantité insuffisante. La circulation monétaire dans les colonies se trouva
ainsi diminuée de moitié.
«En un an, dit Franklin, les
conditions changèrent tellement que l'ère de prospérité se termina, et une
dépression s'installa, à tel point que les rues des colonies étaient remplies
de chômeurs.»
Alors advint la guerre contre
l'Angleterre et la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, en 1776. Les manuels
d'histoire enseignent faussement que la Révolution Américaine était due à la
taxe sur le thé. Mais Franklin déclara: «Les colonies auraient volontiers
supporté l'insignifiante taxe sur le thé et autres articles, sans la pauvreté
causée par la mauvaise influence des banquiers anglais sur le Parlement: ce qui
a créé dans les colonies la haine de l'Angleterre et causé la guerre de la
Révolution.»
Les Pères Fondateurs des
Etats-Unis, ayant tous ces faits en mémoire, et pour se protéger de
l'exploitation des banquiers internationaux, prirent bien soin de stipuler
clairement dans la Constitution américaine, signée à Philadelphie en 1787, dans
l'article 1, section 8, paragraphe 5: «C'est au Congrès qu'appartiendra le
droit de frapper l'argent et d'en régler la valeur.»
 La banque des banquiers
La banque des banquiers
Mais les banquiers ne lâchèrent pas le morceau.
Leur représentant, Alexander Hamilton, fut nommé Secrétaire du Trésor
(l'équivalent de notre ministre des Finances) dans le cabinet de George
Washington, et se fit l'avocat d'une banque nationale privée et de la création
d'un argent-dette avec de faux arguments, tels que: «Une dette nationale,
pourvu qu'elle ne soit pas excessive, est une bénédiction nationale... Le
gouvernement se montrera sage en renonçant à l'usage d'un expédient aussi
séduisant et dangereux, soit d'émettre son propre papier-monnaie.» Hamilton
leur fit aussi accroire que seul l'argent-dette des banques privées était
valable pour les transactions avec les pays étrangers.
 Thomas Jefferson, le Secrétaire d'Etat, était fortement opposé à ce projet,
mais le président Washington se laissa finalement convaincre par les arguments
d'Hamilton. Une banque nationale fut donc créée en 1791, la «Bank of the United
States», avec une charte d'une durée de 20 ans. Quoique nommée «Banque des
Etats-Unis», elle était plus véritablement la «banque des banquiers»,
puisqu'elle n'appartenait pas du tout à la nation, au gouvernement américain,
mais aux individus détenteurs des actions de la banque, les banquiers privés.
Le nom de «banque des Etats-Unis» fut délibérément choisi dans le but de
laisser croire à la population américaine qu'elle était propriétaire de la
banque, ce qui n'était pas du tout le cas. La charte expira en 1811 et le
Congrès vota contre son renouvellement, grâce à l'influence de Jefferson et
d'Andrew Jackson:
Thomas Jefferson, le Secrétaire d'Etat, était fortement opposé à ce projet,
mais le président Washington se laissa finalement convaincre par les arguments
d'Hamilton. Une banque nationale fut donc créée en 1791, la «Bank of the United
States», avec une charte d'une durée de 20 ans. Quoique nommée «Banque des
Etats-Unis», elle était plus véritablement la «banque des banquiers»,
puisqu'elle n'appartenait pas du tout à la nation, au gouvernement américain,
mais aux individus détenteurs des actions de la banque, les banquiers privés.
Le nom de «banque des Etats-Unis» fut délibérément choisi dans le but de
laisser croire à la population américaine qu'elle était propriétaire de la
banque, ce qui n'était pas du tout le cas. La charte expira en 1811 et le
Congrès vota contre son renouvellement, grâce à l'influence de Jefferson et
d'Andrew Jackson:
«Si le Congrès, dit Jackson, a le droit d'après la Constitution d'émettre du
papier-monnaie, ce droit leur a été donné pour être utilisé par eux seuls, non
pas pour être délégué à des individus ou des compagnies privées.»
Ainsi se terminait l'histoire de la première
Banque des Etats-Unis, mais les banquiers n'avaient
pas dit leur dernier mot.
Les banquiers
déclenchent la guerre
Nathan Rothschild, de la Banque d'Angleterre, lança un
ultimatum: «Ou bien le renouvellement de la charte est accordé, ou bien les
Etats-Unis sont impliqués dans une guerre très désastreuse.» Jackson et les
patriotes américains ne se doutaient pas que le pouvoir des banquiers pouvait
s'étendre jusque-là. «Vous êtes un repaire de voleurs, de vipères, leur dit
le président Jackson. J'ai l'intention de vous déloger, et par le Dieu Eternel,
je le ferai!» Nathan Rothschild émit des ordres: «Donnez une leçon à ces
impudents Américains. Ramenez-les au statut de colonie.»
Le gouvernement anglais déclencha la guerre de 1812
contre les Etats-Unis. Le plan de Rothschild était d'appauvrir les Américains
par la guerre à un tel point qu'ils seraient obligés de demander de l'aide
financière... qui bien sûr ne serait accordée qu'en retour du renouvellement de
la charte de la «Bank of the United States». Il y eut des milliers de morts,
mais qu'importe à Rothschild? Il avait atteint son but: la charte fut
renouvelée en 1816.
Abraham
Lincoln est assassiné
 Abraham Lincoln fut élu Président des Etats-Unis en 1860
avec la promesse d'abolir l'esclavage des Noirs. 11 Etats du Sud, favorables à
l'esclavage des Noirs, décidèrent donc de quitter l'Union, de se séparer des
Etats-Unis: ce fut le début de la Guerre de Sécession, ou Guerre Civile
Américaine (1861-65). Lincoln, étant à court d'argent pour financer les armées
du Nord, partit voir les banquiers de New-York, qui lui offrirent de l'argent à
des taux allant de 24 à 36%. Lincoln refusa, sachant parfaitement que c'était
de l'usure et que cela mènerait les Etats-Unis à la ruine. Mais son problème
d'argent n'était pas réglé pour autant.
Abraham Lincoln fut élu Président des Etats-Unis en 1860
avec la promesse d'abolir l'esclavage des Noirs. 11 Etats du Sud, favorables à
l'esclavage des Noirs, décidèrent donc de quitter l'Union, de se séparer des
Etats-Unis: ce fut le début de la Guerre de Sécession, ou Guerre Civile
Américaine (1861-65). Lincoln, étant à court d'argent pour financer les armées
du Nord, partit voir les banquiers de New-York, qui lui offrirent de l'argent à
des taux allant de 24 à 36%. Lincoln refusa, sachant parfaitement que c'était
de l'usure et que cela mènerait les Etats-Unis à la ruine. Mais son problème
d'argent n'était pas réglé pour autant.
Son ami de Chicago, le Colonel
Dick Taylor, vint à la rescousse et lui suggéra la solution: «Que le Congrès
passe une loi autorisant l'émission de billets du Trésor ayant plein cours
légal, payez vos soldats avec ces billets, allez de l'avant et gagnez votre
guerre.»
 C'est ce que Lincoln fit, et il gagna la guerre: de 1862
à 1863, Lincoln fit émettre 450 millions $ de «greenbacks» (appelés ainsi par
la population parce qu'ils étaient imprimés avec de l'encre verte au verso).
C'est ce que Lincoln fit, et il gagna la guerre: de 1862
à 1863, Lincoln fit émettre 450 millions $ de «greenbacks» (appelés ainsi par
la population parce qu'ils étaient imprimés avec de l'encre verte au verso).
Lincoln déclara : «Le gouvernement, possédant le
pouvoir de créer et d’émettre la monnaie et le crédit en tant qu’argent, et
bénéficiant du droit de retirer l’argent et le crédit de la circulation par les
taxes ou autre moyen, n’a pas besoin, et ne devrait jamais emprunter de
l’argent à intérêt comme moyen de financer les travaux gouvernementaux et les
entreprises publiques… Le privilège de créer et émettre l’argent est non
seulement la prérogative suprême du gouvernement, mais aussi sa plus grande
opportunité créative.»
Lincoln appela ces greenbacks «la plus grande
bénédiction que le peuple américain ait jamais eue.» Bénédiction pour tous,
sauf pour les banquiers, puisque cela mettait fin à leur «racket» du vol du
crédit de la nation et de création d'argent avec intérêt. Ils mirent donc tout
en oeuvre pour saboter l'oeuvre de Lincoln. Lord Goschen, porte-parole des
Financiers, écrivit dans le London Times (citation tirée de Who Rules America,
par C. K. Howe, et reproduite dans Lincoln Money Martyred, par R. E.
Search):
«Si cette malveillante politique financière provenant de
la République nord-américaine devait s'installer pour de bon, alors, ce
gouvernement fournira sa propre monnaie sans frais. Il s'acquittera de ses
dettes et sera sans aucune dette. Il aura tout l'argent nécessaire pour mener
son commerce. Il deviendra prospère à un niveau sans précédent dans toute
l'histoire de la civilisation. Ce gouvernement doit être détruit, ou il
détruira toute monarchie sur ce globe.» (La monarchie des contrôleurs du crédit.)
Tout d'abord, dans le but de discréditer les greenbacks,
les banquiers persuadèrent le Congrès de voter , en février 1862, la «Clause
d'Exception», qui stipulait que les greenbacks ne pouvaient être utilisés pour
payer l'intérêt sur la dette nationale. Ensuite, ayant financé l'élection
d'assez de sénateurs et de députés, les banquiers firent voter par le Congrès
en 1863 le retrait de la loi des Greenbacks et son remplacement par le National
Banking Act (Loi des Banques Nationales, où l'argent serait créé avec intérêt
par des compagnies privées).
Cette loi stipulait aussi que les greenbacks seraient
immédiatement retirés de la circulation aussitôt leur retour au Trésor pour paiement
des taxes. Lincoln protesta énergiquement, mais son objectif le plus pressant
était de gagner la guerre et de sauver l'Union, ce qui l'obligea à remettre
après la guerre le veto qu'il projetait contre cette loi et l'action qu'il
entendait prendre contre les banquiers. Lincoln déclara tout de même: «J'ai
deux grands ennemis: l'armée du Sud en face et les banquiers en arrière. Et des
deux, ce sont les banquiers qui sont mes pires ennemis.»
Lincoln fut réélu Président en 1864 et fit
clairement savoir qu'il s'attaquerait au pouvoir des banquiers une fois la
guerre terminée. La guerre se termina le 9 avril 1865, mais Lincoln fut
assassiné cinq jours plus tard, le 14 avril. Une formidable restriction du
crédit s'ensuivit, organisée par les banques. L'argent en circulation dans le
pays, qui était de 1907 millions $ en 1866, soit 50,46 $ pour chaque Américain,
tomba à 605 millions $ en 1876, soit 14,60 $ par Américain. Résultat: en dix
ans, 54 446 faillites, pertes de 2 milliards $. Cela ne suffisant pas, on alla
jusqu'à réduire la circulation d'argent à 6,67 $ par tête en 1867!
William
Jennings Bryan: «Les banques doivent se retirer»
 L'exemple de
Lincoln demeurait néanmoins dans plusieurs esprits, même jusqu'en 1896. Cette
année-là, le candidat démocrate à la présidence était William Jennings Bryan,
et encore une fois, les livres d'histoire nous disent que ce fut une bonne
chose qu'il ne fut pas élu président, car il était contre la monnaie «saine»
des banquiers, l'argent créé sous forme de dette, et contre l'étalon-or:
L'exemple de
Lincoln demeurait néanmoins dans plusieurs esprits, même jusqu'en 1896. Cette
année-là, le candidat démocrate à la présidence était William Jennings Bryan,
et encore une fois, les livres d'histoire nous disent que ce fut une bonne
chose qu'il ne fut pas élu président, car il était contre la monnaie «saine»
des banquiers, l'argent créé sous forme de dette, et contre l'étalon-or:
«Nous disons dans notre programme que nous croyons que le
droit de frapper et d'émettre la monnaie est une fonction du gouvernement. Nous
le croyons. Et ceux qui y sont opposés nous disent que l'émission de
papier-monnaie est une fonction de la banque, et que le gouvernement doit se
retirer des affaires de la banque. Eh bien! moi je
leur dis que l'émission de l'argent est une fonction du gouvernement, et que
les banques doivent se retirer des affaires du gouvernement... Lorsque nous aurons
rétabli la monnaie de la Constitution, toutes les autres réformes nécessaires
seront possibles, mais avant que cela ne soit fait, aucune autre réforme ne
peut être accomplie.»
La Réserve
fédérale: le plus gigantesque trust
 Et finalement, le 23 décembre 1913, le Congrès américain
votait la loi de la Réserve Fédérale, qui enlevait au Congrès lui-même le
pouvoir de créer l'argent, et remettait ce pouvoir à la «Federal Reserve
Corporation». Un des rares membres du Congrès qui avait compris tout l'enjeu de
cette loi, Charles A. Lindbergh (le père du célèbre aviateur), déclara:
Et finalement, le 23 décembre 1913, le Congrès américain
votait la loi de la Réserve Fédérale, qui enlevait au Congrès lui-même le
pouvoir de créer l'argent, et remettait ce pouvoir à la «Federal Reserve
Corporation». Un des rares membres du Congrès qui avait compris tout l'enjeu de
cette loi, Charles A. Lindbergh (le père du célèbre aviateur), déclara:
«Cette loi établit le plus
gigantesque trust sur terre. Lorsque le Président (Wilson) signera ce projet de
loi, le gouvernement invisible du Pouvoir Monétaire sera légalisé... le pire
crime législatif de tous les temps est perpétré par cette loi sur la banque et
le numéraire.»
L’éducation
du peuple
Qu'est-ce qui a permis aux banquiers d'obtenir finalement
le monopole complet du contrôle du crédit aux Etats-Unis? L'ignorance de la
population sur la question monétaire. John Adams écrivait à Thomas Jefferson,
en 1787:
«Toutes les perplexités,
désordres et misères ne proviennent pas tant de défauts de la Constitution, du
manque d'honneur ou de vertu, que d'une ignorance complète de la nature de la
monnaie, du crédit et de la circulation.»
 Salmon P. Chase, Secrétaire du Trésor sous Lincoln,
déclara publiquement, peu après le passage de la loi des Banques Nationales:
Salmon P. Chase, Secrétaire du Trésor sous Lincoln,
déclara publiquement, peu après le passage de la loi des Banques Nationales:
«Ma contribution au passage de
la loi des Banques Nationales fut la plus grande erreur financière de ma vie.
Cette loi a établi un monopole qui affecte chaque intérêt du pays. Cette loi
doit être révoquée, mais avant que cela puisse être accompli, le peuple devra
se ranger d'un côté, et les banques de l'autre, dans une lutte telle que nous
n'avons jamais vue dans ce pays.»
Et l'industriel Henry Ford a dit:
«Si la population comprenait le
système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin.»
L'éducation du peuple, voilà la solution. Et c'est
justement la formule de Vers Demain. Ah! si tous les
créditistes comprenaient leur responsabilité de répandre Vers Demain! Le Crédit
Social, qui établirait une économie où tout est ordonné au service de la
personne humaine, a justement pour but de développer la responsabilité
personnelle, de créer des hommes responsables. Chaque conquête d'un esprit au
Crédit Social est une avance. Chaque personne formée par le Crédit Social est
une force, et chaque acquisition de force est un pas de plus vers la victoire.
Et depuis 69 ans, que de forces acquises!... Et si elles étaient toutes
actives, le Crédit Social, c'est réellement avant demain matin qu'on l'aurait!
Comme l'écrivait Louis Even en 1960: «L'obstacle n'est
ni le financier, ni le politicien, ni aucun adversaire déclaré. L'obstacle est
seulement dans la passivité d'un trop grand nombre de créditistes qui
souhaitent bien voir venir le triomphe de la cause, mais qui laissent à
d'autres le soin de la promouvoir.»
En somme, c'est le refus d'endosser notre responsabilité.
«A ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé.» (Luc 12, 48.) Examen
de conscience, chers créditistes, conversion personnelle, un petit coup de
coeur et endossons nos responsabilités. Nous n'avons jamais été aussi près de
la victoire! Notre responsabilité, c'est de faire connaître le Crédit Social
aux autres, en les faisant s'abonner à Vers Demain, le seul journal qui fait
connaître cette brillante solution.
La loi du
Crédit votée par le Congrès américain en 1932
C’est l’éducation du peuple qui est nécessaire. Quand les
pressions provenant du peuple seront assez fortes, tous les partis seront
d'accord pour adopter la réforme du Crédit Social. Un bel exemple de cela peut
être trouvé dans le «bill Goldsborough» de 1932, qu'un auteur a décrit comme
étant «la réforme monétaire qui est venue le plus près de réussir en vue de
l'établissement d'une monnaie véritablement saine aux Etats-Unis»:
«Une majorité écrasante des membres du Congrès américain
(289 contre 60) était déjà en faveur de cette loi en 1932; et cela dure encore
depuis, sous une forme ou sous une autre. Seul l'espoir futile que le nouveau
Président d'alors (Roosevelt) puisse rétablir la prospérité sans abandonner le
système d'argent-dette dont l'Amérique avait hérité, empêcha le Crédit Social
de devenir la loi des Etats-Unis. En 1936, lorsque le “New Deal” (solution de
Roosevelt) se montra incapable de régler efficacement la crise économique, les
partisans du Crédit Social revinrent en force. Le dernier effort significatif
pour gagner son adoption survint en 1938.» (W. E. Turner, Stable Money, p. 167.)
Même le dividende et l'escompte compensé, deux éléments
essentiels du Crédit Social, étaient mentionnés dans ce projet de loi, qui fut
surnommé «bill Goldsborough», du nom du député démocrate du Maryland, T. Alan
Goldsborough, qui le présenta en Chambre pour la première fois le 2 mai 1932.
Deux personnes qui soutinrent le projet de loi retiennent
particulièrement notre attention: Robert L. Owen, sénateur de l'Oklahoma de
1907 à 1925 et directeur de banque pendant 46 ans, et Charles G. Binderup,
député du Nebraska. Owen publia un article en mars 1936 dans la revue de J. J.
Harpell, The Instructor (et sa version française, Le Moniteur), dont Louis Even
était le rédacteur-adjoint. Quant à M. Binderup, il donna plusieurs causeries à
la radio américaine, durant la crise, pour expliquer les méfaits du contrôle du
crédit par des intérêts privés.
 Voici des extraits du discours
de Robert Owen à la Chambre des Représentants, le 28 avril 1936:
Voici des extraits du discours
de Robert Owen à la Chambre des Représentants, le 28 avril 1936:
«...le projet de loi qu'il
(Goldsborough) présenta alors, avec l'approbation du Comité sur les Banques de
la Chambre — et je crois que ce fut pratiquement un rapport unanime. Ce projet
de loi fut débattu deux jours à la Chambre, un très simple projet de loi,
établissant la politique des Etats-Unis de rétablir et de maintenir la valeur
de la monnaie, et ordonnant au Secrétaire du Trésor, aux officiers de la
Commission de la Réserve Fédérale et aux Banques de la Réserve Fédérale, de
rendre cette politique effective. C'était tout, mais suffisant, et le bill
passa, non par un vote partisan: 117 députés républicains votèrent en faveur de
ce projet de loi (qui avait été présenté par un député démocrate), et le bill
passa par 289 voix contre 60, et de ces 60 députés, seulement 12, par la
volonté du peuple, sont encore au Congrès.
«Ce bill fut défait par le
Sénat, parce qu'il ne fut pas réellement compris. Il n'y avait pas eu
suffisamment de discussion à son sujet dans le public. Il n'y avait pas
d'opinion publique organisée pour l'appuyer.»
Tout est là. C’est l’éducation
du peuple que ça prend. Républicains comme Démocrates votèrent en sa faveur, et
il n'y eut donc point besoin de «parti» du Crédit Social. De plus, Owen admet
que ce qui manquait, c'était l'éducation du peuple, une force dans le peuple.
Cela confirme la méthode de Vers Demain, préconisée par Douglas et Louis Even:
il faut éduquer la population (en distribuant des circulaires et prenant de
l'abonnement à Vers Demain).
Le bill Goldsborough était
intitulé: «Loi pour rendre au Congrès son pouvoir constitutionnel d'émettre
la monnaie et d'en régler la valeur; de fournir un revenu monétaire à la
population des Etats-Unis avec un pouvoir d'achat fixe et équitable du dollar,
suffisant en tout temps pour permettre à la population d'acheter les biens et
les services désirés selon la pleine capacité des possibilités du commerce et
de l'industrie des Etats-Unis... Le système actuel, qui émet l'argent à travers
l'initiative privée pour le profit, résultant en fréquentes et désastreuses
inflations et déflations, doit cesser.»
Le projet de loi prévoyait aussi
un escompte sur les prix à être remboursé aux marchands, et un dividende,
devant commencer à $5 par mois (en 1932), à chaque citoyen de la nation.
Plusieurs groupes témoignèrent en Chambre en faveur de ce projet de loi,
faisant ressortir qu'il contenait tous les mécanismes nécessaires pour empêcher
toute inflation des prix.
L’ignorance de
la population
Le plus ardent opposant à ce projet de loi au Sénat était
Carter Glass, ancien Secrétaire du Trésor, et farouche partisan de la «Federal
Reserve» (contrôle privé de la monnaie). Aussi, le Secrétaire du Trésor (Ministre
des Finances) de Roosevelt, Henry Morgenthau, fortement opposé à toute réforme
monétaire, disait qu'il valait mieux «donner une chance» au «New Deal» de
Roosevelt.
Ce qui aida le plus les adversaires du bill, c'est
l'ignorance quasi totale de la question monétaire dans la population... et même
dans le Sénat. Certains sénateurs, ignorant même jusqu'au mécanisme de la
création de l'argent (crédit) par les banques, s'écriaient: «Mais le
gouvernement ne peut pas créer de l'argent comme ça! Ça va faire de
l'inflation!» Et d'autres, tout en admettant la nécessité de la création
d'argent sans dette, ne voyaient pas la nécessité du dividende ou de l'escompte
compensé. En fait, toutes ces objections tombent d'elles-mêmes après une étude
un peu sérieuse du Crédit Social.
Citations célèbres sur la question de l’argent
 «Laissez-moi émettre et contrôler la monnaie d’une
nation, et je ne fiche de qui fait ses lois.» — Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), père fondateur de la finance
internationale
«Laissez-moi émettre et contrôler la monnaie d’une
nation, et je ne fiche de qui fait ses lois.» — Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), père fondateur de la finance
internationale
«L’histoire nous dit que les changeurs d’argent ont eut
recours à toute forme d’abus, d’intrigue, de tromperie, et autres moyens les
plus violents possibles pour conserver leur contrôle sur les gouvernements en
contrôlant l’argent et son émission.» — Le
Président américain James Madison
“Les puissances d’argent dénoncent comme étant ennemis
publics tous ceux qui remettent en question leurs méthodes ou font la lumière
sur leurs crimes.» — Le candidat démocrate à la
présidence William Jennings Bryan
«Quiconque contrôle la quantité d’argent dans un pays est
le maître absolu de toute l’industrie et du commerce.» — Le Président américain James A. Garfield
 «Le système bancaire fut conçu dans l'iniquité et né dans
le péché. Les banquiers possèdent la planète. Enlevez-leur la planète, mais
laissez-leur le pouvoir de créer l'argent, et d'un trait de plume, ils créeront
assez d'argent pour racheter la planète et en devenir les propriétaires... Si
vous voulez continuer d'être les esclaves des banquiers et payer le prix de
votre esclavage, alors laissez les banquiers continuer de créer l'argent et de
contrôler le crédit.» — Sir Josiah
Stamp, gouverneur de la Banque d’Angleterre, 1940.
«Le système bancaire fut conçu dans l'iniquité et né dans
le péché. Les banquiers possèdent la planète. Enlevez-leur la planète, mais
laissez-leur le pouvoir de créer l'argent, et d'un trait de plume, ils créeront
assez d'argent pour racheter la planète et en devenir les propriétaires... Si
vous voulez continuer d'être les esclaves des banquiers et payer le prix de
votre esclavage, alors laissez les banquiers continuer de créer l'argent et de
contrôler le crédit.» — Sir Josiah
Stamp, gouverneur de la Banque d’Angleterre, 1940.
«Le procédé par lequel les banques créent l’argent est si
simple qu’il en répugne notre esprit.» — John K. Galbraith, dans “Money: Whence it came, where it went”, p. 29.
“Les banques créent l’argent. Il y a longtemps qu’elles
le font, mais elles ne s’en étaient pas bien rendu
compte, et elles ne voulaient pas l’admettre. Très peu l’admettaient. C’est ce
que vous constaterez dans toutes sortes de documents, de manuels de finance,
etc. Mais depuis, et nous devons être très francs à ce sujet, il y a eu
évolution, si bien qu’aujourd’hui, je doute que vous trouviez beaucoup de
banquiers éminents essayant de nier que les banques créent le crédit.» — H. W. White, président des Banques Associées de
Nouvelle-Zélande, devant la Commission monétaire de Nouvelle-Zélande, 1955.
Thomas Edison et Henry Ford
 Terminons cet article avec les citations de deux grands
citoyens américains, Thomas Edison et Henry Ford:
Terminons cet article avec les citations de deux grands
citoyens américains, Thomas Edison et Henry Ford:
Edison: «A travers notre histoire, quelques-uns des
plus grands Américains ont chercher à casser l'empreinte hamiltonienne
(l'argent-dette d'Alexander Hamilton) sur notre politique monétaire, dans le
but d'y substituer une monnaie stable en fonction des besoins physiques de la
nation. Un manque de compréhension dans le public et chez les autorités,
combiné au pouvoir des intérêts bancaires qui ont machiné des intérêts
personnels dans la présente situation chaotique, ont
jusqu'ici contrecarré tout effort.
«Ne les laissez pas vous
embarrasser avec le cri de “monnaie de papier”. Le danger du papier-monnaie est
précisément le danger de l'or — si vous en avez trop, ce n'est pas bon. Il n'y
a qu'une règle pour l'argent et c'est d'en avoir assez pour mener tout le
commerce légitime qui attend d'être fait...
«Si les Etats-Unis adoptent
cette politique d'augmenter leur richesse nationale sans rien payer au
collecteur d'intérêts — car toute dette nationale est faite d'intérêts à payer
— alors vous verrez une ère de progrès et de prospérité dans ce pays qui
n'aurait jamais pu arriver autrement.»
Et un appel d'Henry Ford:
«La jeunesse qui pourra résoudre
la question monétaire fera plus pour le monde que toutes les armées de
l'histoire.»
Jeunes, affamés de vérité et de justice, avez-vous
compris? Joignez les rangs des apôtres du journal Vers Demain, pour le salut de
votre pays et de tous vos concitoyens. Les Pèlerins de saint Michel ont besoin
de vous, ils vous attendent!
LEÇON 8 — Le Crédit Social n’est pas un
parti politique
Le Crédit Social est une finance saine et efficace
 Compter sur un parti, une illusion
Compter sur un parti, une illusion
(Le texte
suivant est tiré de la brochure de Louis Even «Qu’est-ce que le vrai Crédit
Social ? Au-dessus des partis politiques» :)
L'application du Crédit Social instaurerait une
démocratie authentique. Démocratie économique, en rendant chaque consommateur
capable de commander à la production du pays les biens de vie nécessaires à ses
besoins. Démocratie politique, en autant que le peuple pourrait signifier à ses
représentants élus, à ses gouvernements, ce qu'il attend d'eux et en exiger des
résultats. (Demos, peuple; kratein, régner. — Démocratie:
souveraineté du peuple.)
Tout créditiste tant soit peu renseigné sait bien
qu'aujourd'hui, le pouvoir suprême n'est exercé ni par le peuple, ni par ses
gouvernants, mais par une coterie financière. Des hommes d'Etat, comme
Gladstone, Wilson, et bien d'autres, l'ont déclaré explicitement. Mackenzie
King promettait, en 1935, la plus grande bataille de tous les temps «entre les
puissances financières et le peuple.» Bataille qu'il n'a pas engagée, sans
doute parce qu'il jugeait les puissances financières trop fortes et le peuple
trop faible.
Faible, le peuple l'est, en effet; et il peut bien l'être
quand, premièrement, il ignore à peu près tout de la chose publique et de ce
qui se passe dans les coulisses; faible, deuxièmement, quand, au lieu de
l'instruire de ces choses, ceux qui s'agitent devant lui le divisent en
factions politiques adversaires les unes des autres. Ce n'est pas une faction
de plus qui créera l'union, l'union qui ferait sa force, alors que la division
accentue sa faiblesse.
 C'est un homme de génie, Clifford Hugh Douglas, qui a découvert la grande
vérité qu'est le Crédit Social; lui qui a fondé l'école créditiste. Il
connaissait certainement mieux ce que le Crédit Social signifie, en fait de
démocratie, que ces petits hommes de chez nous qui voudraient faire du Crédit
Social le fanion de leur course au pouvoir, ou au moins une estrade pour leurs
trémoussements à la recherche d'un siège de député.
C'est un homme de génie, Clifford Hugh Douglas, qui a découvert la grande
vérité qu'est le Crédit Social; lui qui a fondé l'école créditiste. Il
connaissait certainement mieux ce que le Crédit Social signifie, en fait de
démocratie, que ces petits hommes de chez nous qui voudraient faire du Crédit
Social le fanion de leur course au pouvoir, ou au moins une estrade pour leurs
trémoussements à la recherche d'un siège de député.
Or, Douglas déclarait, dans une conférence à
Newcastle-upon-Tyne, le 19 mars 1937, qu'il existe en Angleterre deux
principaux obstacles à une démocratie authentique, et le premier de ces
obstacles, c'est le système de partis.
Il en est de même au Canada, et la solution ne consiste
pas à nourrir le système de partis, mais à l'affaiblir. Rendre les partis
existants inoffensifs, non pas en faisant une autre coupure dans le peuple,
mais au contraire en unissant les citoyens, tous les citoyens, sans distinction
de partis, pour exprimer leur volonté commune à leurs élus, quels que soient
ces élus et leur couleur politique. Mettre l'accent sur ce qui se fait entre
les élections, quand se tisse le sort des citoyens, plus que lors des élections
quand se joue le sort des politiciens.
Unir les citoyens. Pour cela, commencer par les faire
prendre conscience qu'ils veulent tous les mêmes choses fondamentales; puis les
convaincre qu'en insistant de concert pour obtenir ce que tous veulent ainsi,
ils l'obtiendraient infailliblement.
C'est encore le Major Douglas qui, en une autre occasion,
à Liverpool, le 30 octobre 1936, disait:
«La souveraineté du peuple, c'est-à-dire son aptitude
effective à donner des ordres, croîtrait avec son unanimité; et si tout le
peuple demandait le même résultat, il n'y aurait aucune possibilité de partis,
et il serait également impossible de résister à sa demande.»
Voilà bien, il nous semble, une ligne de conduite toute
tracée. Ligne de conduite parfaitement en accord avec le bon sens même.
Vous ne pourrez jamais mettre tout le monde d'accord
autour d'une boîte électorale. Mais vous pouvez mettre passablement tout le
monde d'accord sur les résultats à réclamer de la politique, si vous avez soin
de les présenter dans l'ordre de leur universalité et de leur urgence: la
sécurité économique, une suffisance de biens aujourd'hui et garantie pour
demain, la liberté de chacun à choisir son occupation et son mode de vie. Tout
le monde veut ces choses-là; et, comme le remarque
Douglas, même ceux qui ne s'en soucient pas pour les autres les veulent pour
eux-mêmes.
Pourquoi donc centraliser l'attention et tourner les
activités vers la boîte électorale, vers la chose qui désunit, au lieu de
s'appliquer à unir effectivement tout le monde autour de demandes sur
lesquelles tout le monde peut être d'accord?
Jamais une réforme importante n'a été obtenue par la
formation d'un nouveau parti politique. La plupart du temps, le parti établi en
vue d'une réforme majeure meurt faute de succès électoral; et si, par hasard,
il arrive au pouvoir, il trouve assez d'obstacles, devant lesquels il finit par
s'immobiliser et n'avoir plus d'autre objectif que de rester au pouvoir sans
rien faire de plus que les partis traditionnels. Pour vaincre les obstacles, il
lui manquait une force: celle d'un peuple suffisamment éclairé et suffisamment
formé, politiquement.
D'ailleurs, une réforme ne peut pas naître d'une
élection. Elle provient, de façon naturelle et démocratique, de la maturation
d'une idéeforce bien cultivée; de son approbation, de sa demande par un nombre
suffisant d'esprits pour créer une volonté générale, exprimée sans être liée
aux aléas de résultats électoraux.
Le Crédit Social entrera dans la législation du pays
quand il sera devenu l'objet d'une demande générale, tellement affirmée que
tous les partis politiques l'accueilleront dans leur programme. Le séquestrer
dans un parti politique, c'est lier son sort au sort électoral de ce parti. Et
ça peut signifier recul au lieu d'avance.
Une idée nouvelle se diffuse par la propagande, elle
s'enracine par l'étude. Plus elle est neuve et de vaste portée,
plus son expansion et son implantation demandent d'efforts, de temps aussi
ordinairement, de ténacité toujours. La cause qui la porte a bien plus besoin
d'apôtres que de députés.
Les promoteurs de partis nouveaux jugent sans doute que
l'éducation politique du peuple prendrait trop de temps, si toutefois ils se
sont arrêtés à cette pensée. Un bon vote leur paraît une méthode plus normale
et surtout plus rapide. Résultat: des pierres tombales, que ne visitent même
plus ceux qui patronnaient ces partis défunts. Nombre de ces messieurs se sont
gentiment casés depuis sous les ailes de partis traditionnels qu'ils avaient
pourtant éloquemment dénoncés.
Monter
la force du peuple, pour que son poids sur les gouvernements dépasse la force
des puissances financières. Ce n'est pas dans un parlement que l'on monte la
force du peuple. C'est là où le peuple est — en dehors des parlements. Et c'est
là la place d'un véritable mouvement créditiste.
Douglas et
l’électoralisme
Le Social Credit Secretariat, organisme fondé par le
major Douglas lui-même, vient de rééditer une conférence donnée par le
fondateur du Crédit Social, le 7 mars 1936. Ce jour-là, Douglas ne parlait pas
à un public quelconque, mais à des créditistes.
Dans cette conférence, Douglas recommande la politique de
pression et condamne vigoureusement la méthode parti politique, surtout celle
d'un parti «du Crédit Social». Il condamne cette méthode, non seulement parce
qu'elle est d'avance vouée à l'échec, mais parce que c'est lier la belle chose
qu'est le Crédit Social à une politique de boîte électorale. Douglas va jusqu'à
dire:
«Si vous élisez un parti du
Crédit Social, en supposant que vous en soyez capables, je puis vous dire que
je considérerais l'élection d'un parti créditiste au pouvoir en ce pays comme
une des plus grandes catastrophes qui puisse arriver.»
La fonction propre d'un député, expliquait Douglas, c'est
de recevoir et transmettre au gouvernement l'expression de la volonté légitime
de ses électeurs. La fonction propre d'un gouvernement, c'est d'accueillir
cette demande et de donner aux experts l'ordre d'y faire suite (aux experts,
donc aux financiers pour la finance). Non pas dire à ces experts comment s'y
prendre, mais leur désigner le résultat à obtenir et exiger ce résultat.
Et le rôle du peuple, lui, c'est de prendre conscience
des objectifs qu'il veut communément et d'exprimer cette volonté à ses
représentants. C'est là que ça doit commencer, de là que ça doit partir, chez
les électeurs. Donc, au lieu de placer l'importance sur l'élu, la placer sur
les électeurs.
Selon les mots de Douglas: «Si vous admettez que le
but, en envoyant des représentants au parlement, est d'obtenir ce que vous
voulez, pourquoi élire une catégorie spéciale d'hommes, un parti spécial plutôt
qu'un autre? Les hommes qui sont là sont capables de passer vos commandes — c'est
là leur rôle. Ce n'est pas leur rôle de dire comment cela sera obtenu. Le
comment doit être laissé aux experts.»
C'est le quoi qui doit être
signifié aux experts, et ce quoi doit procéder d'abord des citoyens eux-mêmes.
L'électoralisme a perverti le sens de la démocratie. Les
partis politiques ne sont bons qu'à diviser le peuple, affaiblir sa force et le
conduire à des déceptions. Y ajouter un parti nouveau ne peut qu'ajouter une
autre déception sous un autre nom. Déception encore plus funeste si l'aventure
traîne avec elle le vocable d'une cause excellente comme celle du Crédit
Social.
(Le texte
suivant est tiré de la brochure de Louis Even «Une finance saine et efficace»)
A la racine du
mal
Pourquoi critiquer et dénoncer le système financier
actuel?
Parce qu'il n'accomplit pas sa fin.
 Quelle est la fin d'un
système financier?
Quelle est la fin d'un
système financier?
La fin d'un système financier, c'est de financer.
Financer la production des biens qui répondent aux
besoins; et financer la distribution de ces biens pour qu'ils atteignent les
besoins.
Si le système financier fait cela, il accomplit son rôle.
S'il ne le fait pas, il n'accomplit pas son rôle. S'il fait autre chose, il
sort de son rôle.
Pourquoi dites-vous que le système financier actuel
n'accomplit pas son rôle?
Parce qu'il y a des biens — biens publics et biens privés
— qui sont demandés par la population, qui sont parfaitement réalisables
physiquement, mais qui restent dans le néant parce que le système financier ne
finance pas leur production.
D'autre part, il y !a des biens offerts à une population
qui en a besoin, mais que des personnes ou des familles ne peuvent se procurer,
parce que le système financier ne finance pas la consommation. Ces faits sont
indéniables.
Avec quoi finance-t-on la production ou la consommation?
Avec des moyens de paiement. Ces moyens de paiement
peuvent être de l'argent métallique, du papier-monnaie légal, ou des chèques
tirés sur des comptes de banque.
Tous ces moyens de paiement peuvent être inclus sous le
terme de «crédit financier», parce que tout le monde les accepte avec
confiance. Le mot crédit implique la confiance. On accepte avec la même
confiance 4 pièces de 25 sous en argent, ou un billet de la Banque du Canada
d'un dollar, ou un chèque d'un dollar sur n'importe quelle banque où le
signataire du chèque a un compte de banque. On sait, en effet, qu'avec l'un ou
l'autre de ces trois moyens de paiement, on peut payer du travail ou des
matériaux pour la valeur d'un dollar si l'on est producteur, ou des biens
consommables pour la valeur d'un dollar si l'on est consommateur.
D'où ce «crédit financier», ces moyens de paiement
tirent-ils leur valeur?
Le crédit financier tire sa valeur du «crédit réel».
C'est-à-dire de la capacité de production du pays. Le dollar, de n'importe
quelle forme, n'a de valeur que parce que la production du pays peut fournir
des produits pour y répondre. On peut bien appeler cette capacité de produire
«crédit réel», parce que c'est un facteur réel de confiance. C'est le crédit
réel d'un pays, sa capacité de production, qui fait qu'on a confiance de
pouvoir vivre dans ce pays.
A qui appartient ce «crédit réel»?
C'est un bien de la société. Sans doute que des capacités
individuelles et des capacités de groupes de toutes sortes y contribuent. Mans
sans l'existence de richesses naturelles, qui sont un don de la Providence et
non pas le résultat d'une compétence individuelle, sans l'existence d'une
société organisée qui permet la division du travail, sans des services publics
comme les écoles, les routes, les moyens de transport, etc., la capacité
globale de production serait beaucoup plus faible, très faible même.
C'est pourquoi l'on parle de production nationale,
d'économie nationale, ce qui ne veut nullement dire production étatisée. C'est
dans cette capacité globale de production que le citoyen, que chaque citoyen
doit pouvoir trouver une base de confiance pour la satisfaction de ses besoins
matériels. Pie XII disait dans son message de Pentecôte 1941:
«L'économie nationale, fruit
d'activités d'hommes qui travaillent unis dans la communauté nationale, ne tend
pas à autre chose qu'à assurer sans interruption les conditions matérielles
dans lesquelles pourra se développer pleinement la vie individuelle des
citoyens.»
A qui appartient le «crédit financier»?
A sa source, le crédit financier appartient à lia collectivité, au même
titre que le crédit réel d'où il tire sa valeur. C'est un bien communautaire
dont doivent bénéficier, d'une manière ou de l'autre, tous les membres de la
communauté.
Comme le «crédit réel», le crédit financier est par sa
nature même un crédit social.
L'utilisation de ce bien communautaire ne doit pas être soumise à des
conditions qui entravent la capacité de production, ni qui détournent la
production de sa fin propre qui est de servir les besoins humains: besoins
d'ordre privé et besoins d'ordre public, dans l'ordre de leur urgence.
Satisfaction des besoins essentiels de tous, avant les demandes de luxe de
quelques-uns; avant aussi le faste et les projets pharaoniques d'administrateurs
publics avides de renommée.
Est-il
possible d'obtenir de l'économie générale le respect de cette hiérarchie des
besoins, sans une dictature qui planifie tout et qui impose les programmes de
production et gère la répartition des produits?
Certainement, c'est possible, moyennant un système
financier qui garantisse à chaque individu une part du crédit financier
communautaire. Une part suffisante pour que l'individu puisse commander
lui-même à la production du pays de quoi satisfaire au moins ses besoins
essentiels.
Un tel système financier ne dicterait rien. La production
prendrait ses programmes des commandes venant des consommateurs, pour ce qui
est des biens d'ordre privé; et elle les prendrait des commandes venant des
corps publics, pour ce qui est des biens d'ordre public. Le système financier
servirait ainsi, d'une part, à exprimer les volontés des consommateurs; d'autre
part, il serait au service des producteurs pour mobiliser la capacité de
production du pays dans le sens des demandes ainsi exprimées.
Pour cela, évidemment, il faut un système financier qui
se plie au réel, et non pas qui le violente. Un système financier qui reflète
les faits, et non pas qui les contredise. Un système financier qui distribue,
et non pas qui rationne. Un système financier qui serve l'homme, et non pas qui
l'avilisse.
Un tel système financier est-il concevable?
Oui. Les grandes lignes en ont été tracées par C. H.
Douglas, le maître génie qui a présenté au monde ce qu'on appelle le Crédit
Social (à ne pas confondre avec les prostitutions de partis politiques qui se
parent de ce nom).
Douglas a résumé en trois propositions les principes de
base d'un système qui répondrait à ces fins et qui, par ailleurs, serait assez
souple pour suivre l'économie dans tous ses développements, jusqu'à n'importe
quel degré de mécanisation, de motorisation ou d'automatisation.
Les trois propositions de Clifford Hugh Douglas
Quelles sont ces trois propositions de Douglas?
Douglas a énoncé publiquement ces trois propositions en
trois circonstances: à Swanwick, en 1924; devant le Comité MacMillan, en mai
1930; dans une conférence prononcée à la salle Caxton, de Londres, en octobre
1930. Et il les a reproduites dans des écrits de lui, entre autres dans The
Monopoly of Credit.
La première de ces propositions a trait à la finance de
la consommation, par un ajustement entre le pouvoir d'achat et les prix:
Les moyens d'achat (cash credits) entre les mains de la population d'un
pays doivent, en tout temps, être collectivement égaux aux prix collectifs à
payer (collective cash prices) pour les biens consommables mis en vente dans ce
pays ; et ces moyens d'achat (cash credits) doivent être annulés lors de
l'achat des biens de consommation.
Douglas n'a rien changé dans les termes de cette
proposition: ils étaient les mêmes en 1930 qu'en 1924. Dans cette proposition,
pour mentionner les moyens de paiement, numéraire ou argent scriptural, entre
les mains des consommateurs, Douglas emploie le terme «cash credits», tandis
que, lorsqu'il parle de finance de la production, il dit simplement «credits».
La différence entre les deux, c'est que l'argent entre
les mains des consommateurs est à eux: c'est pour eux du pouvoir d'achat,
qu'ils emploient que selon leur volonté en obtenant des produits de leur choix.
Tandis que les crédits à la production sont des avances que le producteur doit
rembourser lorsqu'il aura vendu ses produits.
Quel est le but de cette première proposition énoncée par
Douglas?
Cette proposition a pour but de réaliser ce qu'on peut
appeler le pouvoir d'achat parfait, en établissant l'équilibre entre les prix à
payer par les acheteurs et l'argent entre les mains des acheteurs.
Le Crédit Social fait une différence entre le prix de
revient comptable (cost price) et le prix à payer par l'acheteur (cash price).
L'acheteur n'aurait pas à payer le prix de revient intégral, mais seulement ce
prix amené à un niveau correspondant aux moyens d'achat entre les mains de la
population.
Le prix comptable doit toujours être récupéré par le
producteur, s'il veut rester en affaires. Mais le prix à payer doit être au
niveau des moyens d'achat entre les mains des consommateurs, si l'on veut que
la production atteigne sa fin, qui est
la consommation.
Comment cette double condition peut-elle être réalisable?
Par un mécanisme d'ajustement des prix. Un ajustement, et
non pas une fixation des prix: l'établissement des prix de revient est affaire
des producteurs eux-mêmes, ce sont eux qui savent ce la production leur coûte
de dépenses.
L'ajustement proposé comporterait un coefficient qui
s'appliquerait à tous les prix au détail. Ce coefficient serait calculé
périodiquement (tous les trois ou six mois, par exemple), d'après le rapport
entre la consommation totale et la production totale pendant le terme écoulé.
Si, par exemple, dans le terme écoulé, la production de
toute sorte dans le pays s'est totalisée à 40 milliards de dollars, et si la
consommation de toute sorte s'est totalisée à 30 milliards, on en conclut que,
quels que soient les prix comptables de revient; c'est en réalité 30 milliards
qu'a coûté au pays la production des 40 milliards. C'est donc 30 milliards qui
est le véritable coût de la production totale de 40 milliards. Et si les
producteurs doivent récupérer 40 milliards, les consommateurs, eux, ne doivent
payer que 30 milliards. Les 10 milliards manquant doivent être fournis aux
producteurs par une autre source, non pas par les acheteurs. C'est au mécanisme
monétaire d'y voir.
Dans ce cas, le coefficient appliqué à tous les prix au
détail sera de 3/4: les prix de revient seront multipliés par ce coefficient,
par 3/4 ou 0,75. L'acheteur ne paiera donc que 75 pour cent du prix comptable.
Autrement dit, un escompte général de 25 pour cent (le
contraire .d'une taxe de vente) va être décrété sur tous les prix de vente au
détail pour la durée du terme qui commence. A la fin de chaque terme, le taux
de l'escompte général est ainsi calculé en fonction de l'état de la
consommation par rapport à l'état de la production du terme écoulé. On se
rapproche ainsi le plus possible du pouvoir d'achat parfait.
On appelle parfois cette opération un prix compensé ou un
escompte compensé, parce que l'argent que le vendeur n'obtient pas die
l'acheteur à cause de cet escompte, il le reçoit ensuite de l'Office du Crédit
National. Cette compensation permet au vendeur de récupérer son plein prix de
revient. Personne n'est perdant. Tout le monde y gagne par l'écoulement
facilité des produits vers les besoins.
Et quelle est la deuxième proposition de Douglas?
La deuxième proposition de Douglas a trait à la finance
de la production. Elle fut exprimée comme suit, par son auteur, à Swanwick et
devant le Comité MacMillan:
Les crédits nécessaires pour financer la production doivent provenir, non
pas d'épargnes, mais de nouveaux crédits se rapportant à une nouvelle
production.
A la salle Caxton, en octobre 1930. Douglas variait ainsi
la fin de son énoncé:
«de nouveaux crédits se
rapportant à la production.»
Il ne dit plus «nouvelle production», mais seulement
«production». C'est évidemment que les deux sont synonymes. A mesure que la
production se fait, c'est une nouvelle production. De la nouvelle production
pour entretenir le flot de production où s'approvisionne le consommateur.
C'est donc à tort que certains ont interprété cette
proposition comme s'appliquant seulement à une augmentation dans le volume de
la production, ce qui n'est certainement pas le cas d'après le contexte des
trois propositions.
Douglas ajoute :
Et ces crédits ne seront rappelées que selon le rapport de la dépréciation
générale à «l'appréciation», à l'enrichissement général.
Pourquoi financer ainsi la production avec des crédits
nouveaux et non pas avec de l'épargne? — Parce que l'épargne provient d'argent
qui a été distribué en rapport avec de la production faite. Or tout cet argent
est entré dans le prix de revient de la production faite. Si cet argent n'est
pas employé pour acheter la production, l'écart entre les moyens d'achat et les
prix augmentera.
On peut objecter que l'épargne employée à financer un
nouveau flot de production, par investissement ou autrement, revient dans la
circulation comme pouvoir d'achat. C'est vrai, mais c'est à titre de dépenses
faites par le producteur, donc en créant un nouveau prix. Or, la même somme
d'argent ne peut pas servir à liquider à la fois le prix correspondant de
l'ancienne production et le prix correspondant de la nouvelle production.
Chaque fois que l'argent épargné revient ainsi à des
consommateurs, c'est en créant un nouveau prix, sans avoir liquidé un ancien
prix laissé sans pouvoir d'achat correspondant lorsque cet argent devenait
épargne.
Et la troisième proposition financière de Douglas?
La troisième proposition introduit un élément nouveau
dans le pouvoir d'achat: la distribution d'un dividende à tous, employés ou non
dans la production. C'est donc un facteur de composition du pouvoir d'achat,
qui ne laisse aucun individu sans moyens de paiement.
C'est la reconnaissance du droit de tous à une part de la
production, à seul titre de co-capitalistes, de co-héritiers du plus gros
facteur de la production moderne: le progrès acquis, grossi et transmis d'une
génération à l'autre. A titre également de co-propriétaires des richesses
naturelles, don gratuit de Dieu.
C'est aussi le moyen d'entretenir un flot de pouvoir
d'achat en rapport avec le flot de production, quand bien même la production se
passerait de plus en plus du besoin d'employés. Ce serait donc la solution au
plus gros casse-tête actuel, qui fait des économistes lever les bras au ciel et
qui fait les gouvernements s'ahurir devant l'insuccès de leur politique de
plein emploi, d'embauchage intégral. La poursuite de l'embauchage intégral est
une absurdité, difficile à justifier de la part d'êtres intelligents, alors que
le progrès s'applique inexorablement à désembaucher, à libérer du besoin
d'employés.
Voici comment s'exprime Douglas:
La distribution de moyens d'achat (cash credits) aux individus doit
progressivement dépendre de moins en moins de l'emploi. C'est-à-dire que le
dividende doit progressivement déplacer les émoluments et les salaires.
Progressivement — à mesure, comme l'a exprimé ailleurs
Douglas, à mesure qu'augmente la productivité par homme-heure. Ce qui est
parfaitement conforme au réel, conforme à la participation prise respectivement
par le travail et par le progrès dans le flot de production.
Le progrès — bien collectif — prend de plus en plus de
place comme facteur de production, et le labeur humain de moins en moins. Cette
réalité devrait se refléter dans la répartition des revenus, par dividendes à
tous d'une part et par récompense à l'emploi d'autre part.
Mais
n'est-ce pas là proposer tout un chambardement dans les modes de finance de la
production et dans le mode de répartition des droits aux produits?
C'est surtout, et bien plus simplement, un changement de
philosophie, de conception du rôle du système économique et du système
financier, les ramenant à leurs fins propres servies par des moyens appropriés.
Il est temps que les fins reprennent leur place, et les moyens la leur. Il est
temps que la perversion fasse place au redressement.
Mais
tout cela a l'air de supposer que l'argent, ou le crédit financier, peut venir
comme ça, séance tenante, pour financer la production et la consommation!
Certainement. Le système d'argent n'est essentiellement
qu'un système de comptabilité. Les comptables sont-ils à court de chiffres pour
compter, additionner, soustraire, multiplier, diviser, faire des règles de
trois, exprimer des pourcentages?
D'ailleurs, les faits sont là, pour montrer que l'argent
est affaire de chiffres: chiffres que les monopolisateurs du système peuvent
faire surgir ou faire disparaître selon leurs décisions, sans besoin d'objets
concrets autres qu'un livre, une plume et quelques gouttes d'encre.
Dans une conférence donnée à Westminster, le 7 mars 1936,
C. H. Douglas disait à son auditoire — un auditoire créditiste :
«Nous, créditistes, noue disons que le présent système
monétaire ne reflète pas les faits. Nos opposants disent qu'il les reflète.
Eh bien, il n'y a qu'à regarder et se servir de son gros bon sens pour voir ce
qu'il en est. Comment, par exemple, se fait-il qu'un monde qui paraissait
presque fiévreusement prospère en 1929, — du moins réputé prospère, à en juger
par les critères orthodoxes — et certainement capable de produire et offrir une
surabondance de denrées et de services, le faisant et en distribuant une
proportion considérable — comment se fait-il que ce monde-là ait pris figure
d'extrême pauvreté en 1930? Transformation d'apparence si fondamentale que les
conditions économiques en ont été changées du tout au tout. Est. il raisonnable
de supposer qu'entre un jour d'octobre 1929 et quelques mois plus tard, le
monde soit réellement tombé de la grande richesse à la grande pauvreté ? Evidemment
non.»
Douglas faisait cette remarque trois ans et demi avant
l'éclatement de la deuxième grande guerre mondiale. Une fois celle-ci déclarée,
tout le monde pouvait se poser une question de même nature que celle de
Douglas, mais en sens inverse:
Comment
se fait-il qu'après une rareté d'argent pendant dix années, on trouve subito,
du soir au matin, tout l'argent qu'il faut pour une guerre qui dure six années
et qui coûte des milliards?
Même réponse dans les deux cas: Le système d'argent n'est
qu'une question de comptabilité et n'a besoin que de chiffres portant le sceau
de la légalité. Donc, si l'agent manque en face de grandes possibilités de
produire pour satisfaire les besoins humains normaux, et si l'argent devient
abondant quand les producteurs et les moyens de production sont réquisitionnés
pour les champs de bataille et la production d'engins de destruction, c'est
parce que le présent système monétaire impose des décisions, au lieu de
refléter fidèlement les faits résultant d'actes librement posés par des
producteurs libres et des consommateurs libres.
LEÇON 9 — Le Crédit Social et la
doctrine sociale de l’Église (1ere partie)
C.H. Douglas a déjà dit que le Crédit Social pouvait être
défini en deux mots: christianisme appliqué. En effet, une étude comparative du
Crédit Social et de la doctrine sociale de l'Eglise montre jusqu'à quel point
l'établissement des propositions financières du Crédit Social appliquerait à
merveille l'enseignement de l'Eglise sur la justice sociale.
C'est en septembre 1939 que paraissait le premier numéro
de «Vers Demain», fondé par Louis Even et Gilberte Côté (suivi par le journal
en langue anglaise en 1953, en polonais en 1999, et en espagnol en 2003). Il y
a donc 67 ans que les «Bérets Blancs» parcourent les routes du Canada et du
monde entier pour aller porter à la population le message de «Vers Demain».
Mais
justement, quel est le message de «Vers Demain»? Dans quel but ce journal
a-t-il été fondé, quels étaient les intentions, les
objectifs de ses fondateurs? Ce message, cet objectif, c'est encore le même en
2004 qu’au tout début, en 1939: promouvoir le développement d'un monde
meilleur, une société chrétienne, par la diffusion et l'application de
l'enseignement de l'Eglise catholique romaine — et cela dans tous les domaines
de la vie en société. La poursuite d'un monde meilleur: c'est précisément pour
cette raison que les fondateurs du journal l'appelèrent «Vers Demain»; ils
voulaient travailler à bâtir un demain meilleur qu’aujourd’hui.
 Louis Even était lui-même un grand catholique, et il
était convaincu qu'un monde meilleur ne pourrait être bâti autrement que sur
les principes éternels de l'Evangile du Christ et sur les enseignements de Son
Eglise — l'Eglise catholique romaine — avec en tête son chef visible sur la
terre, le Souverain Pontife, qui est aujourd'hui Benoît XVI.
Louis Even était lui-même un grand catholique, et il
était convaincu qu'un monde meilleur ne pourrait être bâti autrement que sur
les principes éternels de l'Evangile du Christ et sur les enseignements de Son
Eglise — l'Eglise catholique romaine — avec en tête son chef visible sur la
terre, le Souverain Pontife, qui est aujourd'hui Benoît XVI.
Les objectifs de «Vers Demain»
sont d’ailleurs clairement affichés en première page à chaque numéro, tout
juste en bas du titre. On y lit, à gauche: «Journal de patriotes
catholiques, pour le règne des Coeurs de Jésus et de Marie, dans les âmes, les
familles et les pays.» Et à droite: «Pour la réforme économique du
Crédit Social, en accord avec la doctrine sociale de l'Egiise, par l'action
vigilante des pères de famille, et non par les partis politiques» (ce qui
signifie, entre autres, que le «Crédit Social» dont il est question ici n’est
pas un parti politique, mais une réforme économique qui pourrait être appliquée
par n’importe quel parti au pouvoir).
«Vers Demain» est donc un
journal de patriotes catholiques, où il est aussi question de réforme
économique, de «Crédit Social». Pourquoi? «Qu'est-ce que cela a affaire avec la
religion?», diront certains. Le système dit du «Crédit social» n'est rien
d'autre qu'une méthode, un moyen de mettre en application la doctrine sociale
de l'Eglise, qui fait partie intégrante de l'enseignement de l'Eglise. En cela,
«Vers Demain» ne s'éloigne donc pas de son but premier, qui est de «promouvoir
le développement d'une société plus chrétienne par la diffusion de
l'enseignement de l’Egilse catholique romaine.»
Pourquoi une doctrine sociale?
Si l'Eglise intervient dans les questions sociales, et a
développé un ensemble de principes connus sous le nom de «doctrine sociale de
l'Eglise», c'est essentiellement parce que, comme le disait le Pape Benoît XV, «c'est
sur le terrain économique que le salut des âmes est en danger». Son
successeur immédiat, le Pape Pie XI, écrivait aussi:
«Il est exact de dire que telles sont, actuellement, les
conditions de la vie économique et sociale qu'un nombre très considérable
d'hommes y trouvent les plus grandes difficultés pour opérer l'oeuvre, seule
nécessaire, de leur salut.» (Encyclique Quadragesimo
Anno, 15 mai 1931).
Pie XII s'exprimait aussi de manière semblable: «Comment
pourrait-il être permis à l'Eglise, Mère si aimante et soucieuse du bien de ses
fils, de rester indifférente à la vue de leurs dangers, de se taire ou de
feindre de ne pas voir et de ne pas comprendre des conditions sociales qui,
volontairement ou non, rendent ardue et pratiquement impossible une conduite
chrétienne conforme aux commandements du souverain législateur?»
(Radio-message du 1er juin 1941). Et ainsi parlent tous les Papes, y compris
Benoît XVI aujourd'hui.
 Imprégner la société de l’Évangile
Imprégner la société de l’Évangile
Le 25 octobre 2004, le Conseil
Pontifical Justice et Paix publiait le «Compendium de
la Doctrine Sociale de l’Église», attendu depuis plusieurs années. Ce livre
présente, de façon systématique (330 pages de texte plus un index de 200
pages), les principes de la doctrine sociale de l’Église s’appliquant aux
divers secteurs de la vie publique. La rédaction de ce volume avait débuté cinq
ans plus tôt sous la présidence de feu le Cardinal François-Xavier Nguyen Van
Thuan, décédé en septembre 2002. Le livre est dédié au Pape Jean-Paul II,
«maître de doctrine sociale et témoin évangélique de justice et de paix», qui
dans son exhortation apostolique Ecclesia in America en 1999,
mentionnait qu’il «serait très utile d’avoir un compendium ou une synthèse
approuvée de la doctrine sociale catholique, y compris un catéchisme qui
montrerait le lien entre la doctrine sociale et la nouvelle évangélisation.» On
peut lire dans ce Compendium:
«La doctrine sociale de l’Église fait partie intégrante
du ministère d’évangélisation de l’Eglise. Tout ce qui concerne la communauté
des hommes — situations et problèmes relatifs à la justice, à la libération, au
développement, aux relations entre les peuples, à la paix — n’est pas étranger
à l’évangélisation, et celle-ci ne serait pas complète si elle ne tenait pas
compte de l’appel réciproque que se lancent continuellement L’Evangile et la
vie concrète, personnelle et sociale, de l’homme. (n. 66). Par sa doctrine
sociale, l’Eglise ‘se propose d’assister l’homme sur le chemin du salut’: il
s’agit de sa fin primordiale et unique. (n. 69). L’Eglise a le droit d’être
pour l’homme maîtresse de vérité de la foi: de la vérité non seulement du
dogme, mais aussi de la morale qui découle de la nature humaine et de
l’Evangile. (n. 70)
«D’un côté, il faut éviter ‘l’erreur qui consiste à
réduire le fait religieux au domaine purement privé’; de l’autre côté, on ne
pas orienter le message chrétien vers un salut purement ultra-terrestre (de
l’autre monde), incapable d’illuminer la présence sur la terre.’ En raison de
la valeur publique de l’Evangile et de la foi et à cause des effets pervers de
l’injustice, c’est-à-dire du péché, l’Eglise ne peut pas demeurer indifférente
aux affaires sociales. ‘Il appartient à l’Eglise d’annoncer en tout temps et en
tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l’ordre social,
ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où
l’exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des
âmes’.» (Canon 747, n. 2.) (71).
L'Eglise ne peut rester indifférente à des situations telles que la faim
dans le monde et l'endettement, qui mettent en péril le salut des âmes, et
c'est pourquoi elle demande une réforme des systèmes financiers et économiques,
afin qu'ils soient mis au service de l'homme. L'Eglise présente donc les
principes moraux sur lesquels doit être jugé tout système économique et
financier. Et afin que ces principes soient appliqués de manière concrète,
l'Eglise fait appel aux fidèles laïcs — dont le rôle propre, selon le Concile
Vatican Il, est justement de renouveler l'ordre temporel et de l'ordonner selon
le plan de Dieu — pour travailler à la recherche de solutions concrètes et
l'établissement d'un système économique conforme à l'enseignement de l'Evangile
et aux principes de la doctrine sociale de l’Église.
Le Crédit
Social
C'est pour cette raison que Louis Even décida de propager la doctrine du
Crédit Social — un ensemble de principes et de propositions financières énoncés
pour la première fois par l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas, en 1918
(les mots «Crédit Social» signifient «argent social» — un argent émis par la
société, en opposition à l'argent actuel qui est un «crédit bancaire» — un
argent émis par les banques).
Lorsque
Louis Even découvrit la grande lumière du Crédit Social en 1935, il comprit
immédiatement jusqu'à quel point cette solution appliquerait à merveille l'enseignement
de l'Eglise sur la justice sociale — surtout en ce qui concerne le droit de
tous aux biens matériels, la distribution du pain quotidien à tous, par
l'attribution d'un dividende social à chaque être humain. C'est pourquoi, dès
qu'il connut cette lumière, Louis Even se fit un devoir de la faire connaître à
tous.
Quatre
principes de base
La doctrine sociale de l’Eglise peut se résumer en quatre
principes, ou quatre «colonnes», sur lesquels tout système dans la société doit
être basé. On peut lire aux paragraphes 160 et 161 du Compendium de la Doctrine
Sociale de l’Eglise le texte suivant:
«Les principes permanents de la doctrine sociale
de l’Eglise constituent les véritables fondements de l’enseignement social
catholique : à savoir
1.
Le principe de la dignité de la personne humaine, sur lequel reposent tous les autres principes et contenus de la
doctrine sociale;
2.
le bien commun;
3.
la subsidiarité;
4.
la solidarité.
«Ces principes ont un caractère
général et fondamental, car ils concernent la réalité sociale dans son
ensemble… En raison de leur durée dans le temps et de leur universalité de
sens, l’Église les désigne comme le paramètre de référence premier et
fondamental pour l’interprétation et l’évaluation des phénomènes sociaux, dans
lequel puiser les critères de discernement et de conduite de l’action sociale,
en tout domaine.»
La primauté
de la personne humaine
La doctrine sociale de l'Eglise peut se résumer dans ce principe de base:
la primauté de la personne humaine:
«La doctrine sociale chrétienne a pour lumière la Vérité,
pour objectif la Justice et pour force dynamique l'Amour... Son principe de
base est que les êtres humains sont et doivent être fondement, but et sujets de
toutes les institutions où se manifeste la vie sociale.» (Jean XXIII, encyclique Mater et Magistra, 15 mai
1961, nn. 219 et 226.)
Il est écrit dans le Compendium: «L’Eglise voit dans l’homme, dans
chaque homme, l’image vivante de Dieu lui-même; image qui trouve et est appelée
à retrouver toujours plus profondément sa pleine explication dans le mystère du
Christ, Image parfaite de Dieu, Révélateur de Dieu à l’homme et de l’homme à
lui-même.» (n. 105)
«Toute la
vie sociale est l’expression de son unique protagoniste: la personne humaine.
‘L’homme est, et doit être et demeurer le sujet, le fondement et la fin de la
vie sociale.’» (Pie XII, Radio-message du 24 décembre 1944.) (n. 106)
«Une
société juste ne peut être réalisée que dans le respect de la dignité transcendante
de la personne humaine. Celle-ci représente la fin dernière de la société, qui
lui est ordonnée: ‘Aussi l’ordre social et son progrès doivent-ils toujours
tourner au bien des personnes, puisque l’ordre des choses doit être subordonné
à l’ordre des personnes et non l’inverse’. (Concile Vatican II, Constitution
pastorale Gaudium et Spes, 26.)
«Le
respect de la dignité humaine ne peut en aucune façon ne pas tenir compte de ce
principe : il faut ‘que chacun considère son prochain, sans aucune exception,
comme un autre lui-même, qu’il tienne compte avant tout de son existence et des
moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement’. Il faut que tous les
programmes sociaux, scientifiques et culturels, soient guidés par la conscience de la primauté de chaque être
humain.» (132)
Les systèmes au service de
l’homme
 Le Crédit
Social partage la même philosophie. C.H. Douglas écrivait au début de son tout
premier livre, Economic Democracy: «Les systèmes sont faits pour
l'homme, et non pas l'homme pour les systèmes, et l'intérêt de l'homme, qui est
son propre développement, est au-dessus de tous les systèmes.»
Le Crédit
Social partage la même philosophie. C.H. Douglas écrivait au début de son tout
premier livre, Economic Democracy: «Les systèmes sont faits pour
l'homme, et non pas l'homme pour les systèmes, et l'intérêt de l'homme, qui est
son propre développement, est au-dessus de tous les systèmes.»
Et
Jean-Paul écrivait dans sa première encyclique, Redemptor hominis (4
mars 1979, n. 15): «les indispensables transformations des structures
économiques... la misère en face de l'abondance qui met en cause les structures
et mécanismes financiers… L'homme ne peut renoncer à lui-même ni à la place qui
lui est propre dans le monde visible, il ne peut devenir esclave des choses,
esclave des systèmes économiques, esclave de ses propres produits.»
Tous les
systèmes doivent être au service de l'homme, y compris les systèmes financiers
et économiques:
«Je tiens
à aborder une question délicate et douloureuse. Je veux parler du tourment des
responsables de plusieurs pays, qui ne savent plus comment faire face à
l'angoissant problème de l'endettement... Une réforme structurelle du système
financier mondial est sans nul doute une des initiatives les plus urgentes et
nécessaires.» (Message du Pape à la 6e Conférence des Nations Unies sur
le Commerce et le Développement, Genève, 26 septembre 1985.)
«En tant
que société démocratique, veillez attentivement à tout ce qui se passe dans le
puissant monde de l'argent! Le monde de la finance est aussi un monde humain,
notre monde, soumis à la conscience de nous tous; pour lui aussi il y a des
principes éthiques. Veillez donc surtout à ce que vous apportiez une
contribution au service du monde avec votre économie et vos banques, et non une
contribution — peut-être indirecte — à la guerre et à l'injustice!»
(Jean-Paul II, Fluëli, Suisse, 14 juin 1984.)
Dans son
Encyclique Centesimus Annus (publiée en 1991 pour le 100ème anniversaire
de l’encyclique Rerum Novarum de Léon XIII), Jean-Paul II dresse une
liste des principaux droits de l’homme (n. 47):
«Parmi
les principaux droits, il faut rappeler le droit à la vie dont fait partie
intégrante le droit de grandir dans le sein de sa mère après la conception ;
puis le droit de vivre dans une famille unie et dans un climat moral favorable
au développement de sa personnalité ; le droit d'épanouir son intelligence et
sa liberté par la recherche et la connaissance de la vérité ; le droit de
participer au travail de mise en valeur des biens de la terre et d'en tirer sa
subsistance et celle de ses proches ; le droit de fonder librement une famille,
d'accueillir et d'élever des enfants, en exerçant de manière responsable sa
sexualité. En un sens, la source et la synthèse de ces droits, c'est la liberté
religieuse, entendue comme le droit de vivre dans la vérité de sa foi et
conformément à la dignité transcendante de sa personne.»
Non au communisme
La
doctrine sociale de l'Église se situe au-dessus des systèmes économiques existants,
puisqu'elle se confine au niveau des principes. Un système économique sera bon
ou non dans la mesure où il applique ces principes de justice enseignés par
l'Église. C'est la raison pour laquelle le Pape Jean-Paul II écrivait en 1987,
dans son encyclique Solicitudo rei socialis, que l'Eglise «adopte une
attitude critique vis-à-vis du capitalisme libéral et du collectivisme
marxiste... deux conceptions du développement imparfaites et ayant besoin
d'être radicalement corrigées.»
Il est
facile à comprendre pourquoi l'Église condamne le communisme, ou collectivisme
marxiste qui, comme le rappelait le Pape Pie XI, est «intrinsèquement pervers»
et anti-chrétien, puisque son but avoué est la destruction complète de la
propriété privée, de la famille, et de la religion. Mais pourquoi l'Église
condamnerait-elle le capitalisme? Le capitalisme ne vaudrait pas mieux que le
communisme?
Dans le
second chapitre de l’encyclique Centesimus annus, Jean-Paul II rappelle
les différents événements qui ont eu lieu à travers le monde depuis
l'encyclique de Léon XIII jusqu'à aujourd'hui, en passant par les deux guerres
mondiales et l'établissement du communisme en Europe de l'Est, et souligne
combien Léon XIII avait eu raison de dénoncer le socialisme qui, loin de régler
la question sociale, allait s'avérer une faillite monumentale, causant la
souffrance de millions d'innocentes victimes:
«...En
effet, écrit Jean-Paul II, le Pape Léon XIII prévoyait les conséquences
négatives — sous tous les aspects: politique, social et économique — d'une
organisation de la société telle que la proposait le «socialisme »... Il faut
souligner ici la clarté avec laquelle est saisi ce qu'il y a de mauvais dans
une solution qui, sous l'apparence d'un renversement des situations des pauvres
et des riches, portait en réalité préjudice à ceux-là mêmes qu'on se promettait
.d'aider. Le remède se serait ainsi révélé pire que le mal. En
caractérisant la nature du socialisme de son époque, qui supprimait la
propriété privée, Léon XIII allait au coeur du problème.»
L'erreur
fondamentale du socialisme, dit Jean-Paul II, est l'athéisme, car en niant
l'existence de Dieu, d'un être supérieur qui a créé l'homme, on nie aussi
l'existence de toute loi morale, de toute dignité et de tous droits de la
personne; cela mène aux dictatures — où c'est l'Etat qui décide ce qui est bon
pour l'individu, ou au désordre social et à l'anarchie — où chaque individu se
fabrique sa propre conception de ce qui est bien ou mal. Jean-Paul II écrit:
Le capitalisme doit être
corrigé
Même si le
marxisme s'est écroulé, cela ne signifie pas pour autant le triomphe du
capitalisme, car même après la chute du communisme, il existe encore des
millions de pauvres et de situations d'injustice sur la planète:
«La
solution marxiste a échoué, mais des phénomènes de marginalisation et
d'exploitation demeurent dans le monde, spécialement dans le Tiers-Monde, de
même que des phénomènes d'aliénation humaine, spécialement dans les pays les
plus avancés, contre lesquels la voix de l'Eglise s'élève avec fermeté. Des
foules importantes vivent encore dans des conditions de profonde misère
matérielle et Morale. Certes, la chute du système communiste élimine dans de
nombreux pays un obstacle pour le traitement approprié et réaliste de ces
problèmes, mais cela ne suffit pas à les résoudre.» (Centesimus
Annus, 42.)
Par ailleurs, toujours dans son encyclique Centesimus annus,
Jean-Paul II reconnaît aussi les mérites de la libre entreprise, de
l'initiative privée et du profit: «Il semble que, à l'intérieur de chaque
pays comme dans les rapports internationaux, le marché libre soit l'instrument
le plus approprié pour répartir les ressources et répondre efficacement aux
besoins. Toutefois, cela ne vaut que pour les besoins « solvables», parce que
l'on dispose d'un pouvoir d'achat, et pour les ressources qui sont « vendables
», susceptibles d'être payées à un juste prix. Mais il y a de nombreux besoins
humains qui ne peuvent être satisfaits par le marché. C'est un strict devoir de
justice et de vérité de faire en sorte que les besoins humains fondamentaux ne
restent pas insatisfaits et que ne périssent pas les hommes qui souffrent de
ces carences.»
Ce que l'Eglise reproche au capitalisme actuel n'est donc pas la
propriété privée ni la libre entreprise. Au contraire, loin de souhaiter la
disparition de la propriété privée, l'Eglise souhaite plutôt sa diffusion la
plus large possible pour tous, que tous soient propriétaires d'un capital,
soient réellement "capitalistes".
«La
dignité de la personne humaine exige normalement, comme fondement naturel pour
vivre, le droit à l'usage des biens de la terre; à ce droit correspond
l'obligation fondamentale d'accorder une propriété privée autant que possible à
tous.... (Il faut) mettre en branle une politique économique qui encourage et
facilite une plus ample accession à la propriété privée des biens durables: une
maison, une terre, un outillage artisanal, l'équipement d'une ferme familiale,
quelques actions d'entreprises moyennes ou grandes.» (Jean
XXIII, Mater et Magistra, nn. 114-115.)
Le Crédit
Social, avec son dividende à chaque individu, reconnaîtrait chaque être humain
comme étant un véritable capitaliste, propriétaire d’un capital, co-héritier
des richesses naturelles et du progrès (les inventions humaines, la
technologie).
Le capitalisme a été vicié
par le système financier
Ce que
l'Eglise reproche au système capitaliste, c'est que, précisément, tous et
chacun des êtres humains vivant sur la planète n'ont pas accès à un minimum de
biens matériels, permettant une vie décente, et que même dans les pays les plus
avancés, il existe des milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim.
C'est le principe de la destination universelle des biens qui n'est pas
atteint: la production existe en abondance, mais c'est la distribution qui est
défectueuse.
Et dans le système actuel, l'instrument qui permet la distribution des
biens et des services, le signe qui permet d'obtenir les produits, c'est
l'argent. C'est donc le système d'argent, le système financier qui fait défaut
dans le capitalisme.
Les maux
du système capitaliste ne proviennent donc pas de sa nature (propriété privée,
libre entreprise), mais du système financier qu'il utilise, un système
financier qui domine au lieu de servir, qui vicie le capitalisme. Le Pape Pie
XI écrivait dans son encyclique Quadragesimo anno, en 1931: «Le
capitalisme n'est pas à condamner en lui-même, ce n'est pas sa constitution qui
est mauvaise, mais il a été vicié.»
Ce que l'Eglise
condamne, ce n'est pas le capitalisme en tant que système producteur, mais,
selon les mots du Pape Paul VI, le «néfaste système qui l'accompagne», le
système financier:
«Ce
libéralisme sans frein conduit à la dictature à bon droit dénoncée par Pie XI
comme génératrice de ‘l'impérialisme de l'argent’. On
ne saurait trop réprouver de tels abus, en rappelant encore une fois
solennellement que l'économie est au service de l'homme. Mais s'il est vrai
qu'un certain capitalisme a été la source de trop de souffrances, d'injustices
et de luttes fratricides aux effets durables, c'est à tort qu'on attribuerait à
l'industrialisation elle-même des maux qui sont dus au néfaste système qui
l'accompagnait. Il faut au contraire en toute justice reconnaître l'apport irremplaçable
de l'organisation du travail et du progrès industriel à l'oeuvre du
développement.» (Encyclique Populorum progressio, sur le
développement des peuples, 26 mars 1967, n. 26.)
Le vice du système: l’argent
est créé par les banques sous forme de dette
C'est le
système financier qui n'accomplit pas son rôle, il a été détourné de sa fin.
(Faire les biens joindre les besoins.) L'argent ne devrait être qu'un
instrument de distribution, un signe qui donne droit aux produits, une simple
comptabilité.
L’argent
devrait être un instrument de service, mais les banquiers, en se réservant le
contrôle de la création de l'argent, en ont fait un instrument de domination:
Puisque le monde ne peut vivre sans argent, tous —gouvernements, compagnies,
individus — doivent se soumettre aux conditions imposées par les banquiers pour
obtenir de l'argent, qui est le droit de vivre dans notre société actuelle.
Cela établit une véritable dictature sur la vie économique: Les banquiers sont
devenus les maîtres de nos vies, tel que le rapportait très justement encore
Pie XI dans Quadragesimo Anno (n. 106).
«Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux
qui, détenteurs et maîtres absolus de l'argent et du crédit, gouvernent le
crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent le sang
à l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien
que, sans leur consentement, nul ne peut plus respirer.»
Aucun
pays ne peut rembourser sa dette dans le système actuel, puisque tout argent
est créé sous forme de dette: tout l'argent qui existe vient en circulation
seulement lorsqu'il est prêté par les banques, à intérêt. Et chaque fois qu'un
prêt est remboursé, cette somme d'argent cesse d'exister, est retirée de la
circulation.
Le
défaut fondamental dans ce système est que lorsque les banques créent de
l'argent nouveau sous forme de prêts, elles demandent aux emprunteurs de
ramener à la banque plus d'argent que ce que la banque a créé. (Les banques
créent le capital qu'elles prêtent, mais pas l'intérêt qu'elles exigent en
retour.) Puisqu'il est impossible de rembourser de l'argent qui n'existe pas,
la seule solution est d'emprunter de nouveau pour pouvoir payer cet intérêt, et
d'accumuler ainsi des dettes impayables.
Cette
création d'argent sous forme de dette par les banquiers est leur moyen
d'imposer leur volonté sur les individus et de contrôler le monde:
«Parmi les actes et les attitudes contraires à la volonté de Dieu et au
bien du prochain et les ‘structures’ qu'ils introduisent, deux éléments paraissent
aujourd'hui les plus caractéristiques: d'une part le désir exclusif du profit
et, d'autre part, la soif du pouvoir dans le but d'imposer aux autres sa propre
volonté.» (Jean-Paul II, encyclique Sollicitudo
rei socialis, n. 37.)
Puisque
l'argent est un instrument essentiellement social, la doctrine du Crédit Social
propose que l'argent soit émis par la société, et non par des banquiers privés
pour leur profit:
«Il y a
certaines catégories de biens pour lesquelles on peut soutenir avec raison
qu'ils doivent être réservés à la collectivité lorsqu'ils en viennent à
conférer une puissance économique telle qu'elle ne peut, sans danger pour le
bien public, être laissée entre les mains de personnes privées.» (Pie XI,
encyclique Quadragesimo anno.)
L’effet de l’intérêt composé
Les
institutions comme le FMI (Fonds Monétaire International) et la Banque Mondiale
prétendent venir en aide aux pays en difficultés financières avec leurs prêts,
mais à cause des intérêts que ces pays doivent payer, ces prêts les appauvrissent
encore davantage. En voici quelques exemples frappants:
En dix
ans, de 1980 à 1990, les pays d'Amérique latine ont payé 418 milliards $
d'intérêt sur un emprunt original de 80 milliards $... et ils doivent encore le
capital, même s'ils l'ont remboursé plus de cinq fois!
Au Canada, la situation est encore pire! 93% de
la dette nationale de 562 milliards de dollars (en 2002) est attribuable aux
intérêts composés: le montant original emprunté (39 milliards $) ne représente
que 7% de la dette. Le reste, 523 milliards $, représente ce qu'il en a coûté
pour emprunter ce 39 milliards$!
Selon la Coalition pour le Jubilé 2000, pour
chaque dollar versé en aide aux pays pauvres, 8 dollars sont remboursés par ces
mêmes pays en intérêts.
Ce sont
des exemples semblables qui ont amené Saint Léon à écrire: «C'est une
avarice injuste et insolente que celle qui se flatte de rendre service au
prochain alors qu'elle le trompe... Celui-là jouira du repos éternel qui entre
autres règles d'une conduite pieuse n`aura pas prêté son argent à usure...
tandis que celui qui s'enrichit au détriment d'autrui, mérite en retour la
peine éternelle.» Saint Jean Chrysostome écrivait aussi: «Rien n'est plus
honteux, ni plus cruel que l'usure.»
Les dettes doivent être
effacées
Toute
personne la moindrement sensée réalisera qu'il est criminel et immoral d'exiger
des pays de continuer à payer des intérêts sur des dettes dont le capital a
déjà été remboursé plusieurs fois par l'intérêt. On peut donc comprendre
pourquoi l'Église condamne si fortement l'usure (le prêt d'argent à intérêt),
et demande l'effacement des dettes. Lorsqu'on comprend que l'argent prêté par
les banques est littéralement créé à partir de rien, d'un simple trait de
plume, alors il est facile de comprendre que les dettes peuvent être effacées
de la même manière, sans que personne ne soit pénalisé.
Le 27
décembre 1986, la Commission Pontificale Justice et Paix publiait
un document intitulé “Une approche éthique de l'endettement international”;
dont voici des extraits :
«Les pays
débiteurs, en effet, se trouvent placés dans une sorte de cercle vicieux: ils
sont condamnés, pour pouvoir rembourser leurs dettes, à transférer à
l'extérieur, dans une mesure toujours plus grande, des ressources qui devraient
être disponibles pour leur consommation et leurs investissements internes, donc
pour leur développement.
«Le
service de la dette ne peut être acquitté au prix d'une asphyxie de l'économie
d'un pays et aucun gouvernement ne peut moralement exiger d'un peuple des
privations incompatibles avec la dignité des personnes... S'inspirant de
l'Evangile, d'autres comportements seraient à envisager, comme consentir des
délais, remettre partiellement ou même totalement les dettes... En certains
cas, les pays créanciers pourront convertir les prêts en dons.
«L'Eglise
rappelle la priorité à accorder aux hommes et à leurs besoins, par-delà les
contraintes et les techniques financières souvent présentées comme seules
impératives.»
Le Pape
Jean-Paul II écrivait dans son encyclique Centesimus annus (n. 35.): «Le
principe que les dettes doivent être payées est assurément juste (Note
de Vers Demain : rembourser le capital est juste, mais pas rembourser un
intérêt en plus.) Il n'est pas licite de demander et d'exiger un
paiement quand cela reviendrait à imposer en fait des choix politiques de
nature à pousser à la faim et au désespoir des populations entières. On ne
saurait prétendre au paiement des dettes contractées si c'est au prix de
sacrifices insupportables. Dans ce cas, il est nécessaire — comme du reste cela
est en train d'être partiellement fait — de trouver des modalités d'allégement
de report ou même d'extinction de la dette, compatibles avec le droit
fondamental des peuples à leur subsistance et à leur progrès.»
En
préparation du Grand Jubilé de l’an 2000, le Pape Jean-Paul II avait mentionné
en plusieurs occasions la nécessité d’effacer toutes les dettes. Voici des
extraits de son audience du mercredi 3 novembre 1999 :
«En ce qui
concerne la possession des biens immobiliers, la règle du jubilé biblique
reposait sur le principe selon lequel la ‘terre appartient à Dieu’ et est donc
donnée au bénéfice de toute la communauté. C'est pourquoi, si un Israélite
avait aliéné son terrain, l'année jubilaire lui permettait d'en retrouver la
possession. ‘La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre
m'appartient et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Pour toute
propriété foncière vous laisserez un droit de rachat sur le fonds’ (Lv 25,
23-24).
«Le jubilé
chrétien se réfère avec une conscience toujours plus grande aux valeurs
sociales du jubilé biblique qu'il désire interpréter et reproposer dans le
contexte contemporain, en réfléchissant sur les exigences du bien commun et sur
la destination universelle des biens de la terre. C'est précisément dans cette
perspective que j'ai proposé dans Tertio millennio adveniente (n. 51)
que le Jubilé soit vécu comme ‘un moment favorable pour penser, entre autres, à
une réduction importante, sinon à un effacement total, de la dette
internationale qui pèse sur le destin de nombreuses nations’.»
Une fois
les dettes effacées, la seule façon d'empêcher les pays de s'endetter de
nouveau est de créer eux-mêmes leur propre argent, sans intérêt et sans dette,
car si vous laissez aux banques le pouvoir de créer l'argent, les dettes
s'accumuleront de nouveau. C'est ce qui faisait dire à Sir Josiah Stamp, alors
qu'il était gouverneur de la Banque d'Angleterre:
«Le
système bancaire fut conçu dans l'iniquité et né dans le péché... Les banquiers
possèdent la planète. Enlevez-leur, mais laissez-leur le pouvoir de créer
l'argent, et d'un trait de plume, ils créeront assez d'argent pour racheter la
planète et en devenir les propriétaires... Si vous voulez continuer d'être les
esclaves des banquiers et de payer le prix de votre propre esclavage, alors
laissez les banquiers continuer de créer l'argent et de contrôler le crédit.»
Pour ceux
qui ne comprennent pas que les banques créent l'argent qu'elles prêtent (et que
lorsqu'elles prêtent, elles ne se départissent absolument de rien), la seule
manière d'«effacer» une dette est de la faire payer par quelqu'un, quelque
part. Mais quand nous, du journal Vers Demain, demandons d'effacer les dettes
publiques, c'est exactement ce que cela veut dire: les effacer, et non pas les
rembourser... et encore moins imprimer de l'argent pour les rembourser!
Ce que nous demandons, c'est
que le gouvernement cesse d'emprunter des banques et qu'il crée lui-même l'argent
pour la nation, sans intérêt et sans dette, tel que prescrit dans la
Constitution du pays. C'est la seule solution qui va à la racine du problème,
et qui le règle une fois pour toute. Cela mettrait finalement l'argent au
service de la personne humaine.
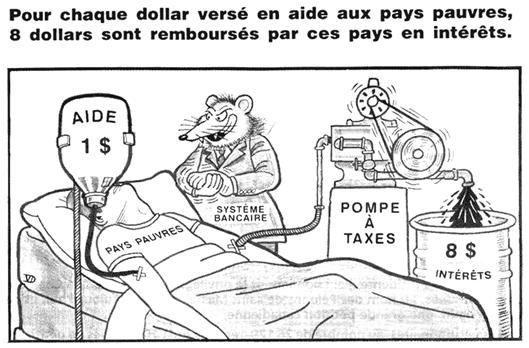
LEÇON 10 — Le Crédit Social et la doctrine sociale de
l’Église
(2e
partie)

Dans la leçon précédente, nous avons développé le premier des quatre
principes de base de la doctrine sociale de l’Eglise, la primauté de la
personne humaine, qui signifie que tous les systèmes existent pour servir la
personne humaine.
Donc, le but des systèmes économique et financier, selon l'Eglise, est
aussi le service de l'homme. Le but du système économique, c'est la
satisfaction des besoins humains. C'est ce que Pie XI rappelle dans son
encyclique Quadragesimo anno (n. 75):
«L'organisme économique et social sera sainement constitué et atteindra
sa fin alors seulement qu'il procurera à tous et à chacun de ses membres tous
les biens que les ressources de la nature et de l'industrie, ainsi que
l'organisation vraiment sociale de la vie économique, ont le moyen de leur
procurer.
«Ces biens doivent être assez abondants pour satisfaire aux besoins
d'une honnête subsistance et pour élever les hommes à ce degré d'aisance et de
culture qui, pourvu qu'on en use sagement, ne met pas d'obstacle à la vertu,
mais en facilite au contraire singulièrement l'exercice.»
Maintenant,
développons les trois autres principes mentionnés dans le Compendium de la
doctrine sociale de l’Eglise: le bien commun, la subsidiarité, la
solidarité.
Le bien commun
164. De la
dignité, de l’unité et de l’égalité de toutes les personnes découle avant tout
le principe du bien commun, auquel tout aspect de la vie sociale doit se
référer pour trouver une plénitude de sens. Selon une première et vaste
acception, par bien commun on entend : «cet ensemble de conditions
sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres,
d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée». (Gaudium
et Spes, 26.)
167. Le bien commun engage tous
les membres de la société: aucun n’est exempté de collaborer, selon ses propres
capacités, à la réalisation et au développement de ce bien… Tous ont aussi
droit de bénéficier des conditions de vie sociale qui résultent de la recherche
du bien commun. L’enseignement de Pie XI demeure très actuel: «Il importe donc
d’attribuer à chacun ce qui lui revient et de ramener aux exigences du bien
commun ou aux normes de la justice sociale la distribution des ressources de ce
monde, dont le flagrant contraste entre une poignée de riches et une multitude
d’indigents atteste de nos jours, aux yeux de l’homme de cœur, les graves
dérèglements». (Encyclique Quadragesimo Anno, 197.)
Les devoirs de la communauté
politique
168. La
responsabilité de poursuivre le bien commun revient non seulement aux
individus, mais aussi à l’Etat, car le bien commun est la raison d’être de
l’autorité politique. (Cf. Catéchisme de l’Eglise Catholique, n. 1910.) A la société civile dont il est
l’expression, l’Etat doit, en effet, garantir la cohésion, l’unité et
l’organisation de sorte que le bien commun puisse être poursuivi avec la
contribution de tous les citoyens. L’individu, la famille, les corps
intermédiaires ne sont pas en mesure de parvenir par eux-mêmes à leur
développement plénier; d’où la nécessité d’institutions politiques dont la
finalité est de rendre accessible aux personnes les biens nécessaires —
matériels, culturels, moraux, spirituels — pour conduire une vie vraiment
humaine. Le but de la vie sociale est le bien commun historiquement réalisable.
170. Le
bien commun de la société n’est pas une fin en soi; il n’a de valeur qu’en
référence à la poursuite des fins dernières et au bien commun universel de la
création tout entière. Dieu est la fin dernière de ses créatures et en aucun
cas on ne peut priver le bien commun de sa dimension transcendante, qui dépasse
mais aussi achève la dimension historique.
La destination universelle
des biens
171. Parmi
les multiples implications du bien commun, le principe de la destination
universelle des biens revêt une importance immédiate : «Dieu a destiné la
terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les hommes et de tous les
peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer
entre les mains de tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité».
(Gaudium et Spes, 69.) Ce principe est basé sur le fait que «la première
origine de tout bien est l’acte de Dieu lui-même qui a créé la terre et
l’homme, et qui a donné la terre à l’homme pour qu’il la maîtrise par son
travail et jouisse de ses fruits (cf. Gn 1,28-29).
Dieu a
donné la terre tout le genre humain pour qu’elle fasse vivre tous ses membres,
sans exclure ni privilégier personne. C’est là l’origine de la destination
universelle des biens de la terre. En raison de sa fécondité même et de ses
possibilités de satisfaire les besoins de l’homme, la terre est le premier don
de Dieu pour la subsistance humaine» (Jean-Paul II, Centesimus Annus,
31.) En effet, la personne ne peut pas se passer des biens matériels qui
répondent à ses besoins primaires et constituent les conditions de base de son
existence; ces biens lui sont absolument indispensables pour se nourrir et
croître, pour communiquer, pour s’associer, et pour pouvoir réaliser les plus
hautes finalités auxquelles elle est appelée. (Cf. Pie XII, Radio Message of
June 1, 1941.)
172. Le
principe de la destination universelle des biens de la terre est à la base du
droit universel à l’usage des biens. Chaque homme doit avoir la possibilité
de jouir du bien-être nécessaire à son plein développement: le principe de
l’usage commun des biens est le «premier principe de tout l’ordre
éthico-social» et «principe caractéristique de la doctrine sociale chrétienne».
(Jean-Paul II, Encyclique Sollicitudo Rei Socialis, 42.)
C’est la
raison pour laquelle l’Eglise a estimé nécessaire d’en préciser la nature et
les caractéristiques. Il s’agit avant tout d’un droit naturel, inscrit dans la
nature de l’homme, et non pas simplement d’un droit positif, lié à la
contingence historique; en outre, ce droit est «originaire». (Pie XII,
Radio-message du 1er juin 1941.) Il est inhérent à l’individu, à
chaque personne, et il est prioritaire par rapport à toute intervention humaine
sur les biens, à tout ordre juridique de ceux-ci, à toute méthode et tout
système économiques et sociaux : «Tous les autres droits, quels qu’ils
soient, y compris ceux de propriété et de libre commerce, y sont subordonnés (à
la destination universelle des biens) : ils n’en doivent donc pas
entraver, mais bien au contraire faciliter la réalisation, et c’est un devoir
social grave et urgent de les ramener à leur finalité première». (Paul VI,
Encyclique Populorum Progressio, 22.)
La propriété privée
176. Par
le travail, l’homme, utilisant son intelligence, parvient à dominer la terre et
à en faire sa digne demeure: «Il s’approprie ainsi une partie de la terre,
celle qu’il s’est acquise par son travail. C’est là l’origine de la propriété
individuelle». (Jean-Paul II, Centesimus Annus, 31.)
La propriété privée et les autres
formes de possession privée des biens «assurent à chacun une zone indispensable
d’autonomie personnelle et familiale; il faut les regarder comme un
prolongement de la liberté humaine. Enfin, en stimulant l’exercice de la responsabilité, ils constituent l’une des
conditions des libertés civiles». (Gaudium et Spes, 71.) La
propriété privée est élément essentiel d’une politique économique
authentiquement sociale et démocratique et la garantie d’un ordre social juste.
La doctrine sociale exige que la propriété des biens soit équitablement
accessible à tous, de sorte que tous en deviennent, au moins dans une certaine
mesure, propriétaires, sans pour autant qu’ils puissent les «posséder
confusément». (Léon XIII, Rerum Novarum, 11.)
L’héritage du
progrès
179. En
mettant à la disposition de la société des biens nouveaux, tout à fait inconnus
jusqu’à une époque récente, la phase historique actuelle impose une relecture
du principe de la destination universelle des biens de la terre, en en rendant
nécessaire une extension qui comprenne aussi les fruits du récent progrès
économique et technologique. La propriété des nouveaux biens, issus de la
connaissance, de la technique et du savoir, devient toujours plus décisive, car
«la richesse des pays industrialisés se fonde bien plus sur ce type de
propriété que sur celui des ressources naturelles».
(Jean-Paul II, Centesimus Annus, 32.)
Les
nouvelles connaissances techniques et scientifiques doivent être mises au
service des besoins primordiaux de l’homme, afin que le patrimoine commun de
l’humanité puisse progressivement s’accroître. La pleine mise en pratique du
principe de la destination universelle des biens requiert par conséquent des
actions au niveau international et des initiatives programmées par tous les
pays : «Il faut rompre les barrières et les monopoles qui maintiennent de
nombreux peuples en marge du développement, assurer à tous les individus et à
toutes les nations les conditions élémentaires qui permettent de participer au
développement». (Jean-Paul II, Centesimus Annus, 35.)
Que tous soient réellement «capitalistes» et aient accès aux biens de la
terre, cela serait rendu possible par le dividende du Crédit Social. Comme il a
été fait mention dans les leçons précédentes, ce dividende est basé sur deux
choses : l’héritage des ressources naturelles, et les inventions des
générations passées. C’est exactement ce que le Pape Jean-Paul II écrivait en
1981 dans son Encyclique Laborem exercens, sur le travail humain (n.
13) :
«L'homme, par son travail, hérite d'un double patrimoine:
il hérite d'une part de ce qui est donné à tous les hommes, sous forme de
ressources naturelles et, d'autre part, de ce que tous les autres ont déjà
élaboré à partir de ces ressources, en réalisant un ensemble d'instruments de
travail toujours plus parfaits. Tout en travaillant, l'homme hérite du travail
d'autrui.»
La pauvreté en face de
l’abondance
Dieu a mis
sur la terre tout ce qu'il faut pour nourrir tout le monde. Mais à cause du
manque d'argent, les produits ne peuvent plus joindre les gens qui ont faim:
des montagnes de produits s'accumulent en face de millions qui meurent de faim.
C'est le paradoxe de la misère en face de l'abondance:
«Quel
cruel paradoxe de vous voir si nombreux ici même en détresse financière, vous
qui pourriez travailler pour nourrir vos semblables, alors qu'au même moment la
faim, la malnutrition chronique et le spectre de la famine touchent des
milliers de gens ailleurs dans le monde.» (Jean-Paul II aux
pêcheurs, St. John's, Terre-Neuve, 12 septembre 1984.)
«Jamais,
plus jamais la faim! Mesdames et messieurs, cet objectif peut être atteint. La
menace de la faim et le poids de la malnutrition ne sont pas une fatalité
inéluctable. La nature n'est pas, en cette crise, infidèle à l'homme. Tandis
que, selon l'opinion généralement acceptée, 50% des terres cultivables ne sont
pas encore mises en valeur, le fait s'impose du scandale d'énormes excédents
alimentaires que certains pays détruisent périodiquement faute d'une sage
économie qui en aurait assuré une consommation utile.
«Nous
touchons ici au paradoxe de la situation présente: L'humanité dispose d'une
maîtrise inégalée de l'univers; elle dispose des instruments capables de faire
rendre à plein les ressources de celui-ci. Les détenteurs mêmes de ces
instruments resteront-ils comme frappés de paralysie devant l'absurde d'une
situation où la richesse de quelques-uns tolérerait la persistance de la misère
d'un grand nombre?... on ne saurait en arriver là sans avoir commis de graves
erreurs d'orientation, ne serait-ce parfois que par négligence ou omission; il
est grand temps de découvrir en quoi les mécanismes sont faussés, afin de
rectifier, ou plutôt de redresser de bout en bout la situation.» (Paul VI
à la Conférence Mondiale de l'Alimentation, Rome, 9 novembre 1974.)
«De toute
évidence, il y a un défaut capital, ou plutôt un ensemble de défauts et même un
mécanisme défectueux à la base de l'économie contemporaine et de la
civilisation matérialiste, qui ne permettent pas à la famille humaine de se
sortir, dirais-je, de situations aussi radicalement injustes.»
(Jean-Paul II, encyclique Dives in Misericordia, 30 novembre 1980, n.
11.)
La misère
en face de l'abondance... «représente en quelque
sorte un gigantesque développement de la parabole biblique du riche qui festoie
et du pauvre Lazare. L'ampleur du phénomène met en cause les structures et les
mécanismes financiers, monétaires, productifs et commerciaux qui, appuyés sur
des pressions politiques diverses, régissent l'économie mondiale; ils s'avèrent
incapables de résorber les injustices héritées du passé et de faire face aux
défis urgents et aux exigences éthiques du présent... Nous sommes ici en face
d'un drame dont l'ampleur ne peut laisser personne indifférent.» (Jean-Paul
II, Redemptor hominis, n. 15.)
Réforme du système financier
Les Papes
dénoncent la dictature de l'argent rare et demandent une réforme des systèmes
financiers et économiques, l'établissement d'un système économique au service
de l'homme:
«Il est
nécessaire de dénoncer l'existence de mécanismes économiques, financiers et
sociaux qui, bien que menés par la volonté des hommes, fonctionnent souvent
d'une manière quasi automatique, rendant plus rigides les situations de
richesse des uns et de pauvreté des autres.» (Jean-Paul II, encyclique
Sollicitudo rei socialis, n. 16.)
«Je fais
appel à tous les chargés de pouvoir afin qu'ensemble ils s'efforcent de trouver
les solutions aux problèmes de l'heure, ce qui suppose une restructuration de
l'économie de manière à ce que les besoins humains l'emportent toujours sur le
gain financier.» (Jean-Paul II aux pêcheurs de St. John's,
Terre-Neuve, 12 septembre 1984.)
«Une
condition essentielle est de donner à l'économie un sens humain et une logique
humaine. Ce que j'ai dit au sujet du travail est également valable ici. Il
importe de libérer les divers champs de l'existence de la domination d'une
économie écrasante. Il faut mettre les exigences économiques à la place qui
leur revient et créer un tissu social multiforme qui empêche la
massification... Chrétiens, en quelque lieu que vous soyez, assumez votre part
de responsabilité dans cet immense effort pour la reconstruction humaine de la
cité. La foi vous en fait un devoir.» (Jean-Paul II, discours aux
ouvriers de Sao Paulo, 3 juillet 1980.)
Le principe de subsidiarité
Cela nous
amène à l'un des principes les plus intéressants de la doctrine sociale de
l'Eglise, celui de la subsidiarité: les niveaux supérieurs de gouvernements ne
doivent pas faire ce que les niveaux inférieurs, plus près de l'individu,
peuvent faire. C'est le contraire de la centralisation – et de son application
la plus extrême, un gouvernement mondial, où tous les gouvernements nationaux
sont abolis. Ce principe de subsidiarité signifie aussi que les gouvernements
existent pour aider les parents, non pas pour prendre leur place. On peut lire
dans le Compendium de la doctrine
sociale de l’Eglise :
185.
Présente dès la première grande encyclique sociale, la subsidiarité figure
parmi les directives les plus constantes et les plus caractéristiques de la doctrine
sociale de l’Eglise. (Cf. Léon XIII, Encyclique Rerum Novarum, 11.) Il
est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n’est en prenant
soin de la famille, des groupes, des associations, des réalités territoriales
locales, bref de toutes les expressions associatives de type économique,
social, culturel, sportif, récréatif, professionnel, politique, auxquelles les
personnes donnent spontanément vie et qui rendent possible leur croissance
sociale effective.
Tel est le
cadre de la société civile, conçue comme l’ensemble des rapports entre
individus et entre sociétés intermédiaires, les premiers à être instaurés et
qui se réalisent grâce à «la personnalité créative du citoyen». Le réseau de
ces rapports irrigue le tissu social et constitue la base d’une véritable
communauté de personnes, en rendant possible la reconnaissance de formes plus
élevées de socialité.
186.
L’exigence de protéger et de promouvoir les expressions originelles de la
socialité est soulignée par l’Eglise dans l’encyclique Quadragesimo anno
(n. 203) dans laquelle le principe de subsidiarité est indiqué comme un
principe très important de la «philosophie sociale» : «De même qu'on ne
peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les
attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et
par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, en même
temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social, que de
retirer aux groupements d'ordre inférieur, pour les confier à une collectivité
plus vaste et d'un rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure de
remplir eux-mêmes. L'objet naturel de toute intervention en matière sociale est
d'aider les membres du corps social, et non pas de les détruire ni de les
absorber».
Sur la
base de ce principe, toutes les sociétés d’ordre supérieur doivent se mettre en
attitude d’aide («subsidium») — donc de soutien, de promotion, de développement
— par rapport aux sociétés d’ordre mineur. De la sorte, les corps sociaux
intermédiaires peuvent remplir de manière appropriée les fonctions qui leur
reviennent, sans devoir les céder injustement à d’autres groupes sociaux de
niveau supérieur, lesquels finiraient par les absorber et les remplacer et, à
la fin, leur nieraient leur dignité et leur espace vital.
A la
subsidiarité comprise dans un sens positif, comme aide économique,
institutionnelle, législative offerte aux entités sociales plus petites,
correspond une série d’implications dans un sens négatif, qui imposent à l’Etat
de s’abstenir de tout ce qui restreindrait, de fait, l’espace vital des
cellules mineures et essentielles de la société. Leur initiative, leur liberté
et leur responsabilité ne doivent pas être supplantées.
187. Le principe de
subsidiarité protège les personnes des abus des instances supérieures et incite
ces dernières à aider les individus et les corps intermédiaires à développer
leurs fonctions. Ce principe s’impose parce que toute personne, toute famille
et tout corps intermédiaire ont quelque chose d’original à offrir à la
communauté. L’expérience atteste que la négation de la subsidiarité ou sa
limitation au nom d’une prétendue démocratisation ou égalité de tous dans la
société, limite et parfois même annule l’esprit de liberté et d’initiative.
Certaines formes de concentration, de bureaucratisation, d’assistance, de
présence injustifiée et excessive de l’Etat et de l’appareil public contrastent
avec le principe de subsidiarité.
L’État-Providence
Comme
l'explique M. Louis Even, «pour accomplir ses fonctions propres, César ne
doit pas recourir à des moyens qui empêchent les personnes, les familles
d'accomplir les leurs ... Parce qu'il n'accomplit pas ce redressement, que lui
seul peut accomplir (casser le monopole de la création de l'argent par les banques
privées et créer lui-même, pour la nation, son propre argent sans dette), César
sort de son rôle, accumule des fonctions, s'en autorise, pour imposer des
charges lourdes, parfois ruineuses, aux citoyens et aux familles. Il devient
ainsi l'instrument d'une dictature financière qu'il devrait abattre.»
Ces
fonctions que l'Etat accumule, au lieu de corriger le système financier, créent
une bureaucratie monstrueuse, avec une armée de fonctionnaires qui embête plus les
citoyens qu'elle ne les sert. Dans son encyclique Centesimus annus (n.
48), le Pape Jean-Paul II dénonce ces excès de l'«Etat-Providence»:
«On a
assisté, récemment, à un important élargissement du cadre de ces interventions
(de l'Etat), ce qui a amené à constituer, en quelque sorte, un Etat de type
nouveau, l'«Etat du bien-être» (ou Etat-Providence)... Cependant, au cours de
ces dernières années en particulier, des excès ou des abus assez nombreux ont
provoqué des critiques sévères de l'Etat du bien-être... (qui)
provoque la déperdition des forces humaines, l'hypertrophie des appareils
publics, animés par une logique bureaucratique plus que par la préoccupation
d'être au service des usagers, avec une croissance énorme des dépenses.» La
solution, indique le Saint-Père, est de respecter le principe de subsidiarité,
ne pas interférer dans les compétences des familles et des niveaux de
gouvernement inférieurs, car «les besoins sont mieux connus par ceux qui en
sont plus proches».
La plupart
des taxes aujourd'hui sont injustes et inutiles, et pourraient être éliminées
dans un système de Crédit Social. La partie la plus injuste de ces taxes, et
qui n'a aucune raison d'être, est celle qui sert à payer le «service de la
dette» – les intérêts que le pays doit payer chaque année sur sa dette
nationale, pour avoir emprunté à intérêt de l'argent que l'Etat aurait pu créer
lui-même, sans intérêt.
Le Compendium
de la doctrine sociale de l’Eglise continue (n. 187):
A l’application
du principe de subsidiarité correspondent: le respect et la promotion effective
de la primauté de la personne et de la famille; la mise en valeur des
associations et des organismes intermédiaires, dans leurs choix fondamentaux et
dans tous ceux qui ne peuvent pas être délégués ou assumés par d’autres;
l’encouragement offert à l’initiative privée, de sorte que tout organisme
social, avec ses spécificités, demeure au service du bien commun;
l’articulation pluraliste de la société et la représentation de ses forces
vitales; la sauvegarde des droits de l’homme et des minorités; la
décentralisation bureaucratique et administrative; l’équilibre entre la sphère
publique et la sphère privée, avec la reconnaissance correspondante de la
fonction sociale du privé; et une responsabilisation appropriée du citoyen dans
son rôle en tant que partie active de la réalité politique et sociale du pays.
188.
Diverses circonstances peuvent porter l’Etat à exercer une fonction de
suppléance. Que l’on pense, par exemple, aux situations où il est nécessaire
que l’Etat stimule l’économie, à cause de l’impossibilité pour la société
civile d’assumer cette initiative de façon autonome; que l’on pense aussi aux
réalités de grave déséquilibre et d’injustice sociale où seule l’intervention
publique peut créer des conditions de plus grande égalité, de justice et de
paix.
Comme nous
l’avons vu dans les leçons précédentes, corriger le système financier est
certainement l’un des devoirs de l’Etat, c’est-à-dire, que l'argent doit être
émis par la société, et non par des banquiers privés pour leur profit, tel que
l’écrit Pie XI dans son encyclique Quadragesimo anno:
«Il y a certaines catégories de
biens pour lesquelles on peut soutenir avec raison qu'ils doivent être réservés
à la collectivité lorsqu'ils en viennent à conférer une puissance économique
telle qu'elle ne peut, sans danger pour le bien public, être laissée entre les
mains de personnes privées.»
La famille, première société
Le
principe de subsidiarité implique aussi que les parents ont préséance sur
l'Etat, et que les gouvernements ne doivent pas détruire les familles ni
l'autorité des parents. Comme l'Eglise l'enseigne, les enfants appartiennent
aux parents, et non à l'Etat:
«Aussi
bien que la société civile, la famille est une société proprement dite, avec
son autorité et son gouvernement propre, l'autorité et le gouvernement
paternel... La société domestique a sur la société civile une priorité logique
et une priorité réelle... Vouloir donc que le pouvoir civil envahisse
arbitrairement jusqu'au sanctuaire de la famille, c'est une erreur grave et
funeste... L'autorité paternelle ne saurait être abolie, ni absorbée par
l'Etat... Ainsi, en substituant à la providence paternelle la providence de
l'Etat, les socialistes vont contre la justice naturelle et brisent les liens
de la famille.» (Léon XIII, encyclique Rerum novarum, n.
12-14)
Un salaire pour la mère au
foyer
Le
dividende du Crédit Social permettrait aussi de reconnaître l'importance du
travail de la femme au foyer en lui versant un revenu, ce qui d'ailleurs l'un
des points de la doctrine sociale de l'Eglise:
«L'expérience
confirme qu'il est nécessaire de s'employer en faveur de la revalorisation
sociale des fonctions maternelles, du labeur qui y est lié, et du besoin que
les enfants ont de soins, d'amour et d'affection pour être capables de devenir
des personnes responsables, moralement et religieusement adultes,
psychologiquement équilibrés. Ce sera l'honneur de la société d'assurer à la
mère – sans faire obstacle à sa liberté, sans discrimination psychologique ou
pratique, sans qu'elle soit pénalisée par rapport aux autres femmes – la
possibilité d'élever ses enfants et de se consacrer à leur éducation selon les
différents besoins de leur âge. Qu'elle soit contrainte à abandonner ces tâches
pour prendre un emploi rétribué hors de chez elle n'est pas juste du point de vue du
bien de la société et de la famille si cela contredit ou rend difficiles les
buts premiers de la mission maternelle.» (Jean-Paul II, encyclique Laborem
exercens, 15 septembre 1981, n. 19)
«C'est par
un abus néfaste, qu'il faut à tout prix faire disparaître, que les mères de
famille, à cause de la modicité du salaire paternel, sont contraintes de
chercher hors de la maison une occupation rémunératrice, négligeant les devoirs
tout particuliers qui leur incombent, — avant tout, l'éducation des enfants.» (Pie XI, Quadragesimo
anno, n. 71)
En octobre
1983, le Saint-Siège publiait la «Charte des droits de la famille», dans
laquelle il demandait «la rémunération du travail d'un des parents au foyer;
elle doit être telle que la mère de famille ne soit pas obligée de travailler
hors du foyer, au détriment de la vie familiale, en particulier de l'éducation
des enfants.» (Art. 10)
Le principe de solidarité
La solidarité est un autre mot pour désigner l’amour
du prochain. Comme chrétiens, nous devons nous soucier du sort de tous nos
frères et soeurs dans le Christ, car c’est sur cet amour du prochain que l’on
sera jugés à la fin de notre vie sur cette terre:
«C’est à ce qu’ils auront fait pour les pauvres que
Jésus-Christ reconnaîtra ses élus… Entre-temps, les pauvres nous sont confiés
et c’est sur cette responsabilité que nous serons jugés à la fin (cf. Mt 25, 31-46): ‘Notre-Seigneur nous
avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les
besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères’». (Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, n.
183)
Le Compendium continue:
192.
La solidarité confère un relief
particulier à la socialité intrinsèque de la personne humaine, à l’égalité de
tous en dignité et en droits, au cheminement commun des hommes et des peuples
vers une unité toujours plus convaincue. Jamais autant qu’aujourd’hui il n,a existé une conscience aussi diffuse du lien d’interdépendance
entre les hommes et les peuples, qui se manifeste à tous les niveaux. La
multiplication très rapide des voies et des moyens de communication «en temps
réel», comme le sont les voies et les moyens télématiques, les extraordinaires
progrès de l’informatique, le volume croissant des échanges commerciaux et des
informations, témoignent de ce que, pour la première fois depuis le début de
l’histoire de l’humanité, il est désormais possible, au moins techniquement,
d’établir des relations entre personnes très éloignées ou inconnues.
Par ailleurs, face au
phénomène de l’interdépendance et de son expansion constante, de très fortes
disparités persistent dans le monde entier entre pays développés et pays en
voie de développement, lesquelles sont alimentées aussi par différentes formes
d’exploitation, d’oppression et de corruption qui influent de manière négative
sur la vie interne et internationale de nombreux Etats. Le processus
d’accélération de l’interdépendance entre les personnes et les peuples doit être
accompagné d’un engagement sur le plan éthico-social tout aussi intensifié,
pour éviter les conséquences néfastes d’une situation d’injustice de dimensions
planétaires, destinée à se répercuter très négativement aussi dans les pays
actuellement les plus favorisés.
Le devoir de tout chrétien
C'est en
effet un devoir et une obligation pour tout chrétien de travailler à
l'établissement de la justice et d'un meilleur système économique:
«Celui qui
voudrait renoncer à la tâche, difficile mais exaltante, d'améliorer le sort de
tout l'homme et de tous les hommes, sous prétexte du poids trop lourd de la
lutte et de l'effort incessant pour se dépasser, ou même parce qu'on a
expérimenté l'échec et le retour au point de départ, celui-là ne répondrait pas
à la volonté de Dieu créateur.» (Jean-Paul II, Sollicitudo rei
socialis, n. 30.)
«La tâche
n'est pas impossible. Le principe de solidarité, au sens large, doit inspirer
la recherche efficace d'institutions et de mécanismes appropriés: il s'agit
aussi bien de l'ordre des échanges, où il faut se laisser guider par les lois
d'une saine compétition, que de l'ordre d'une plus ample et plus immédiate
redistribution des richesses.» (Jean-Paul II, Redemptor
hominis, n. 16.)
Il existe bien sûr plusieurs
façons de venir en aide à nos frères dans le besoin: donner à manger à ceux qui
ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, loger les sans-abri, visiter les
malades et les prisonniers, etc. Certains enverront des dons à des organismes
de charité, que ce soit pour aider des pauvres d'ici ou du Tiers-Monde. Mais si
ces dons peuvent soulager quelques pauvres pendant quelques jours ou quelques
semaines, cela ne supprime pas pour autant les causes de la pauvreté.
Ce qui est infiniment mieux,
c'est de corriger le problème à sa source, de s'attaquer aux causes mêmes de la
pauvreté, et de rétablir chaque être humain dans ses droits et sa dignité de
personne créée à l'image de Dieu, ayant droit au moins au nécessaire pour
vivre:
«Plus que quiconque, celui
qui est animé d'une vraie charité est ingénieux à découvrir les causes de la
misère, à trouver les moyens de la combattre, à la vaincre résolument. Faiseur
de paix, il poursuivra son chemin, allumant la joie et versant la lumière et la
grâce au coeur des hommes sur toute la surface de la terre, leur faisant
découvrir, par-delà toutes les frontières, des visages de frères, des visages
d'amis.» (Paul VI, encyclique Populorum
progressio, 75.)
Ce qu’il
faut, ce sont des apôtres pour éduquer la population sur la doctrine sociale de
l’Eglise et sur des moyens, des solutions concrètes pour l’appliquer (comme les
propositions financières du Crédit Social). Le Pape Paul VI écrivait, toujours
dans Populorum Progressio (n. 86):
«Vous tous
qui avez entendu l'appel des peuples souffrants, vous tous qui travaillez à y
répondre, vous êtes les apôtres du bon et vrai développement qui n'est pas la
richesse égoïste et aimée pour elle-même, mais l'économie au service de
l'homme, le pain quotidien distribué à tous, comme source de fraternité et signe
de la Providence.»
Et dans
son encyclique Sollicitudo Rei Socialis,
le Pape Jean-Paul II écrivait (n. 38.):
«Ces
attitudes et ces “structures de péché” (la soif d’argent et de
pouvoir) ne peuvent être vaincues — bien entendu avec l'aide de la
grâce divine — que par une attitude diamétralement opposée: se dépenser pour le
bien du prochain.»
Principes et application
Certains
diront que les Papes n'ont jamais approuvé publiquement le Crédit Social. En
fait, les Papes n'approuveront jamais publiquement aucun système économique,
telle n'est pas leur mission: ils ne donnent pas de solutions techniques, ils
ne font qu'établir les principes sur lesquels doit être basé tout système
économique véritablement au service de la personne humaine, et ils laissent aux
fidèles le soin d'appliquer le système qui appliquerait le mieux ces principes.
Or, à
notre connaissance, aucune autre solution n'appliquerait aussi parfaitement la
doctrine sociale de l'Eglise que le Crédit Social. C'est pourquoi Louis Even,
grand catholique qui ne manquait pas de logique, ne se gênait pas pour faire
ressortir les liens entre le Crédit Social et la doctrine sociale de l'Eglise.
Un autre
qui était convaincu que le Crédit Social est le christianisme appliqué, qu'il
appliquerait à merveille l'enseignement de l'Eglise sur la justice sociale,
c'est le Père Peter Coffey, docteur en philosophie et professeur au Collège de
Maynooth, en Irlande. Voici ce qu'il écrivait à un jésuite canadien, le Père
Richard, en mars 1932:
«Les difficultés posées par vos questions ne peuvent être résolues que
par la réforme du système financier du capitalisme, selon les lignes suggérées
par le Major Douglas et l'école créditiste du crédit. C'est le système
financier actuel qui est à la racine des maux du capitalisme. L'exactitude de
l'analyse faite par Douglas n'a jamais été réfutée, et la réforme qu'il
propose, avec sa fameuse formule d'ajustement des prix, est la seule réforme
qui aille jusqu'à la racine du mal...».
Étude du Crédit Social par
neuf théologiens
Aussitôt
que l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas publia ses premiers écrits sur
le Crédit Social, les Financiers firent tout en leur pouvoir pour faire taire
la voix de Douglas, ou déformer sa doctrine, car ils savaient que l'application
des principes du Crédit Social mettrait fin à leur contrôle de la création de
l'argent. Lorsque Louis Even commença à répandre les principes du Crédit Social
au Canada français en 1935, une des accusations colportées par les Financiers était que le Crédit Social était du socialisme, ou du
communisme.
Alors en
1939, les évêques catholiques du Québec chargèrent une commission de neuf
théologiens d'étudier le Crédit Social en regard de la doctrine sociale de
l'Eglise, pour savoir s'il était entaché de socialisme. Les neuf théologiens
conclurent qu'il n'y avait rien dans la doctrine du Crédit Social qui était
contraire à l'enseignement de l'Eglise, et que tout catholique était donc libre
d'y adhérer sans danger.
Voici des
extraits de cette étude de neuf théologiens du système monétaire du Crédit
Social:
1. . La Commission détermine tout d'abord le champ de l'étude
qu'il s'agit de faire.
a) Il ne
s'agit aucunement de l'aspect économique ou politique, i.e., de la valeur de la
théorie au point de vue économique et de l'application pratique du système du
Crédit Social à un pays. Les membres de la Commission ne se reconnaissent
aucune compétence en ces matières, et d'ailleurs l'Eglise n'a pas à se
prononcer sur des questions pour lesquelles, comme le dit le Pape Pie XI, «elle
est dépourvue des moyens appropriés et de compétence» (Quadragesimo anno).
b) Il ne
s'agit pas non plus d'approuver cette doctrine au nom de l'Eglise, car l'Eglise
n'a «jamais, sur le terrain social et économique, présenté de système technique
déterminé, ce qui d'ailleurs ne lui appartient pas» (Divini Redemptoris,
n. 34).
c) La
seule question à l'étude est la suivante: la doctrine du Crédit Social, dans
ses principes essentiels, est-elle entachée de socialisme ou de communisme,
doctrines condamnées par l'Eglise; et par suite doit-elle être regardée par les
catholiques comme une doctrine qu'il n'est pas permis d'admettre et encore
moins de propager.
2. La
Commission définit le socialisme et note ce qui caractérise cette doctrine à la
lumière de Quadragesimo anno: le matérialisme; la lutte des classes; la
suppression de la propriété privée; le contrôle de la vie économique par l'Etat
au mépris de la liberté et de l'initiative individuelle.
3. La
Commission a ensuite formulé en propositions les principes essentiels du Crédit
Social.
«Le but de
la doctrine monétaire du Crédit Social est de donner à tous et à chacun des
membres de la société la liberté et la sécurité économiques que doit leur
procurer l'organisme économique et social. Pour cela, au lieu d'abaisser la
production vers le niveau du pouvoir d'achat par la destruction des biens
utiles ou la restriction du travail, le Crédit Social veut hausser le pouvoir
d'achat au niveau de la capacité de production des biens utiles.»
Il propose
à cette fin:
I. L'Etat
doit reprendre le contrôle de l'émission et du volume de la monnaie et du
crédit. Il l'exercera par une commission indépendante jouissant de toute
l'autorité voulue pour atteindre son but.
II. Les
ressources matérielles de la nation représentées par la production constituent
la base de la monnaie et du crédit.
III. En
tout temps l'émission de la monnaie et du crédit devrait se mesurer sur le
mouvement de la production de façon qu'un sain équilibre se maintienne
constamment entre celle-ci et la consommation. Cet équilibre est assuré,
partiellement du moins, par le moyen d'un escompte dont le taux varierait
nécessairement avec les fluctuations mêmes de la production.
IV. Le
système économique actuel, grâce aux nombreuses découvertes et inventions qui
le favorisent, produit une abondance insoupçonnée de biens en même temps qu'il
réduit la main-d'oeuvre et engendre un chômage permanent. Une partie importante
de la population se trouve ainsi privée de tout pouvoir d'achat des biens créés
pour elle et non pas pour quelques individus ou groupes particuliers seulement.
Pour que tous puissent avoir une part de l'héritage culturel légué par leurs
prédécesseurs, le Crédit Social propose un dividende dont la quantité sera
déterminée par la masse des biens à consommer. Ce dividende sera versé à chaque
citoyen, à titre de citoyen, qu'il ait ou non d'autres sources de revenus.
4. Il
s'agit maintenant de voir s'il y a des traces de socialisme dans ces
propositions.
Ad Iam: Cette
proposition ne paraît pas comporter de donnée socialiste ni partant être
contraire à la doctrine sociale de l'Eglise. L'affirmation est basée sur les
passages suivants de l'Encyclique Quadragesimo anno.
Le Pape
dit: «Il y a certaines catégories de biens pour lesquels on put soutenir avec
raison qu'ils doivent être réservés à la collectivité lorsqu'ils en viennent à
conférer une puissance économique telle qu'elle ne peut, sans danger pour le
bien public, être laissée entre les mains des personnes privées.»
On y lit
encore: «Ce qui à notre époque frappe tout d'abord le regard, ce n'est pas
seulement la concentration des richesses, mais encore l'accumulation d'une
énorme puissance, d'un pouvoir économique discrétionnaire, aux mains d'un petit
nombre d'hommes, qui d'ordinaire ne sont pas les propriétaires mais les simples
dépositaires et garants du capital qu'ils administrent à leur gré.»
«Ce
pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres absolus
de l'argent, gouvernent le crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. Par
là, ils distribuent le sang à l'organisme économique dont ils tiennent la vie
entre leurs mains, si bien que, sans leur consentement nul ne peut plus
respirer.»
Vouloir
changer un tel état de choses n'est donc pas contraire à la doctrine sociale de
l'Eglise. Il est vrai qu'en confiant à l'Etat le contrôle de la monnaie et du
crédit, on lui donne une influence considérable sur la vie économique de la
nation, une influence équivalente à celle qu'exercent les banques actuellement
à leur seul profit; mais cette manière de faire, in se, ne comporte pas de
socialisme.
La monnaie
n'étant, dans le système du Crédit Social, qu'un instrument d'échange dont le
cours sera rigoureusement réglé par la statistique de la production, la
propriété privée demeure intacte; voire la monnaie et le crédit seraient
peut-être moins qu'aujourd'hui dispensés selon le bon plaisir de ceux qui les
contrôlent. Réserver à la collectivité la monnaie et le crédit n'est donc pas
opposé à la doctrine sociale de l'Eglise.
Saint
Thomas le dit implicitement, dans Ethica, livre 5, leçon 4, quand il
affirme qu'il appartient à la justice distributive, laquelle, on le sait,
relève principalement de l'Etat, de distribuer les biens communs, y compris la
monnaie, à tous ceux qui sont parties de la communauté civile.
En fait,
la monnaie et le crédit ont été, dans le passé, sous le contrôle de l'Etat, en
un grand nombre de pays, notamment dans les Etats pontificaux; ils le sont
encore dans la Cité Vaticane. Il serait bien difficile de voir dans cette
proposition, par conséquent, un principe socialiste.
Ad IIam: Que la
monnaie et le crédit soient basés sur la production, sur les ressources
matérielles nationales, cela ne comporte, semble-t-il, aucun caractère
socialiste. La base de la monnaie est une affaire purement conventionnelle et
technique.
Dans la
discussion présente, ce point est accepté en principe par plusieurs des
opposants.
Ad IIIam: Le
principe de l'équilibre à maintenir entre la production et la consommation est
sain. Dans une économie vraiment humaine et ordonnée, en effet le but de la
production est la consommation et cette dernière doit normalement épuiser la
première, du moins lorsque la production est faite, comme elle doit l'être,
pour répondre à des besoins vraiment humains.
Quant à
l'escompte, dont le principe est admis et même pratiqué couramment dans
l'industrie et le commerce, il n'est qu'un moyen de réaliser cet équilibre; il
permet au consommateur de se procurer la marchandise dont il a besoin à un prix
inférieur sans perte pour le producteur.
Il est à
noter que la Commission ne se prononce pas sur la nécessité d'un escompte
occasionné par l'écart, s'il y a, selon le système du Crédit Social, entre la
production et la consommation. Mais si un tel écart existe, vouloir le combler
par le moyen d'un escompte ne saurait être considéré comme une mesure entachée
de socialisme.
Ad IVam: Le
principe du dividende peut aussi se concilier avec la doctrine sociale de
l'Eglise; il est d'ailleurs comparable au pouvoir d'octroyer que possède
l'Etat. La Commission ne voit pas pourquoi il serait nécessaire pour l'Etat de
posséder les biens de production pour pouvoir payer ce dividende; actuellement,
quoique dans un sens contraire, le pouvoir de taxer, que l'Etat possède en vue
du bien commun, comporte davantage cette note et pourtant est admis. La même
affirmation vaut pour l'escompte: l'un et l'autre tiennent du principe de la
ristourne dans le système coopératif. D'ailleurs la coopération est en honneur
dans le Crédit Social.
Le seul contrôle
de la production qui soit nécessaire pour l'établissement du Crédit Social,
c'est celui de la statistique qui détermine l'émission de la monnaie et du
crédit. Or la statistique ne saurait être considérée comme un véritable
contrôle et comme une entrave à la liberté individuelle; elle n'est qu'une
méthode de connaissance. La Commission ne peut admettre que le contrôle
statistique nécessite la socialisation de la production, ou qu'elle soit «de
l'essence du socialisme et du communisme».
La
Commission répond donc négativement à la question: «Le Crédit Social est-il
entaché de socialisme?» Elle ne voit pas comment on pourrait condamner au nom
de l'Eglise et de sa doctrine sociale les principes essentiels de ce système,
tels qu'exposés précédemment.
Ce rapport des théologiens n'avait
pas fait l'affaire des financiers, et en 1950, un groupe d'hommes d'affaires
chargèrent un évêque du Québec (dont nous tairons le nom par respect pour sa
mémoire) d'aller à Rome pour obtenir du Pape Pie XII une condamnation du Crédit
Social. De retour au Québec, cet évêque fit rapport aux hommes d'affaires: «Pour
avoir une condamnation du Crédit Social, ce n'est pas à Rome qu'il faut aller.
Pie XII m'a répondu: “Le Crédit Social créerait dans le monde un climat qui
permettrait l'épanouissement de la famille et du christianisme.”»
Ça prend l’aide du Ciel
Dans ce
combat pour l’établissement d’un système financier juste fondé sur des
principes chrétiens, l'aide divine est surtout nécessaire quand on sait que le
but réel des financiers, c'est l'établissement d'un gouvernement mondial qui
comprend la destruction du christianisme et de la famille, et que les
promoteurs de ce «nouvel ordre mondial» sont en fait menés par Satan lui-même,
dont le seul objectif est la perte des âmes. Déjà C.H. Douglas écrivait ce qui
suit en 1946, dans la revue The Social Crediter de Liverpool:
«Nous
sommes engagés dans une bataille pour le christianisme. Et il est surprenant de
voir de combien de façons cela est vrai en pratique. Une de ces façons passe
presque inaperçue, sauf dans ses dérivations — l'emphase placée par l'Eglise
catholique romaine sur la famille, et l'effort implacable et constant des
communistes et des socialistes — qui, avec les Financiers internationaux,
forment le véritable corps de l'Antichrist — pour détruire l'idée même de la
famille et lui substituer l'Etat.»
Et Louis
Even écrivait sur le même sujet, en 1973:
«Patriotes,
les Pèlerins de saint Michel, oui, et ils désirent aussi ardemment que
quiconque un régime d'ordre et de justice, de paix, de pain et de joie pour
toutes les familles de leur pays. Mais, catholiques aussi, ils savent très bien
que l'ordre, le paix et la joie sont incompatibles avec le rejet de Dieu, la
violation de ses commandements, le reniement de la foi, la paganisation de la
vie, le scandale d'enfants dans des écoles où les parents sont par loi
contraints de les envoyer.
«Les
Pèlerins de saint Michel, comptant sur l'aide des puissances célestes, ont juré
de mettre en oeuvre toutes les forces physiques et morales, tous les
instruments de propagande et d'éducation dont ils disposent, pour remplacer le
royaume de Satan par le royaume de l'immaculée et de Jésus-Christ.
«Dans un
engagement contre la dictature financière, on n'a pas seulement affaire à des
puissances terrestres. Tout comme la dictature communiste, tout comme la
puissante organisation de la franc-maçonnerie, la dictature financière est sous
les ordres de Satan. Les simples armes humaines n'en viendront pas à bout. Il y
faut les armes choisies et recommandées par Celle qui vainc toutes les
hérésies, par Celle qui doit écraser définitivement la tête de Satan, par Celle
qui a déclaré Elle-même à Fatima que son Coeur Immaculé triomphera finalement.
Et ces armes, ce sont la consécration à son Coeur Immaculé marquée par le port
de son Scapulaire, le Rosaire et la pénitence.
«Les
Pèlerins de saint Michel sont persuadés qu'en embrassant le programme de Marie,
chaque acte qu'ils posent, chaque Ave qu'ils adressent à la Reine du monde,
chaque sacrifice qu'ils offrent, contribuent non seulement à leur
sanctification personnelle, mais aussi à l'avènement d'un ordre social plus
sain, plus humain, plus chrétien, comme le Crédit Social. Dans un tel programme
reçu de Marie, tout compte et rien n'est perdu.»
En résumé,
le combat de Vers Demain est le combat pour le salut des âmes, il ne fait que
répéter ce que le Pape et l'Eglise demandent: une nouvelle évangélisation —
rappeler les principes chrétiens de base à des chrétiens qui les ont
malheureusement oubliés ou qui ont cessé de les mettre en pratique — et une
restructuration des systèmes économiques. Etre un Pèlerin de saint Michel dans
l'Oeuvre de «Vers Demain» est donc l’une des vocations les plus urgentes et
nécessaires de l'heure. Qui, parmi ceux qui lisent ou entendent ces paroles,
auront la grâce de répondre à cet appel, à cette vocation? Qu'elle est donc
grande et importante, l'Oeuvre de Louis Even! Que tous ceux qui ont soif de
justice se mettent donc à étudier et à répandre le Crédit Social, en prenant de
l'abonnement à Vers Demain!
 Annexe — Le dernier écrit de Jacques Maritain
Annexe — Le dernier écrit de Jacques Maritain
Jacques
Maritain, que Louis Even a cité quelquefois dans ses articles, est un
philosophe français, décédé en 1973 à l'âge de 91 ans, qui se spécialisa dans l'étude
de la pensée de saint Thomas d'Aquin et son application dans la vie sociale.
Auteur de plusieurs ouvrages, il était hautement considéré dans les milieux
ecclésiastiques, le Pape Paul VI l'ayant choisi comme représentant des hommes
de science lors de la cérémonie de clôture du Concile en 1966.
La veille
de sa mort, le 29 avril 1973, il achevait d'écrire un texte qui devait résumer
toute sa pensée, sur le sujet qu'il considérait le plus urgent pour la société
actuelle. Ce qui est intéressant pour les  lecteurs
de «Vers Demain», c'est que ce sujet c'est l'argent, et surtout la dénonciation
du prêt à intérêt, qui crée des dettes impayables. Dans ce texte, Maritain
parle d'une société où l'Etat fabriquerait autant qu'il le faudrait, à l'usage
de chaque citoyen, des jetons représentant l'argent: «A chacun des citoyens
seraient distribués assez de jetons pour permettre à tous de jouir d'une
aisance assurant gratuitement, à un certain niveau de base assez élevé pour
qu'ils aient une existence digne de l'homme, la vie matérielle (logement,
habillement, alimentation, soins médicaux, etc.) d'une famille et sa vie
intellectuelle... Il va de soi que tout impôt à verser à l'Etat disparaîtrait
dans notre nouveau régime.»
lecteurs
de «Vers Demain», c'est que ce sujet c'est l'argent, et surtout la dénonciation
du prêt à intérêt, qui crée des dettes impayables. Dans ce texte, Maritain
parle d'une société où l'Etat fabriquerait autant qu'il le faudrait, à l'usage
de chaque citoyen, des jetons représentant l'argent: «A chacun des citoyens
seraient distribués assez de jetons pour permettre à tous de jouir d'une
aisance assurant gratuitement, à un certain niveau de base assez élevé pour
qu'ils aient une existence digne de l'homme, la vie matérielle (logement,
habillement, alimentation, soins médicaux, etc.) d'une famille et sa vie
intellectuelle... Il va de soi que tout impôt à verser à l'Etat disparaîtrait
dans notre nouveau régime.»
Sans en
avoir toute la technique et le perfectionnement, cela se rapproche un peu du
Crédit Social de C.H. Douglas et Louis Even. Mais ce que nous voulons fait
ressortir surtout ici, c'est le cinquième chapitre de ce texte de Maritain, qui
condamne sans détour l'intérêt sur l'argent. Voici ce chapitre:
Dans notre
société... tout mode de prêt à intérêt perdrait sa raison d'être, puisque, à
qui voudrait fonder un établissement ou une institution quelconque, l'Etat
fournirait sur demande tous les jetons dont il aurait besoin...
C'est à
partir de l'époque (XVIe siècle) où il a commencé de gagner légalement la
partie que le prêt à intérêt a pris pour notre civilisation une importance
absolument décisive; et c'est donc surtout le prêt à intérêt dans les temps
modernes que j'aurai en vue dans les brèves réflexions que je vais proposer
ici, sans oublier que son histoire tout entière est hautement significative, —
rien de plus humiliant que cette histoire à considérer dans les affaires
humaines. Car tandis que l'esprit le condamnait au nom de la vérité, et de la
nature des choses, il a fait son chemin dans notre comportement pratique, et
finalement établi son empire en vertu de nos besoins matériels pris comme fin
en soi, séparément du bien total de l'être humain lui-même.
Du même
coup le champ de notre agir s'est trouvé coupé en deux, et l'on s'imagine que
le monde des affaires constitue un monde à part, possédant de soi une valeur
absolue, indépendante des valeurs et des normes supérieures qui rendent la vie
digne de l'homme, et qui mesurent la vie humaine en son intégralité...
La vérité
sur le prêt à intérêt, c'est Aristote qui nous la dit, et de quelle façon
décisive quand il déclare fausse et pernicieuse l'idée de la fécondité de
l'argent, et affirme que de toutes les activités sociales la pire est celle
du prêteur d'argent, qui force à devenir productrice d'un gain une chose
naturellement stérile comme la monnaie, laquelle ne peut avoir d'autre
propriété et d'autre usage que de servir de commune mesure des choses.
User de
l'argent qu'on possède pour entretenir sa propre vie, satisfaire ses désirs, ou
acquérir en le dépensant de nouveaux biens, améliorant et embellissant
l'existence, cela est normal et bon. Mais user de l'argent qu'on possède pour
lui faire, comme si l'argent lui-même était fécond, engendrer de l'argent, et
rapporter un intérêt «fils de l'argent», —en grec on l'appelait «rejeton de
l'argent» —, c'est de tous les moyens de s'enrichir «le plus contraire à la
nature», et ne se peut qu'en exploitant le travail d'autrui. «On a donc
parfaitement raison de haïr le prêt à intérêt.»...
L'Eglise,
dans son pur enseignement doctrinal, a condamné le prêt à intérêt aussi
fermement qu'Aristote. Et pendant longtemps la législation civile a été
d'accord avec elle pour regarder le prêt comme devant essentiellement être
gratuit. Tous ceux (et ils ne manquaient pas) qui enfreignaient cette loi
étaient punissables.
C'est un
peu avant le milieu du XVIe siècle que le droit civil a rompu avec
l'enseignement doctrinal de l'Eglise, permettant ainsi au monde des affaires de
tenir pour normal et régulier l'emploi du prêt à intérêt. Mais le pur
enseignement doctrinal de l'Eglise, condamnant purement et simplement le prêt à
intérêt, restait toujours là...
Il reste à
l'honneur de la papauté, qu'à une époque où la civilisation du marché, qui
avait commencé son règne au XIIe siècle, était décidément triomphante, Benoît
XIV a publié en 1745 la fameuse Bulle Vix pervenit, prohibant une fois
de plus le prêt à intérêt, et déclarant que c'est un péché d'admettre que dans
un contrat de prêt, celui qui prête a droit à recevoir en retour plus que la
somme avancée par lui.
Et plus
tard encore, alors que florissait le capitalisme du XIXe siècle, Léon XIII
dénonçait dans l'encyclique Rerum novarum «l'usure rapace» comme un
fléau de notre régime économique.
Cependant
le monde des affaires se moquait bien des prohibitions de l'Eglise, et dans les
temps modernes le système du prêt à intérêt a fini par s'imposer avec une force
irrésistible au régime économique de la société, dont il est devenu le nerf
essentiel et qui sans lui était désormais impossible et inconcevable...
Penser
que, une fois qu'il a porté son fruit, une somme d'argent surajoutée, fruit de
la fécondité de l'argent investi par le bailleur de fonds, est dû à celui-ci à
titre d'intérêts rapportés par le capital, est une illusion. L'argent n'est pas
fécond...
D'autre part, une fois qu'on est entré dans le système du prêt à
intérêt, on aura beau accumuler les études théoriques et les essais empiriques
pour porter remède à tous les vices de celui-ci, on n'y arrivera jamais, parce
qu'il est fondé sur un faux principe, le principe de la fécondité de l'argent.
Jacques Maritain
Table des
matières
Accueil
Caricatures
de VD
Site de Vers Demain
